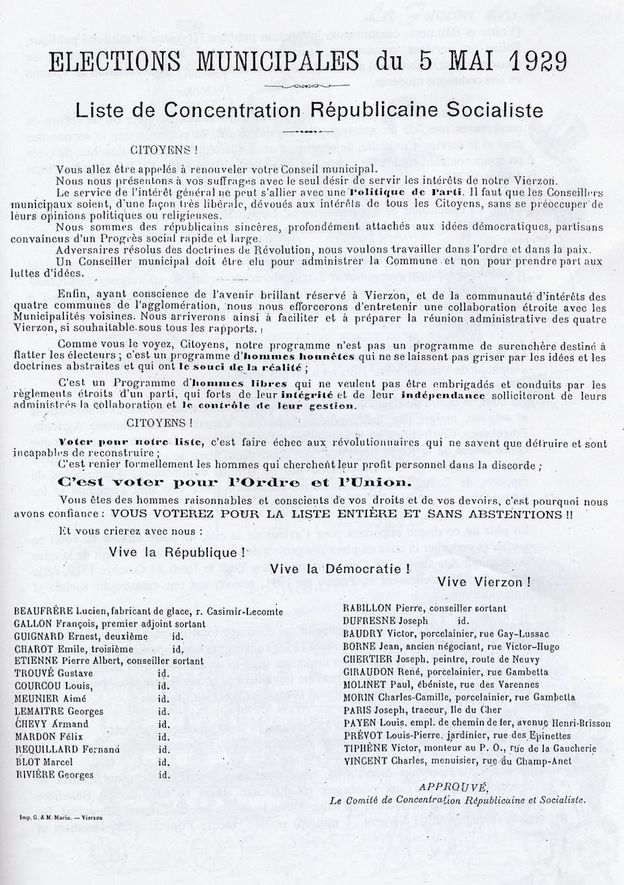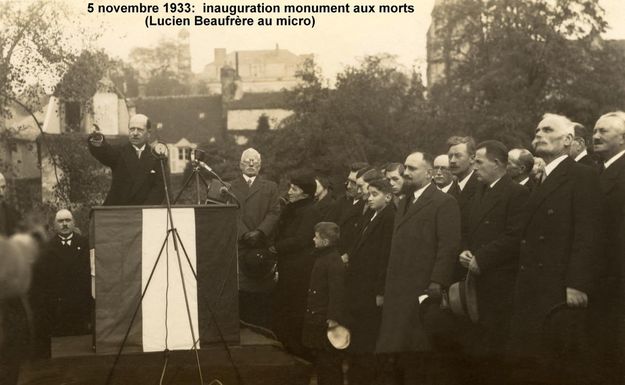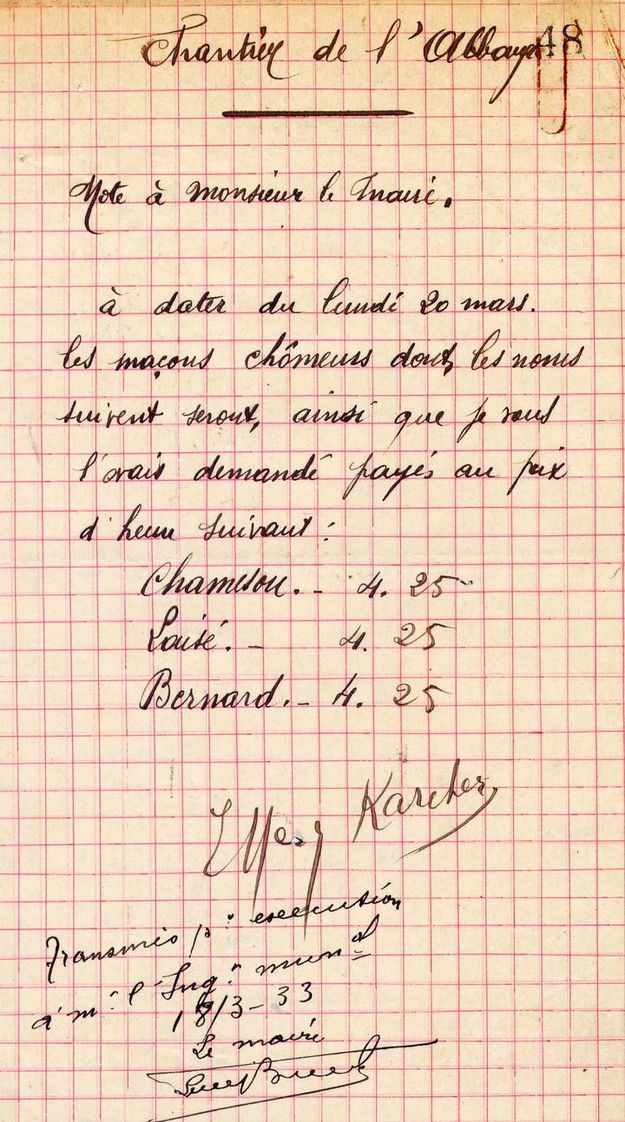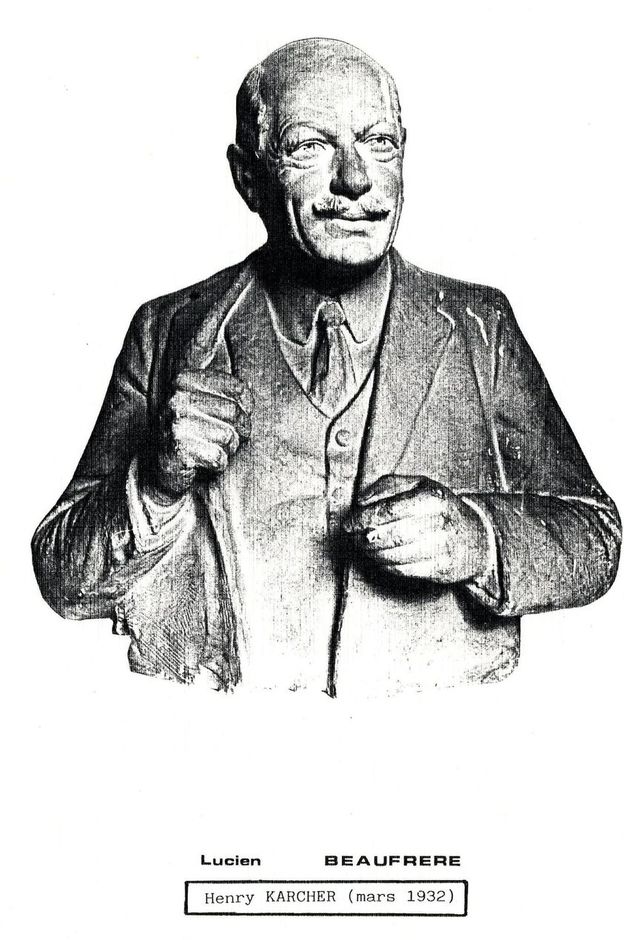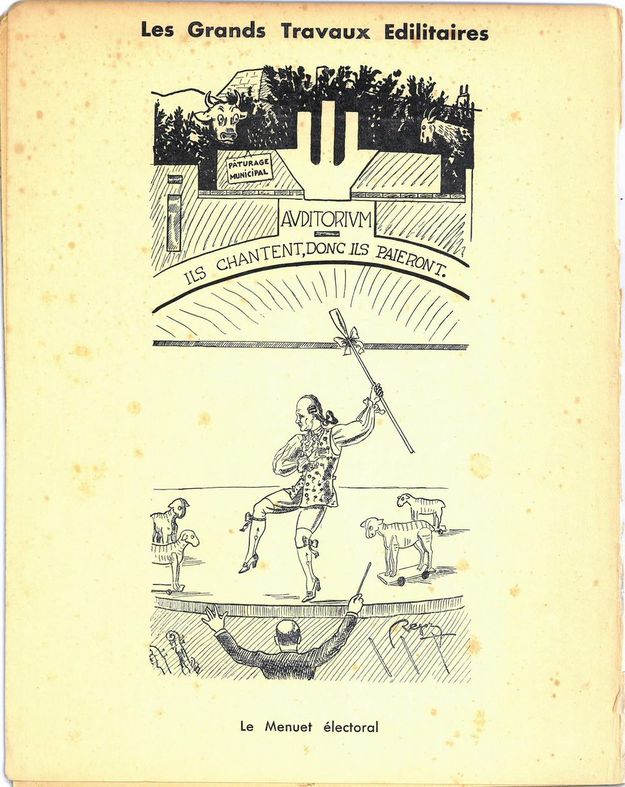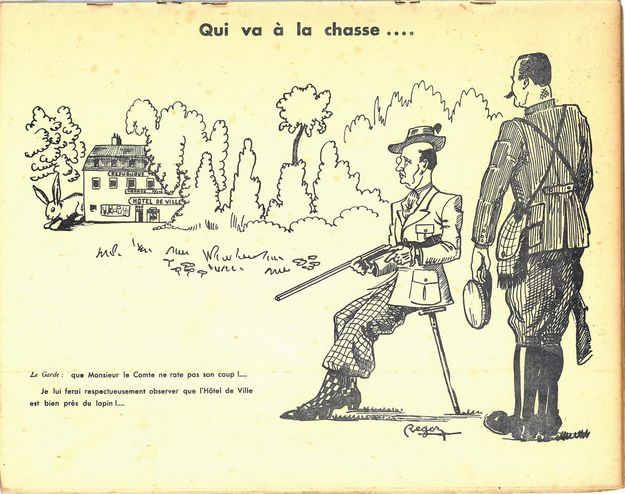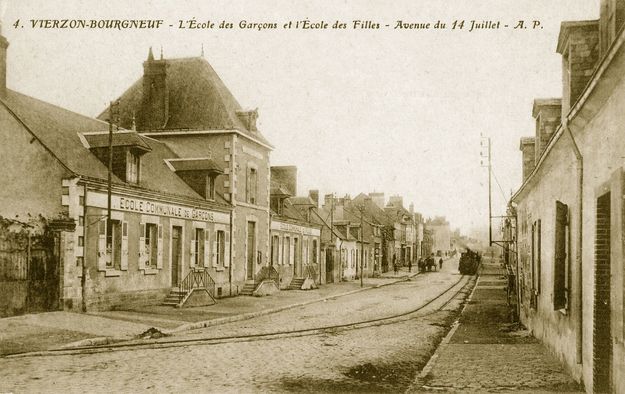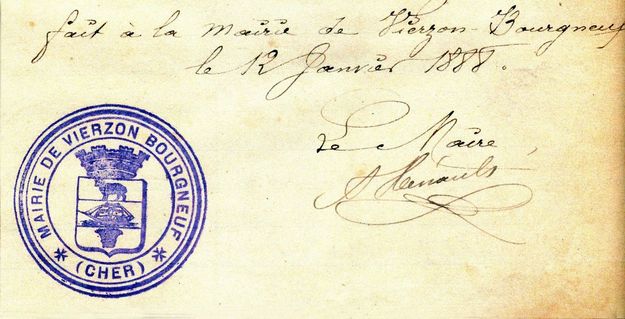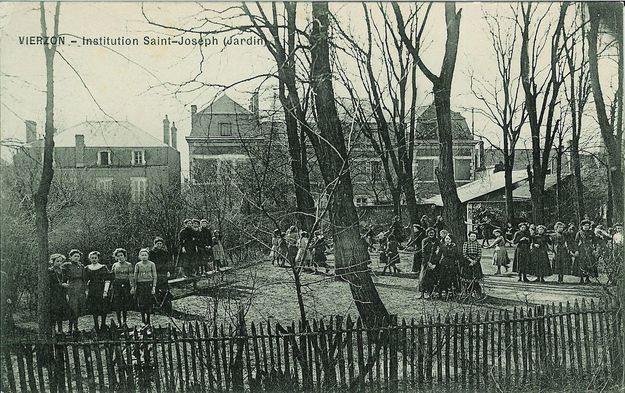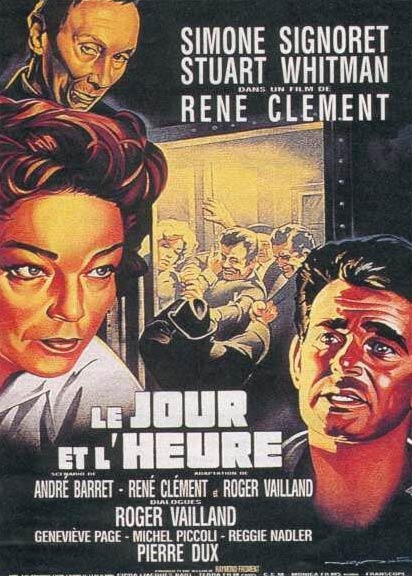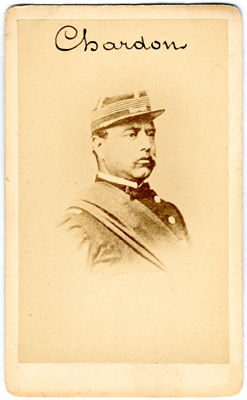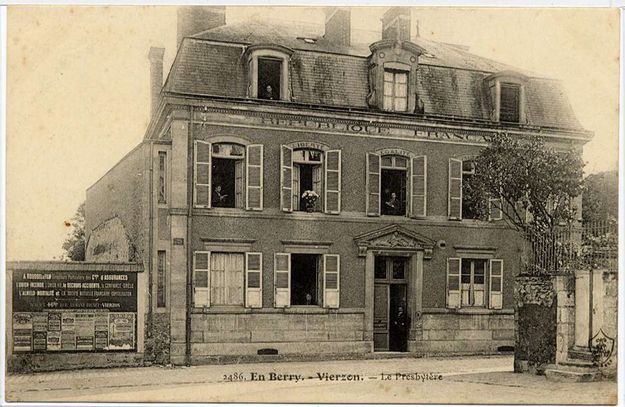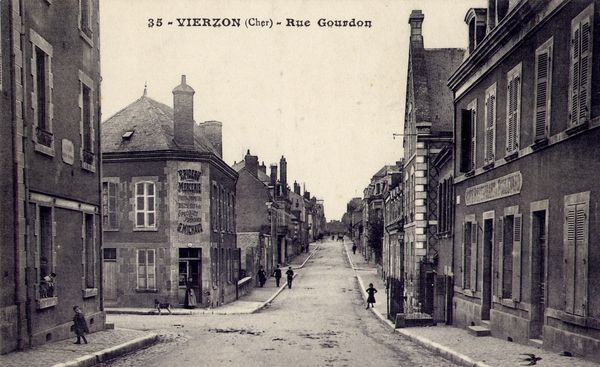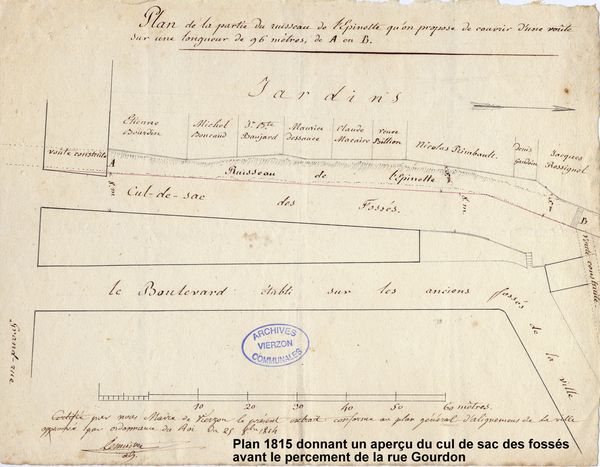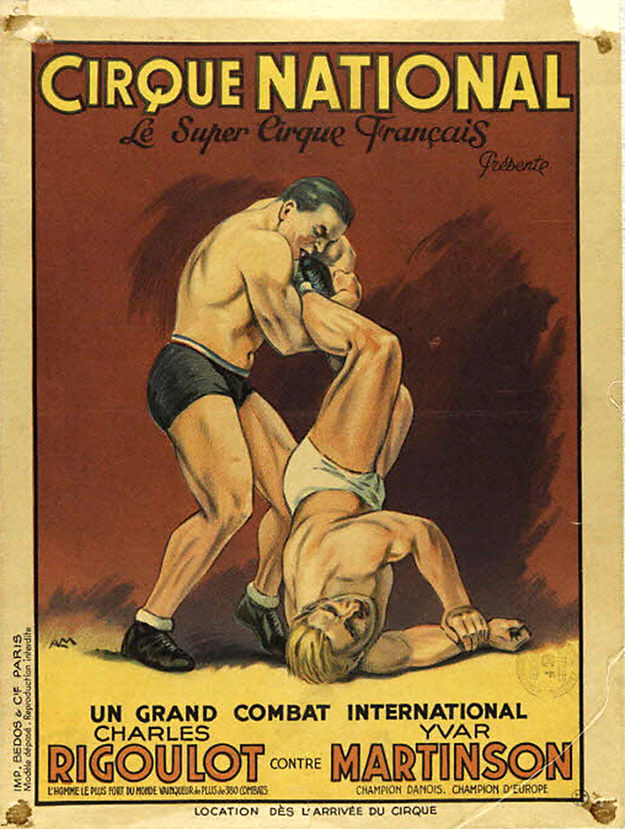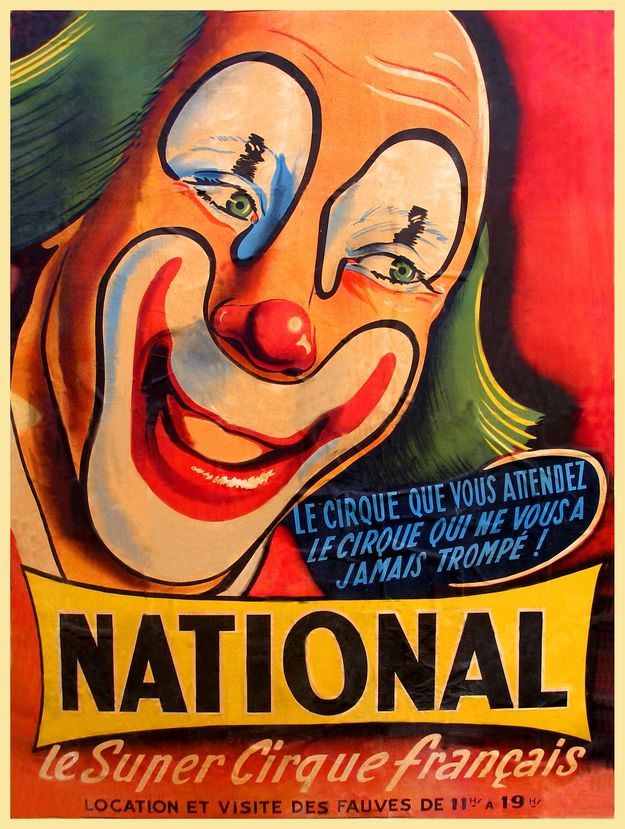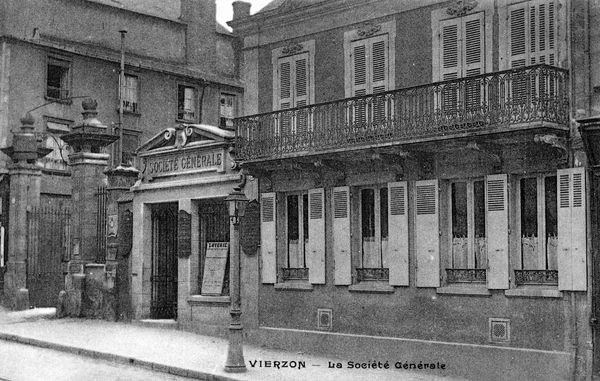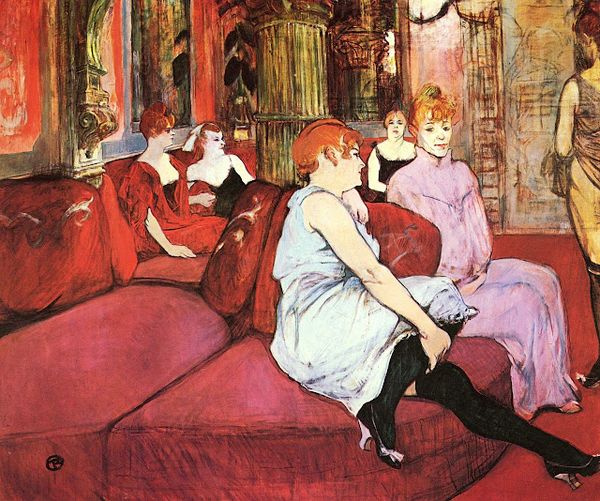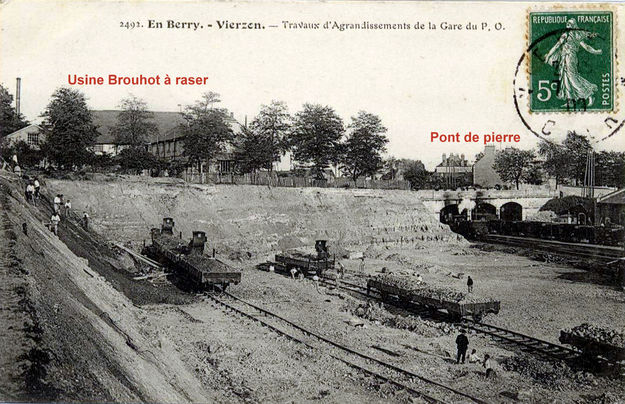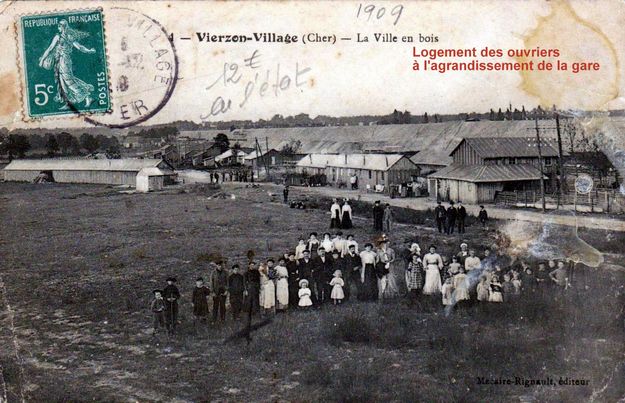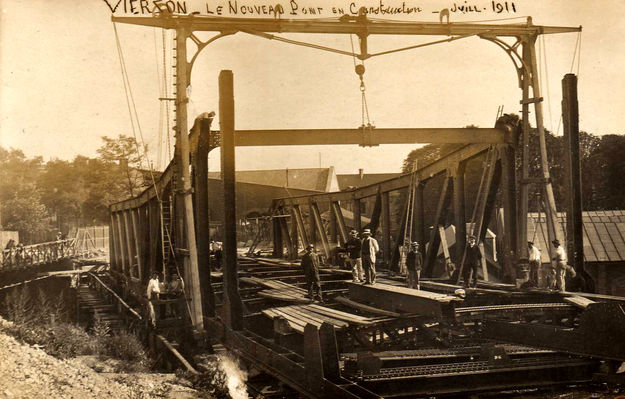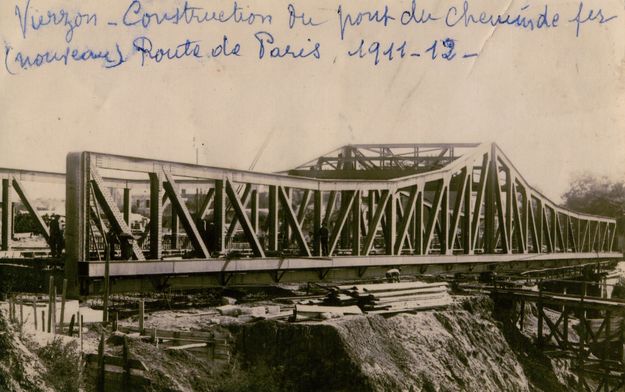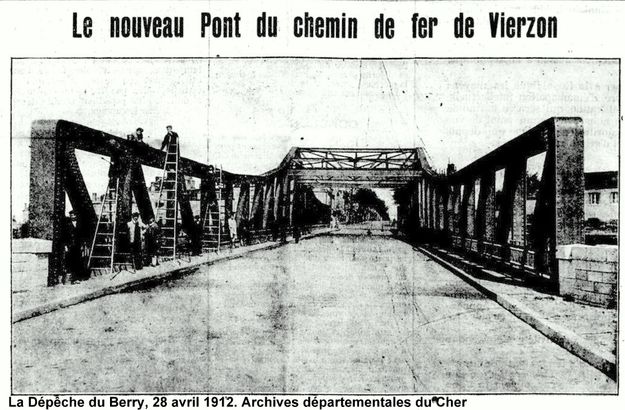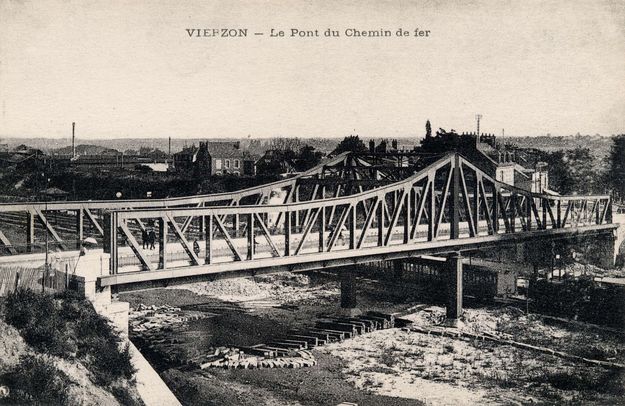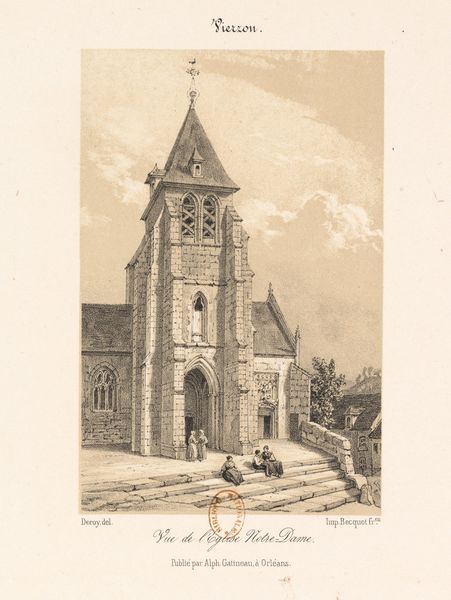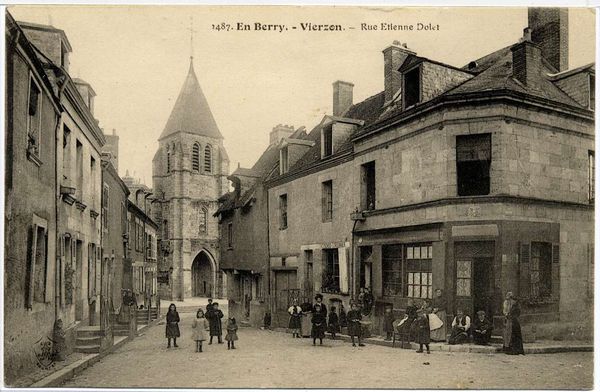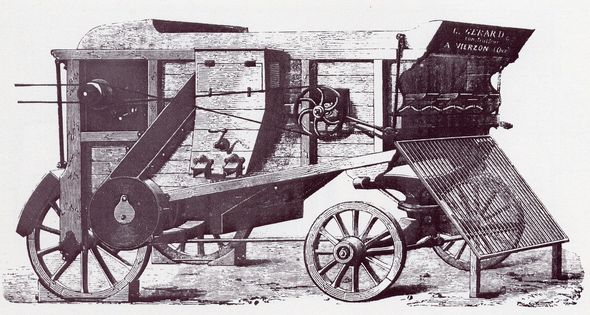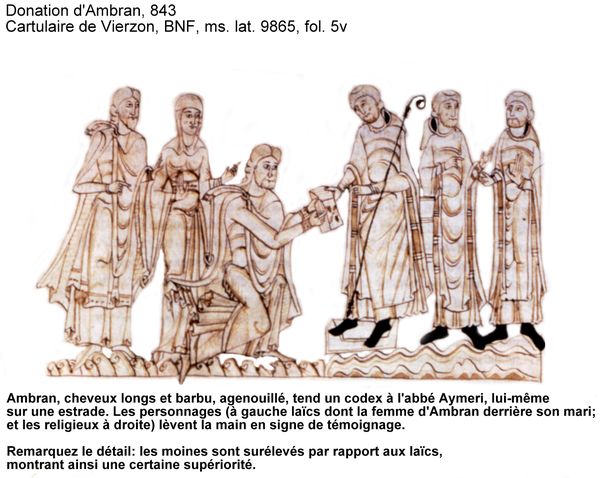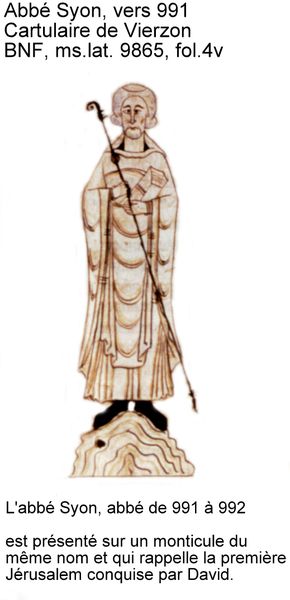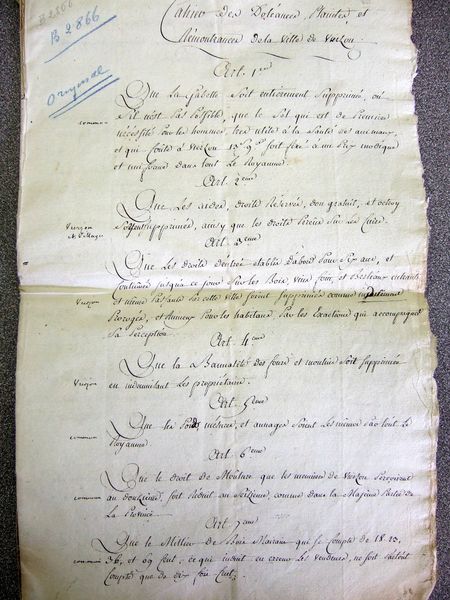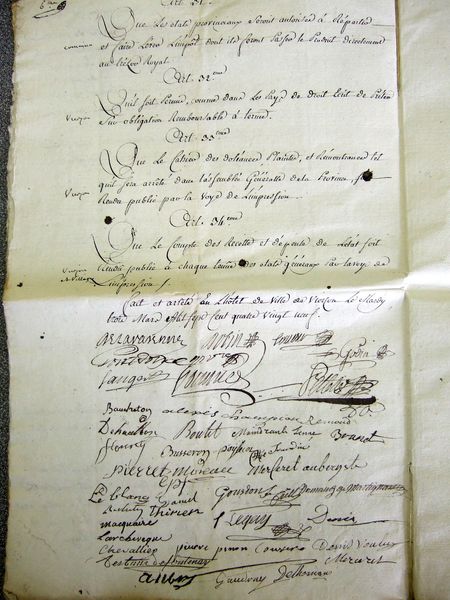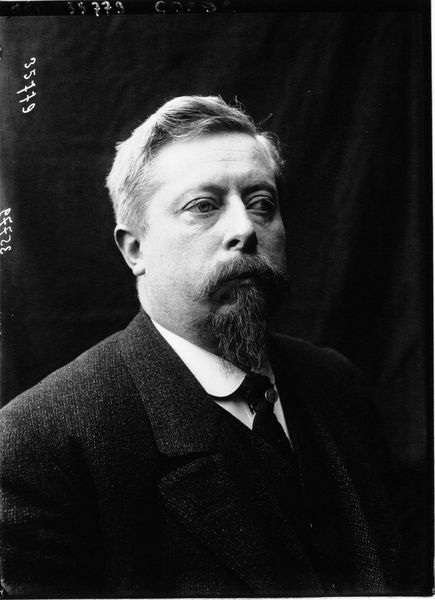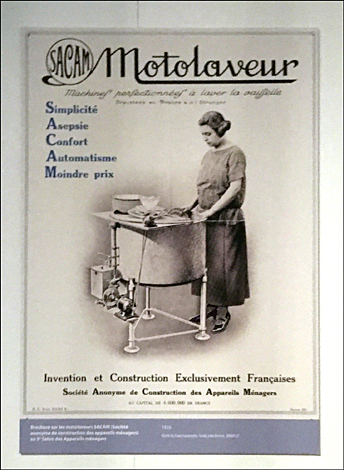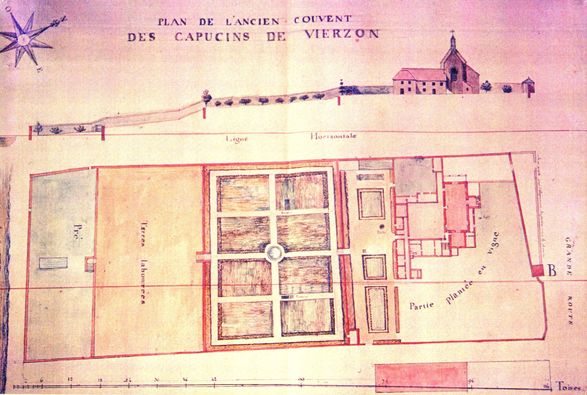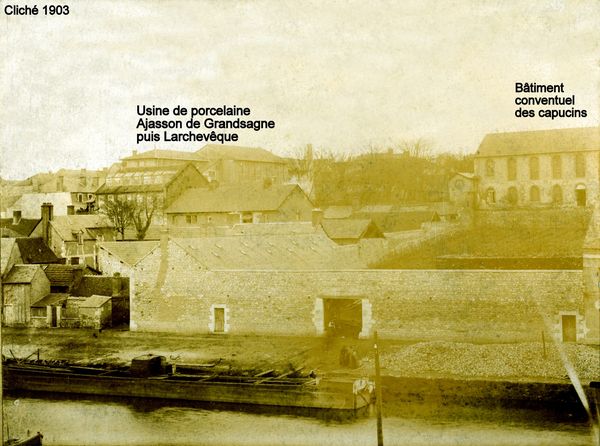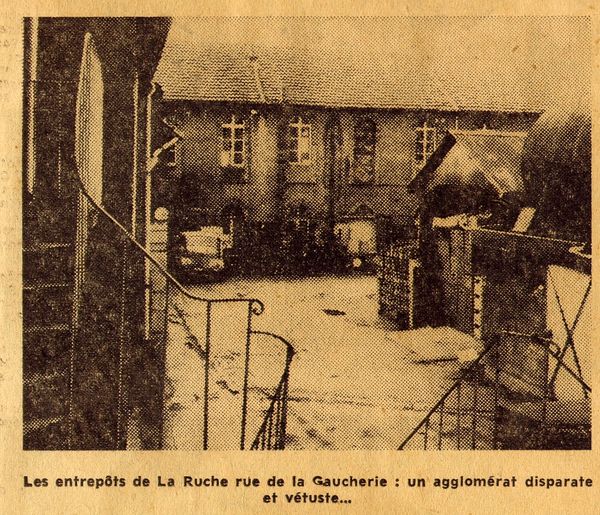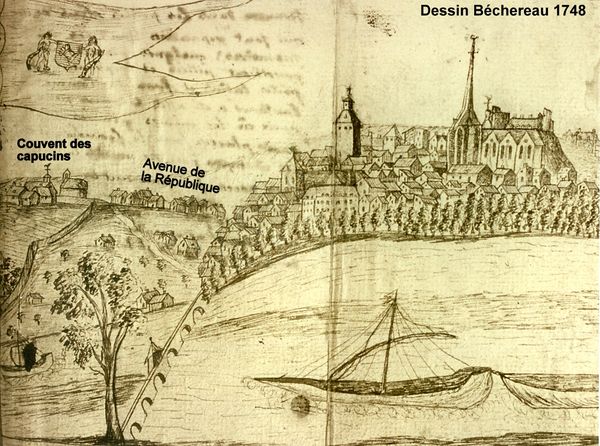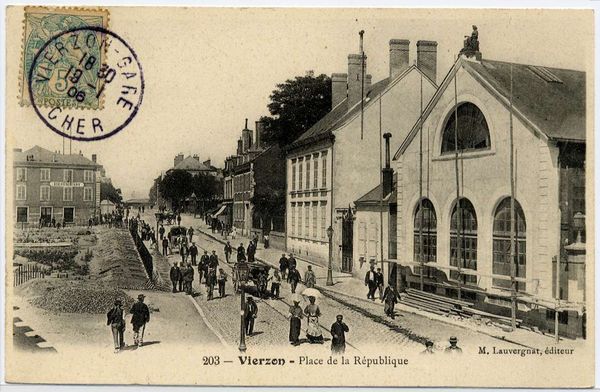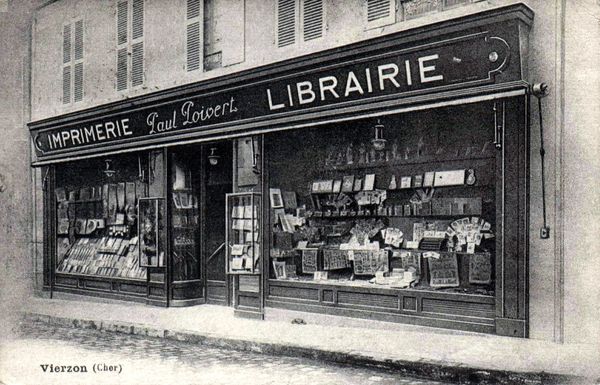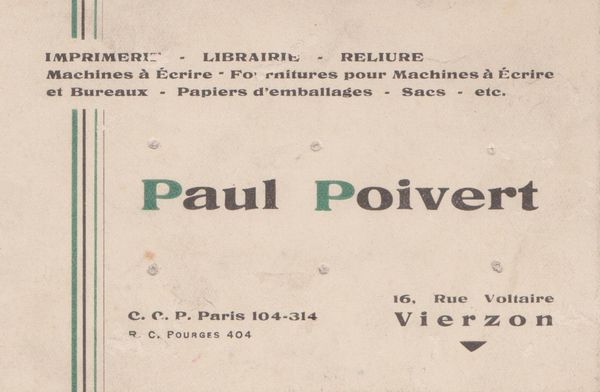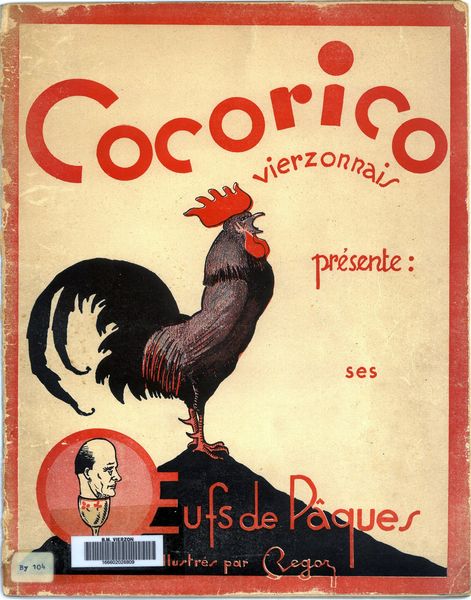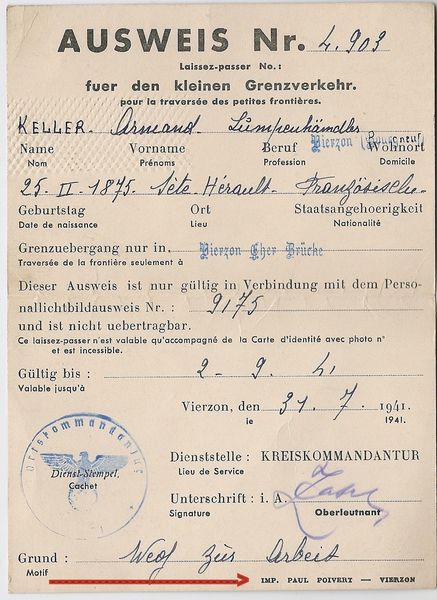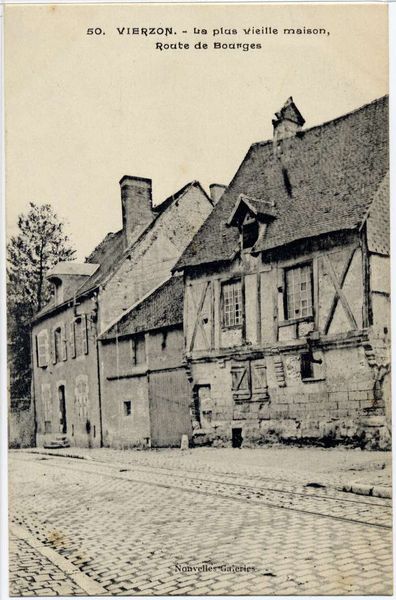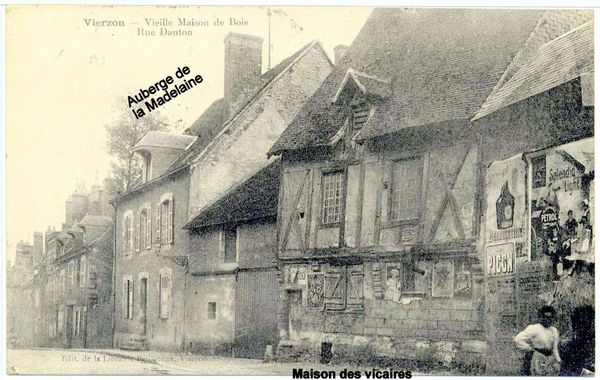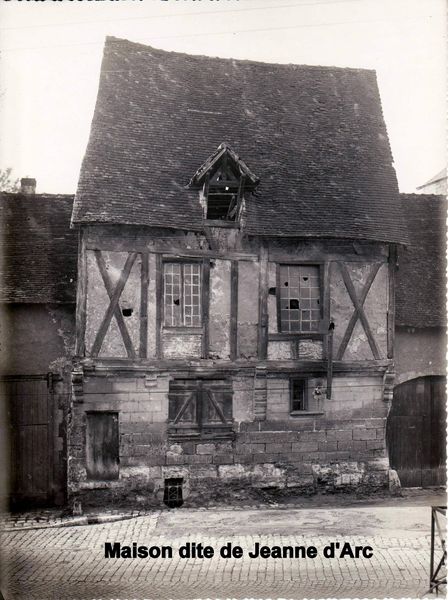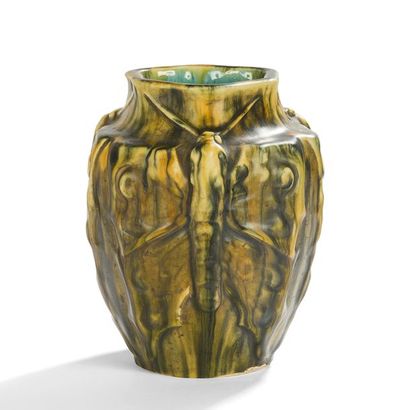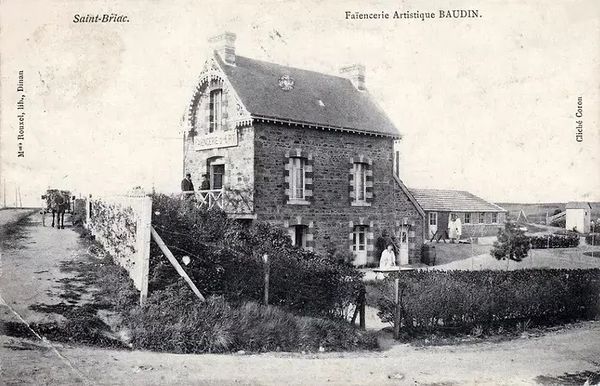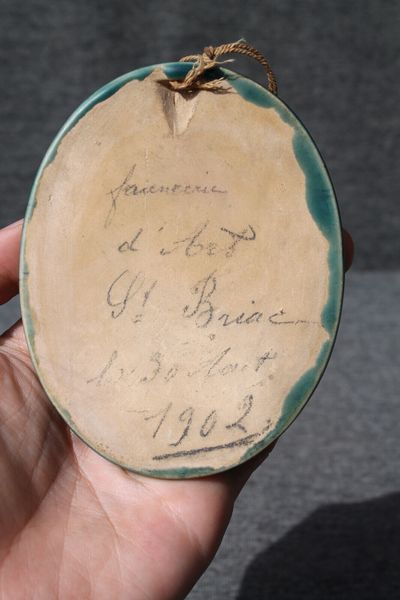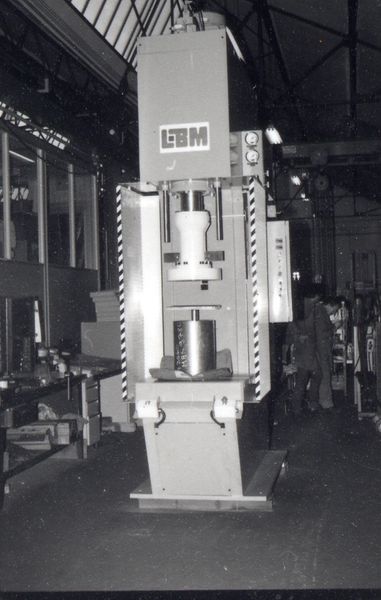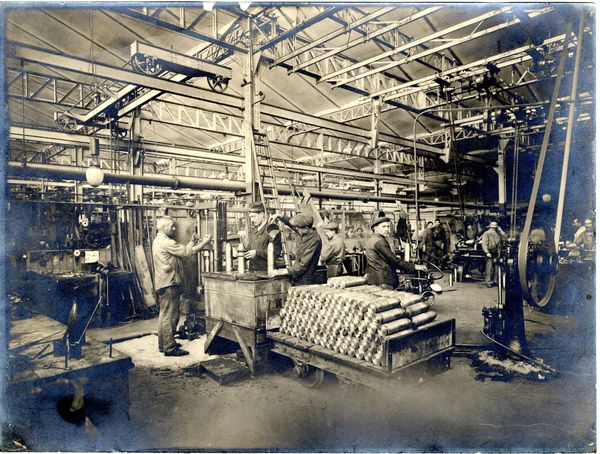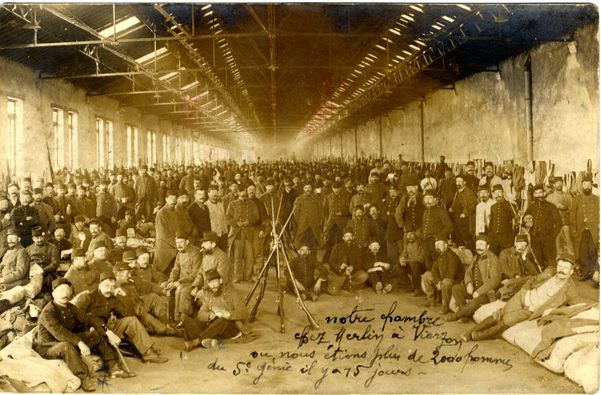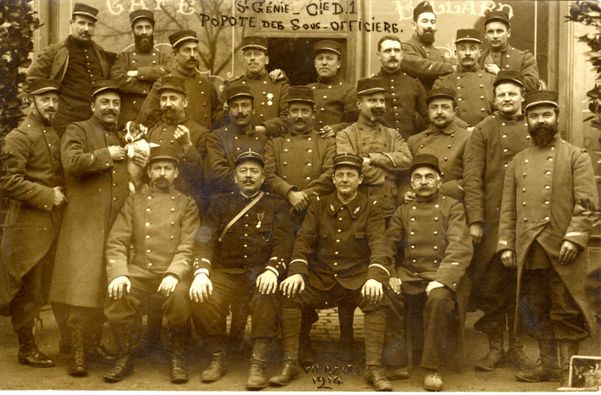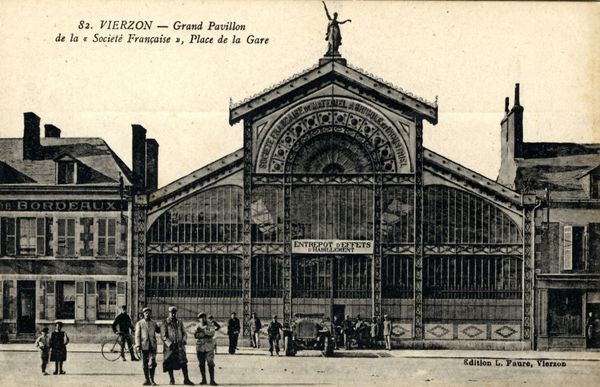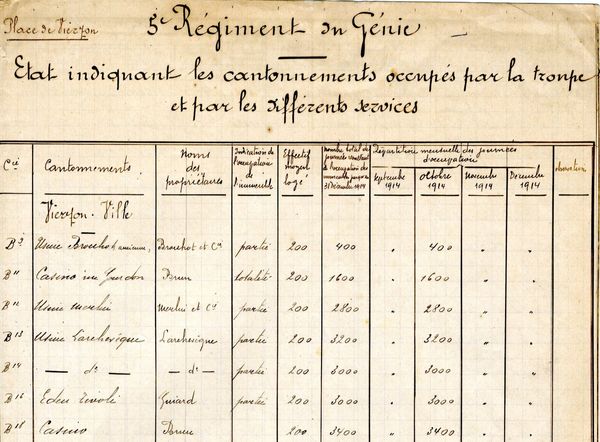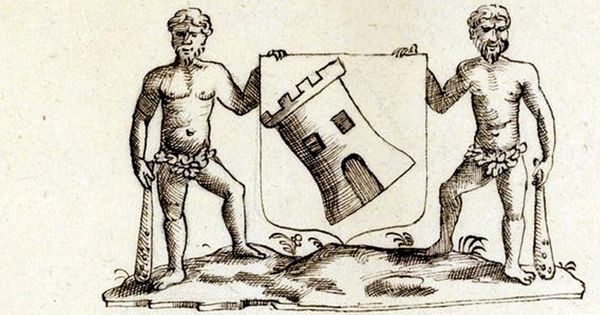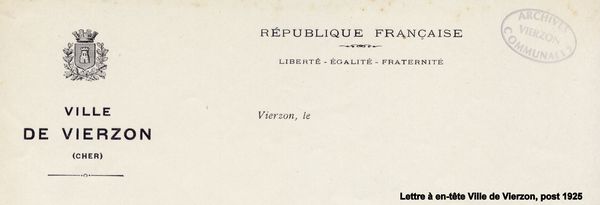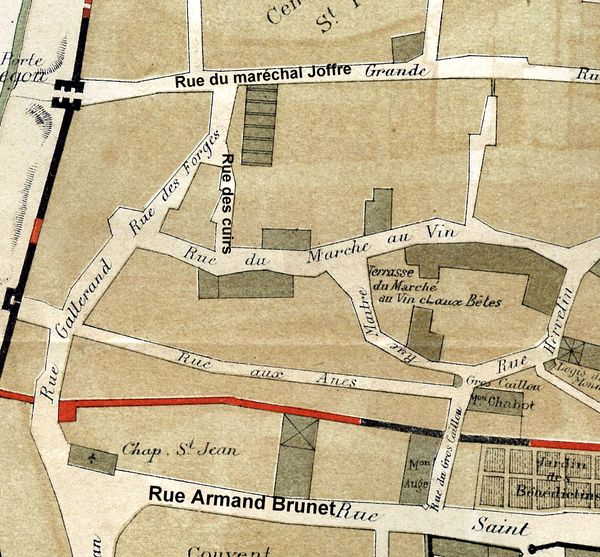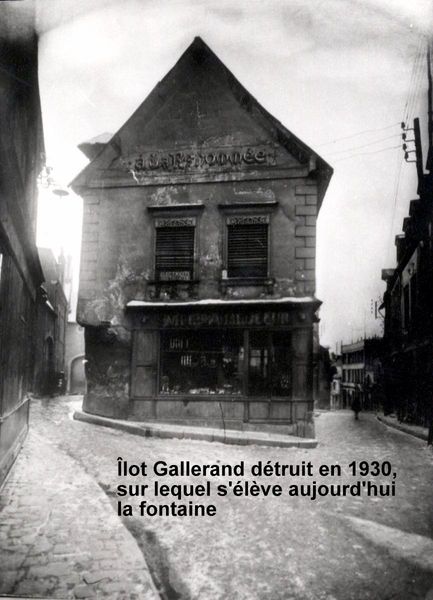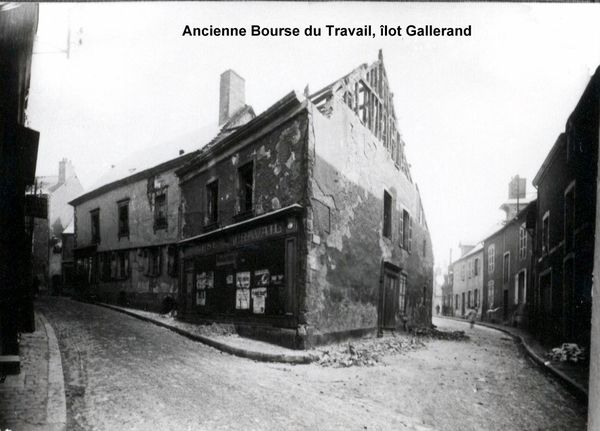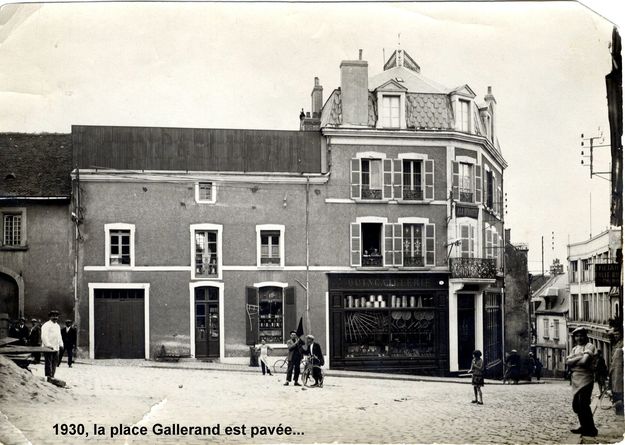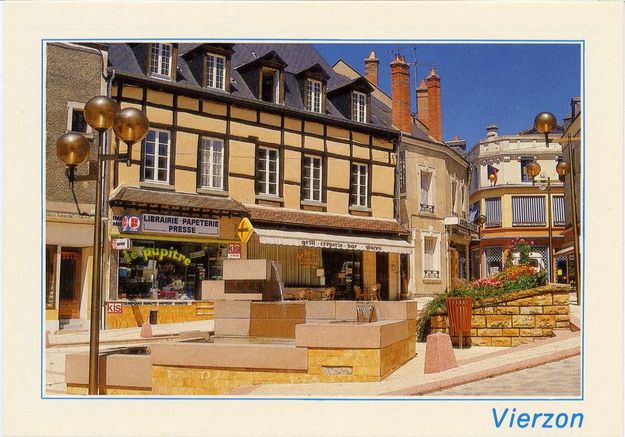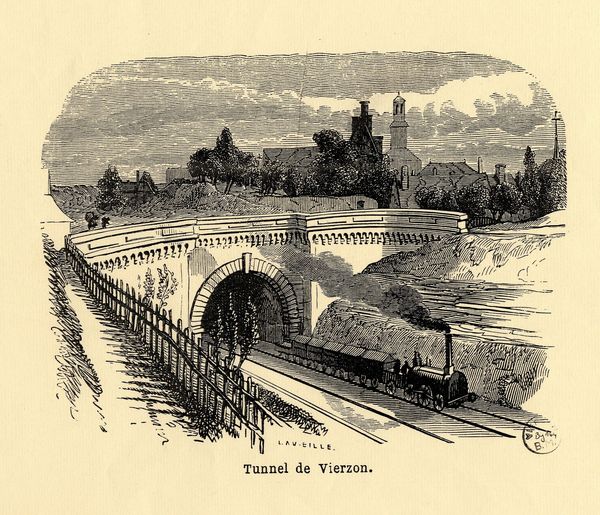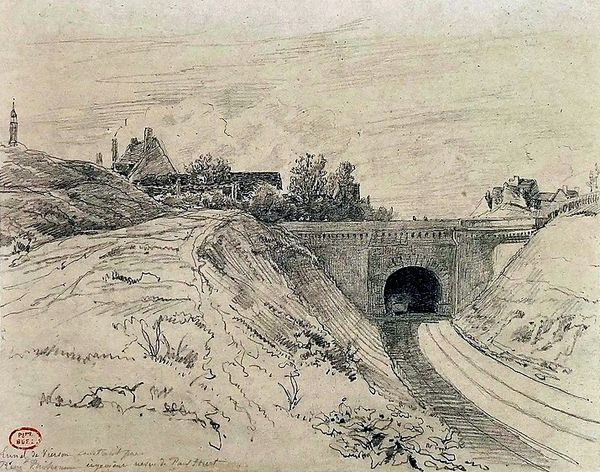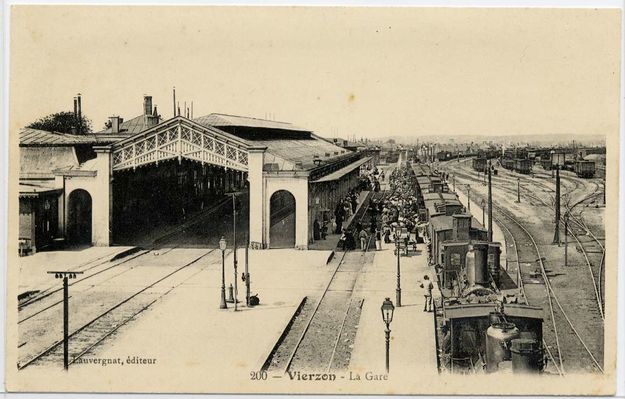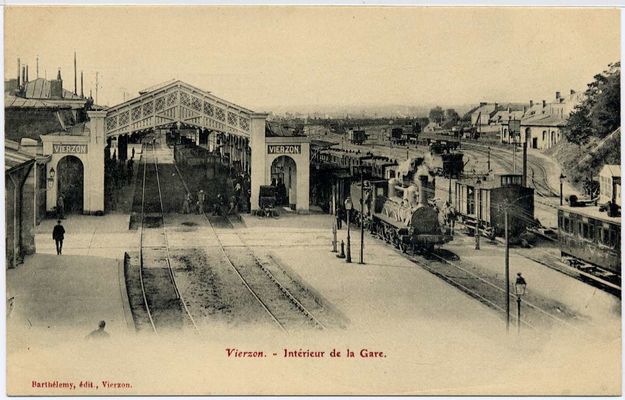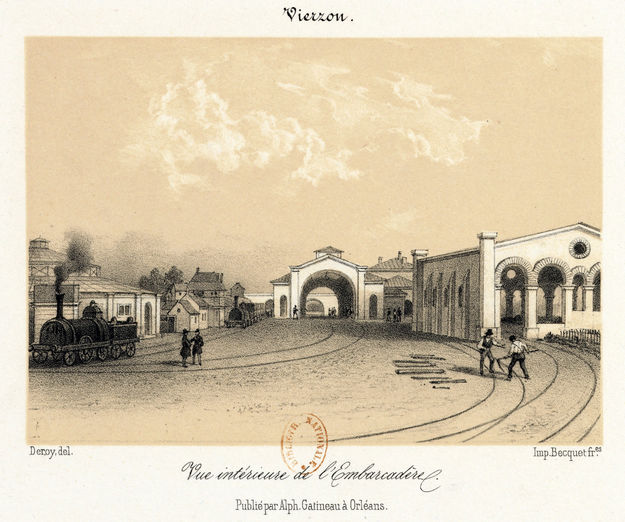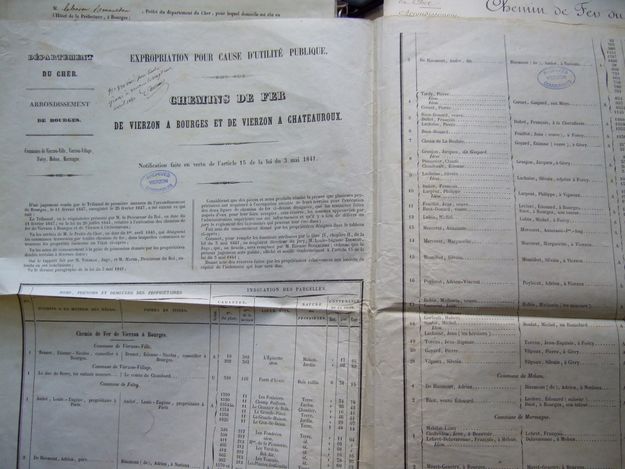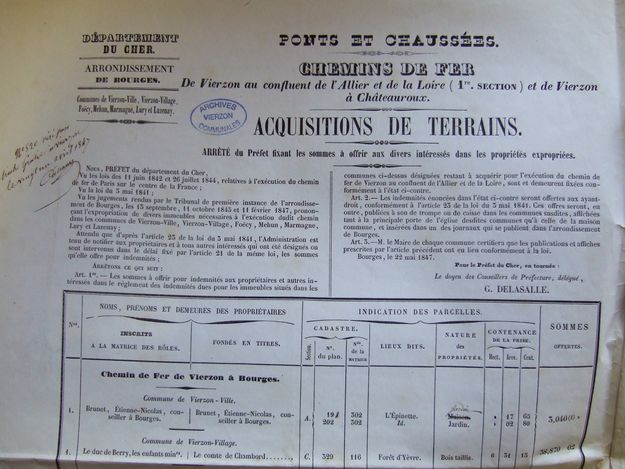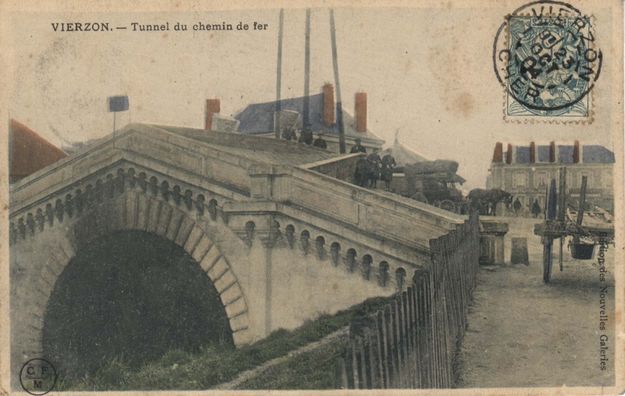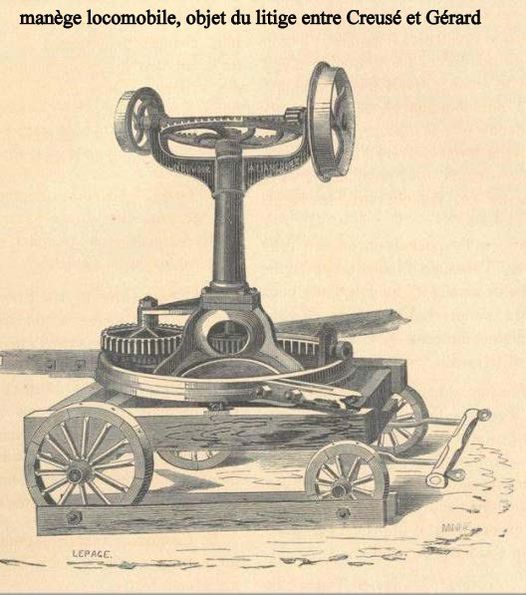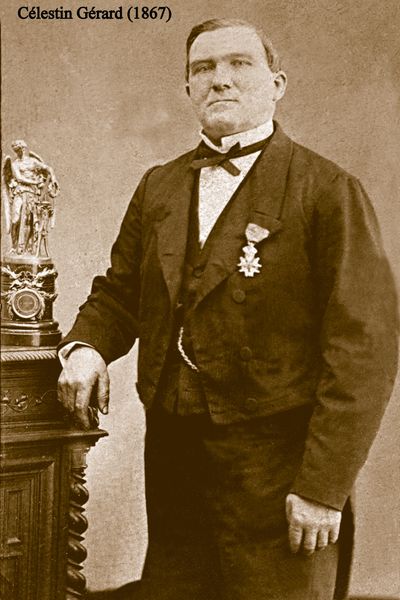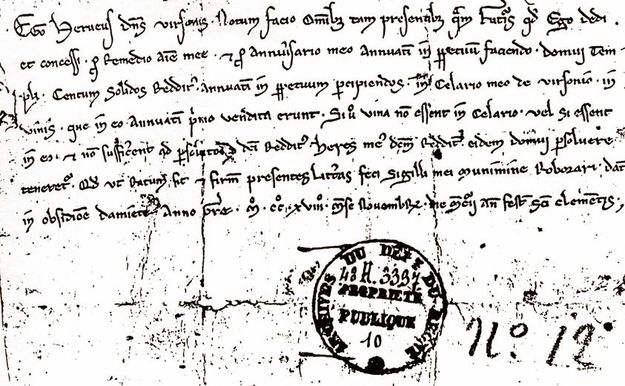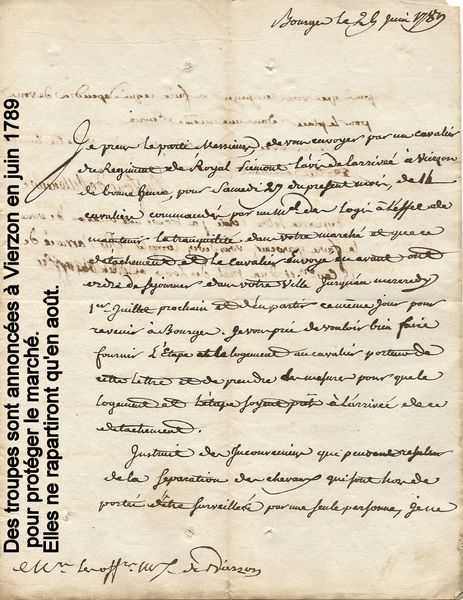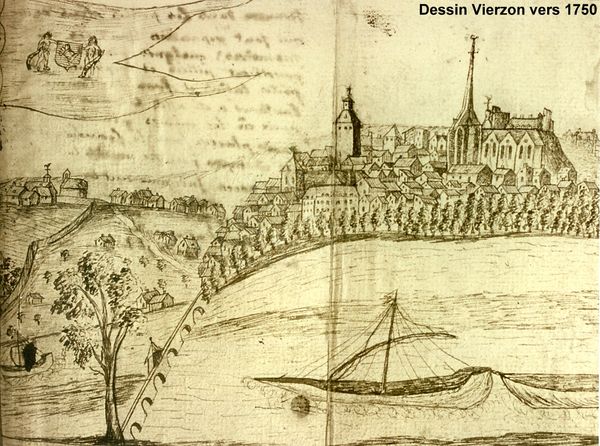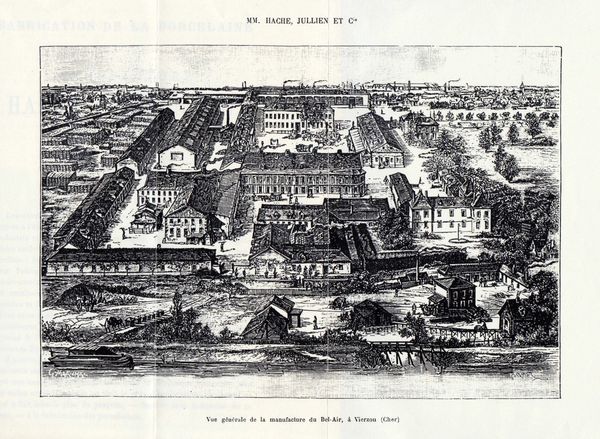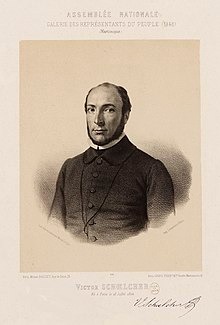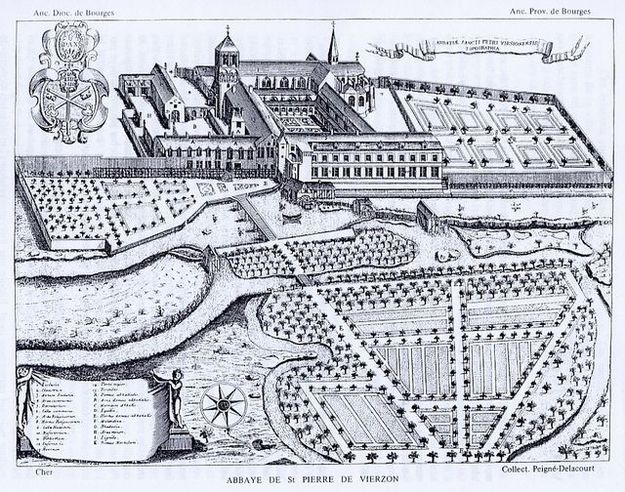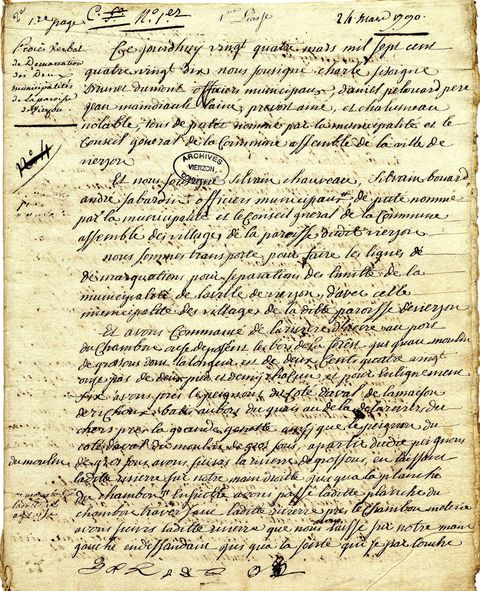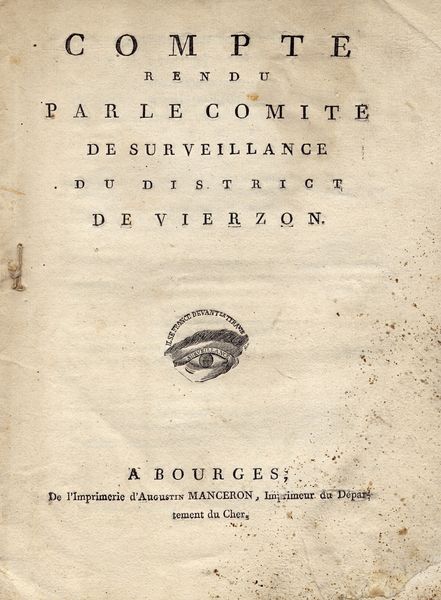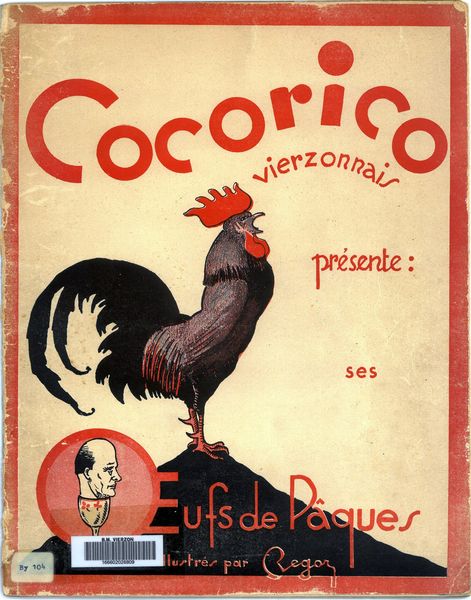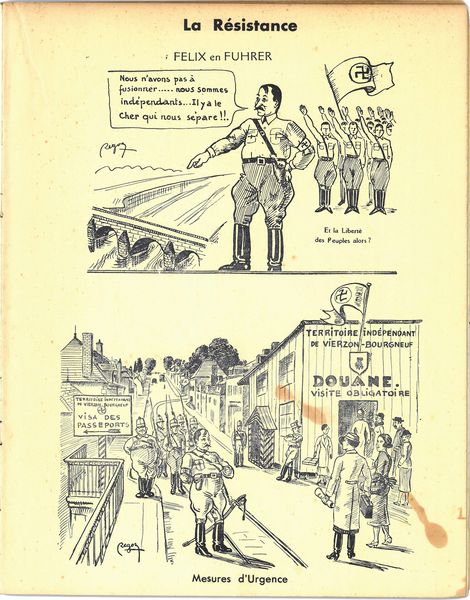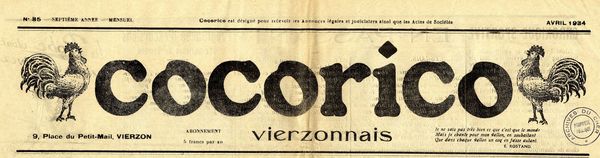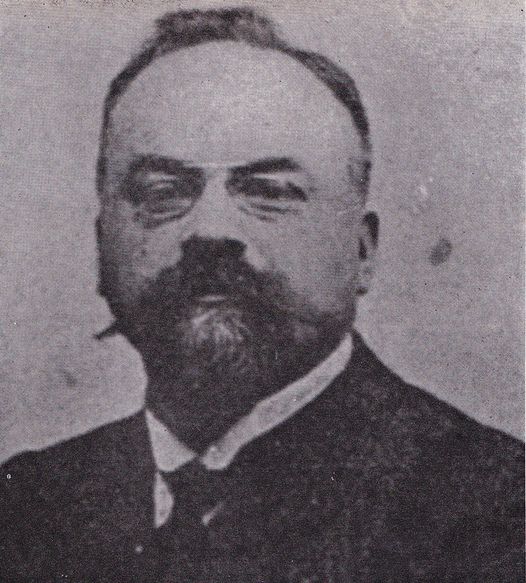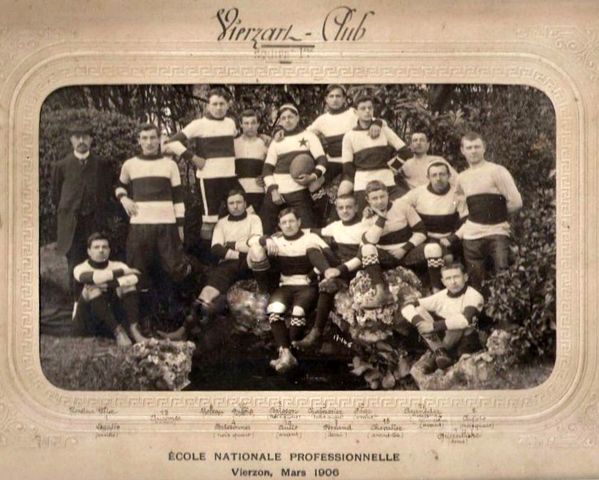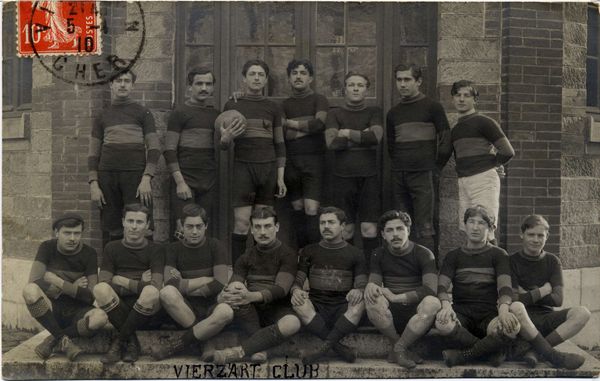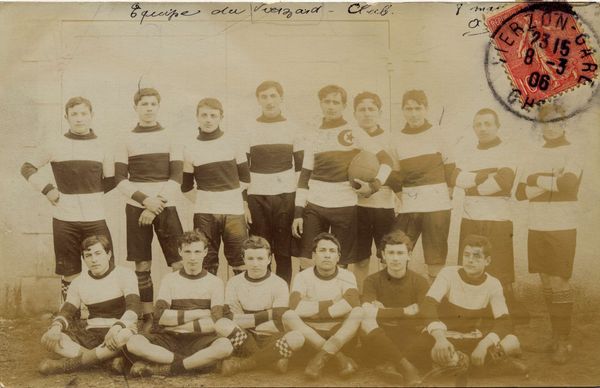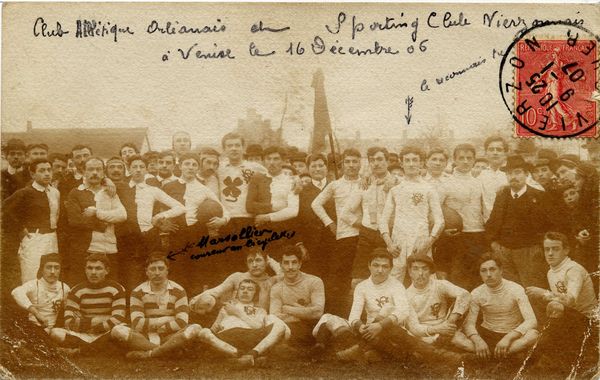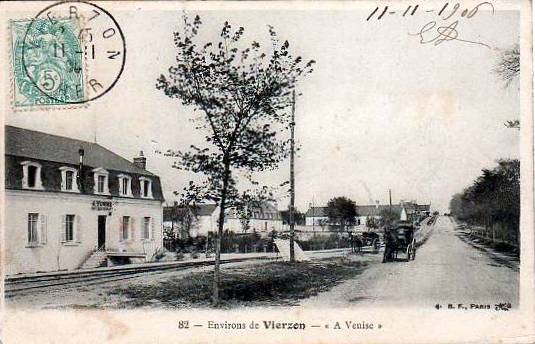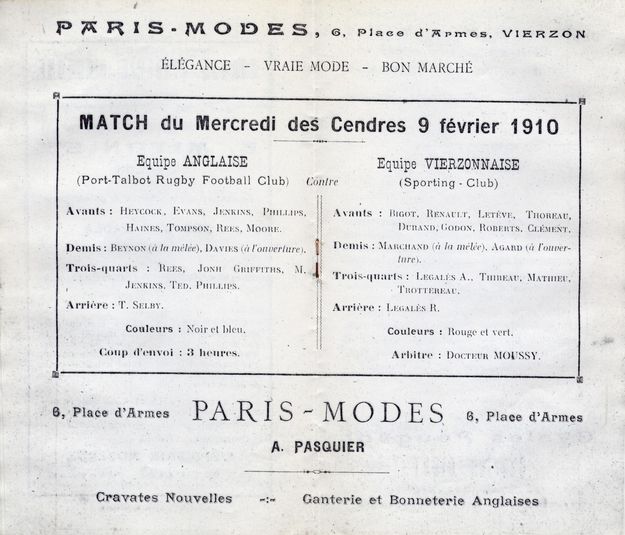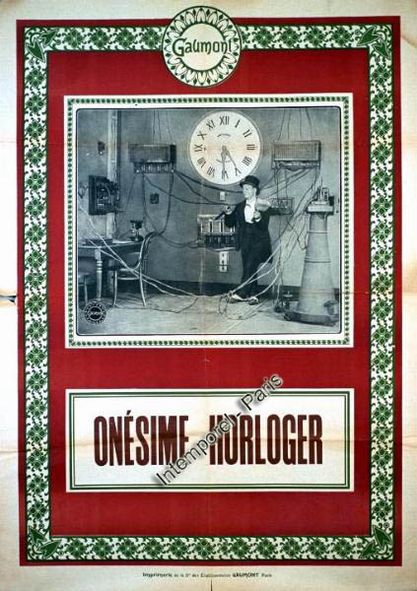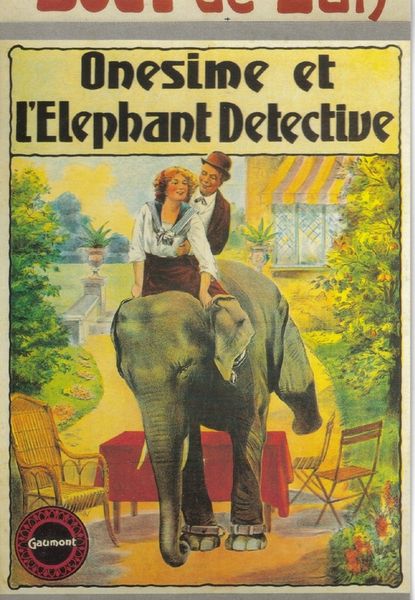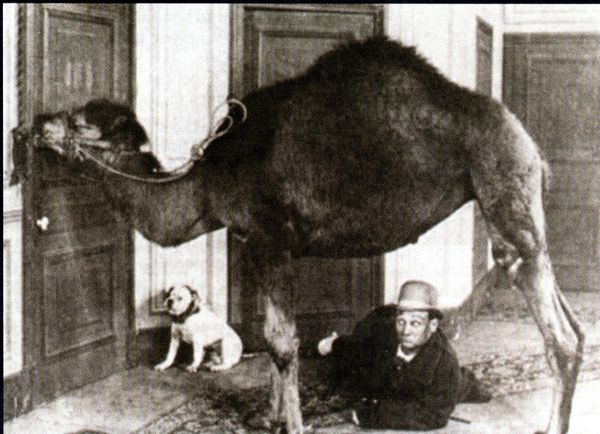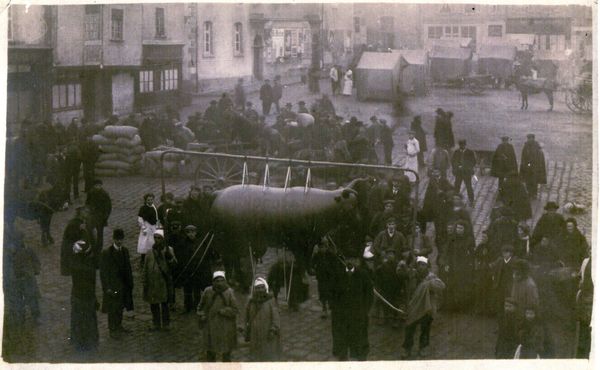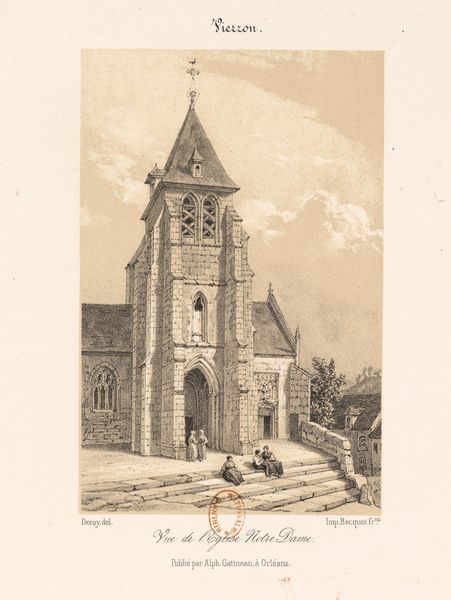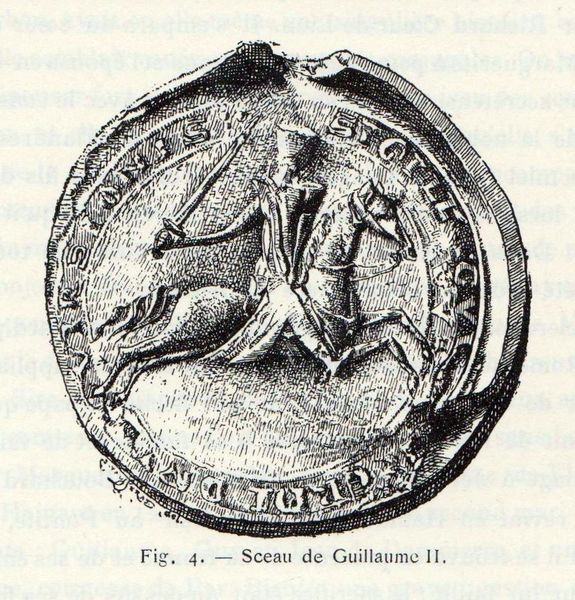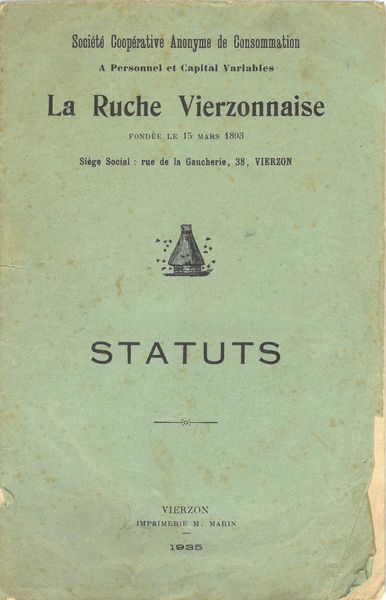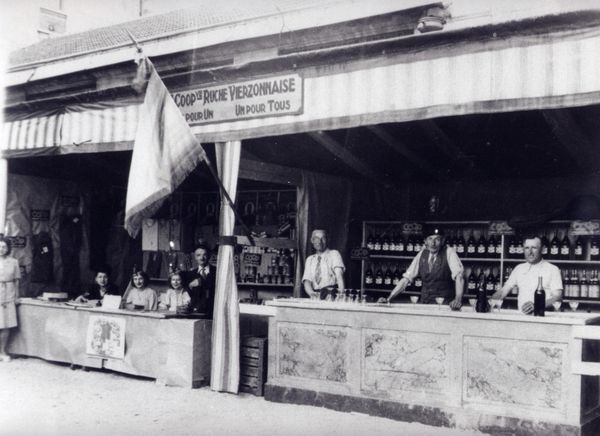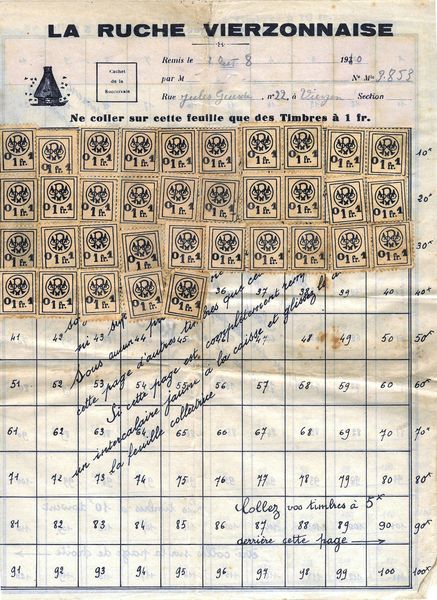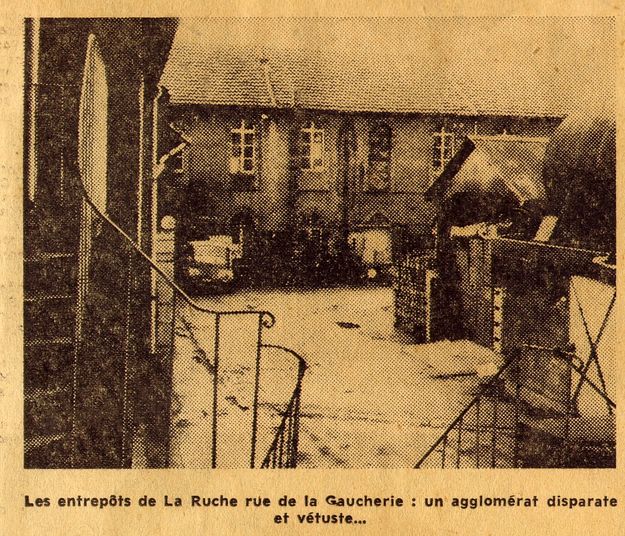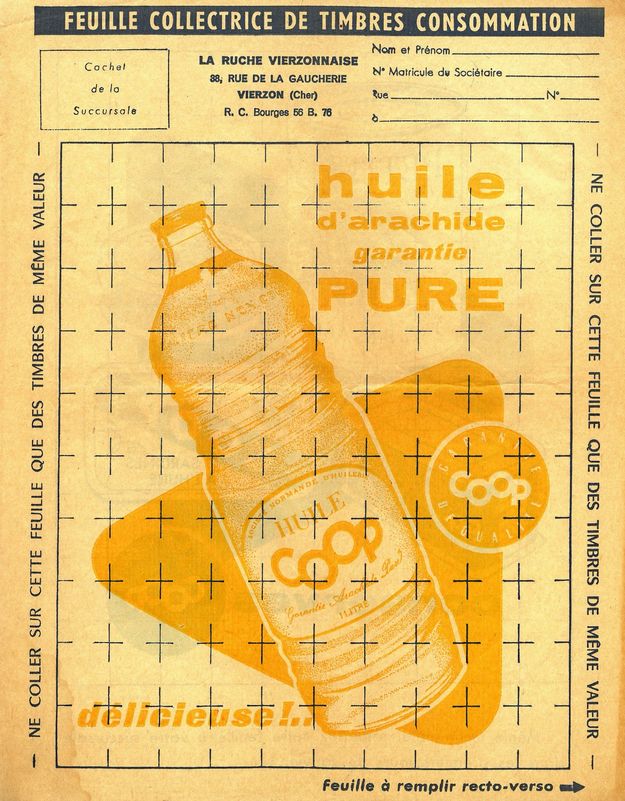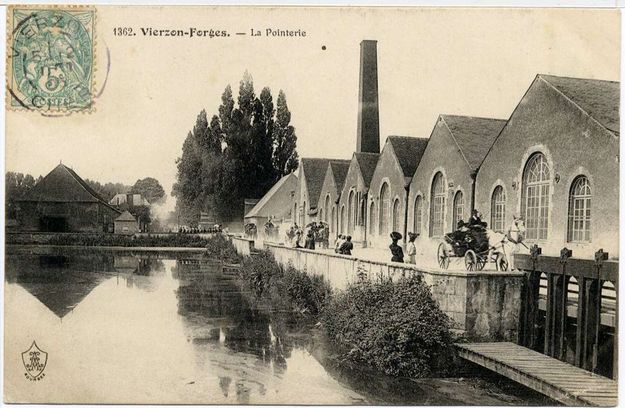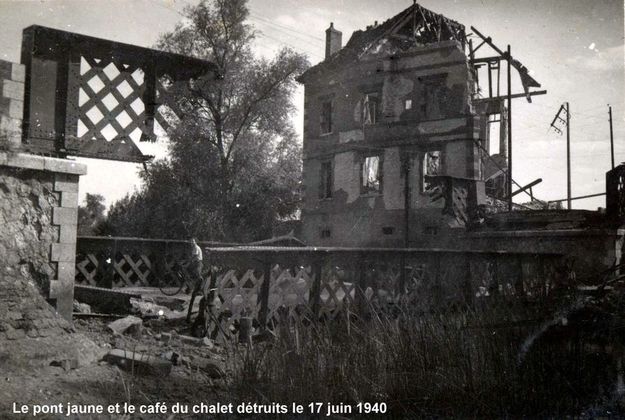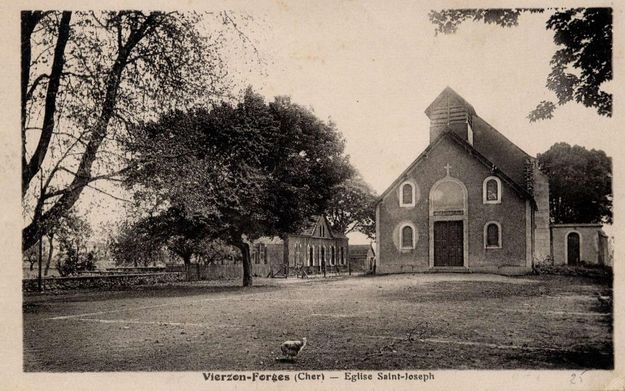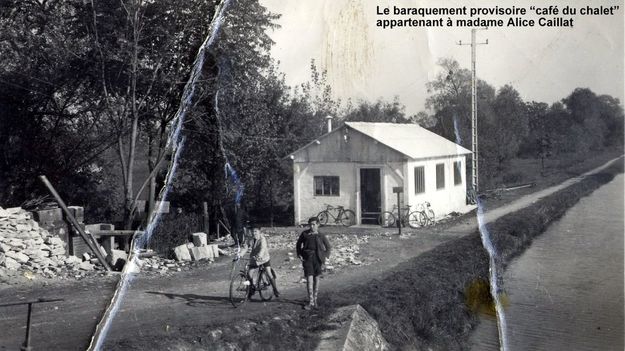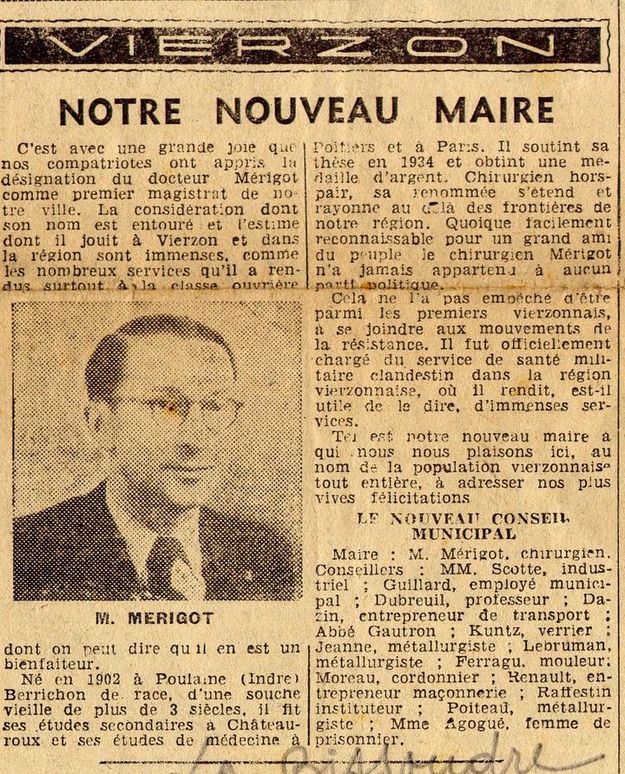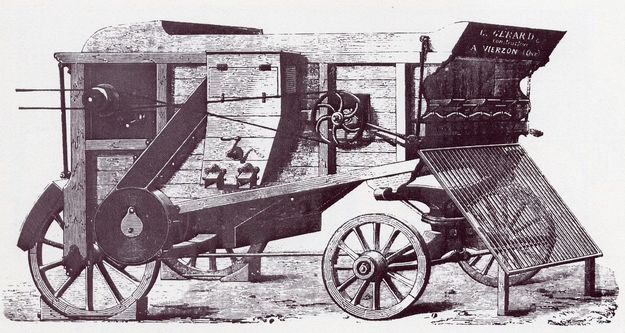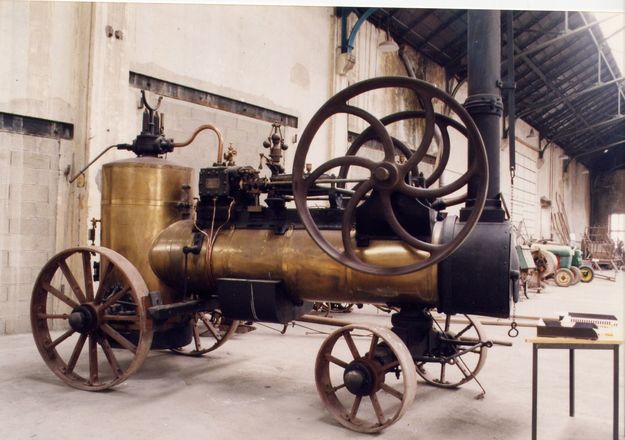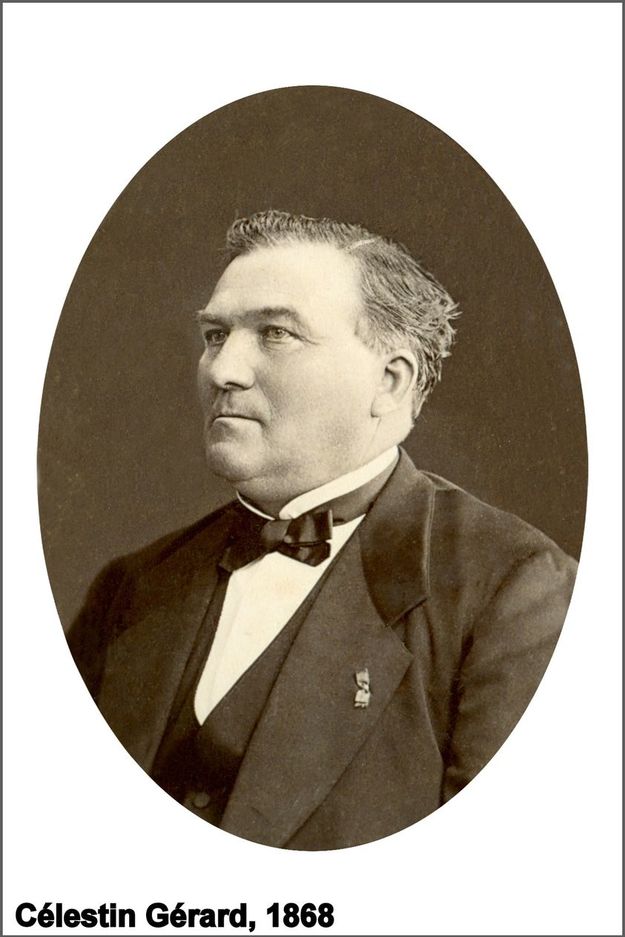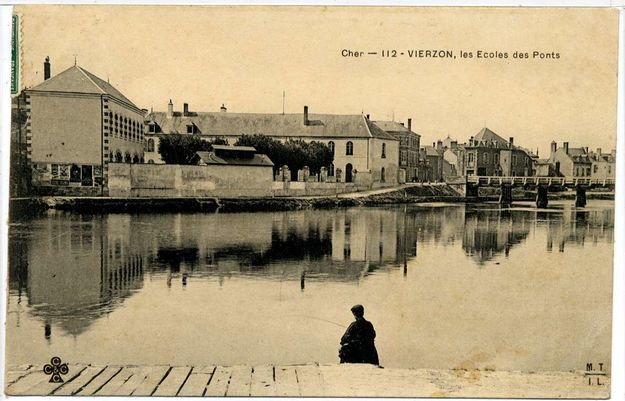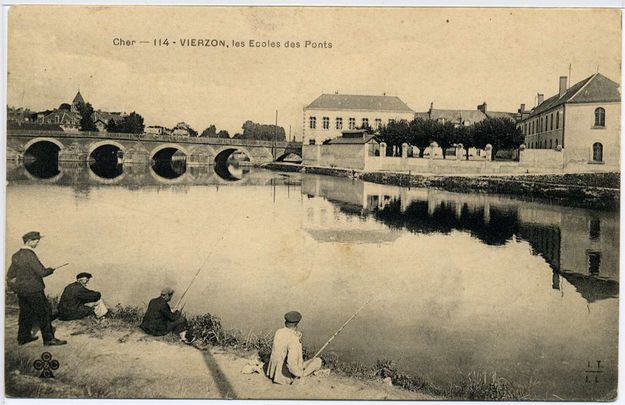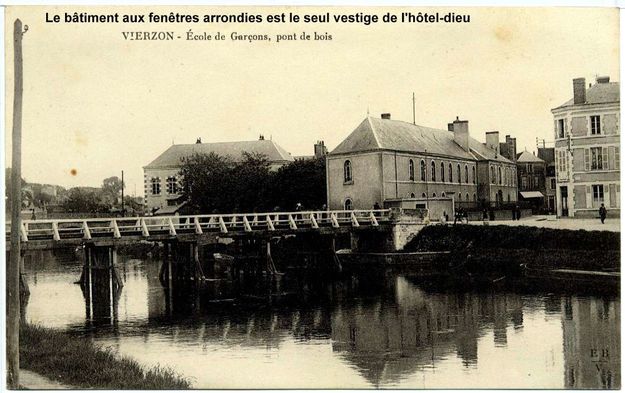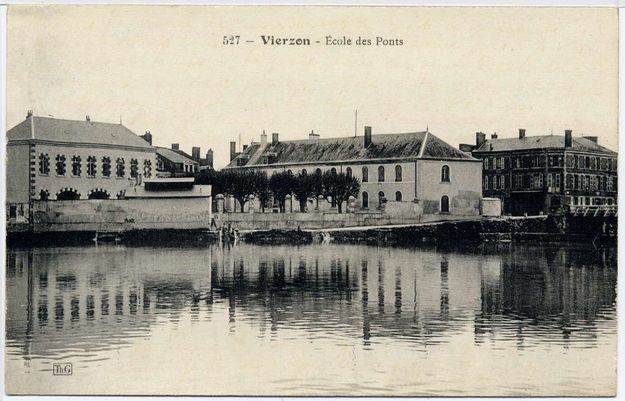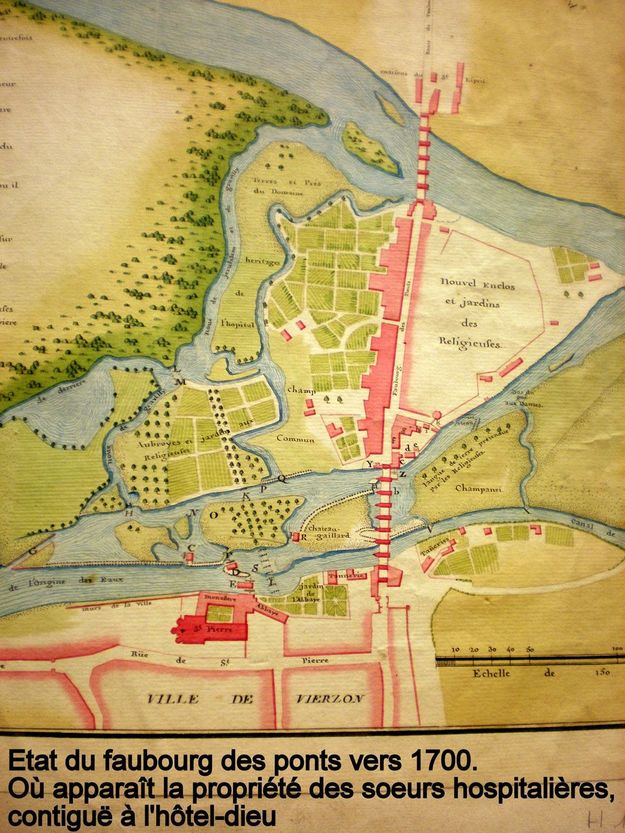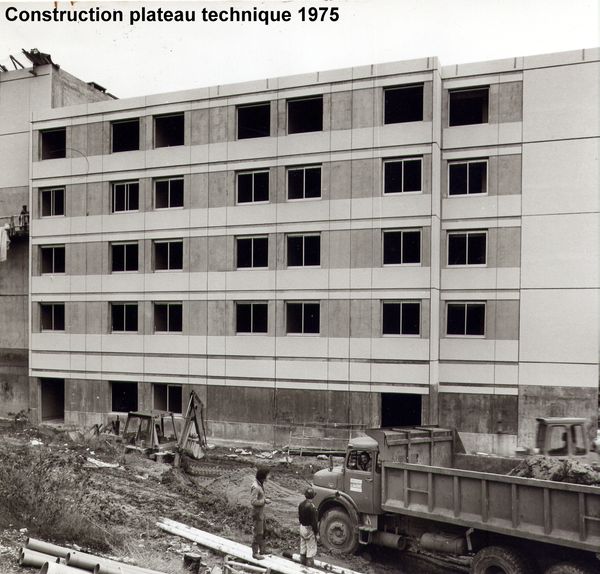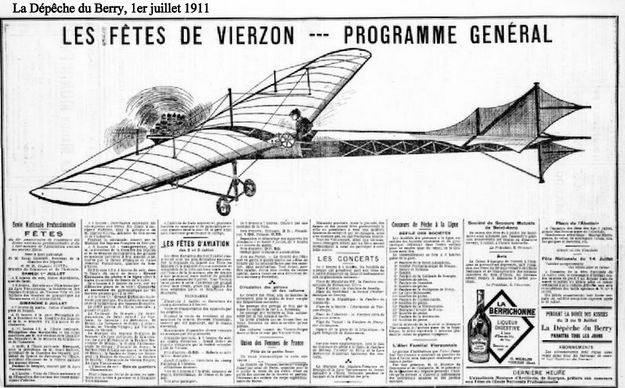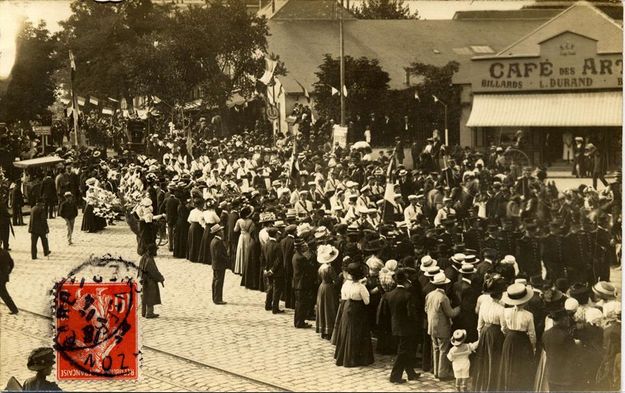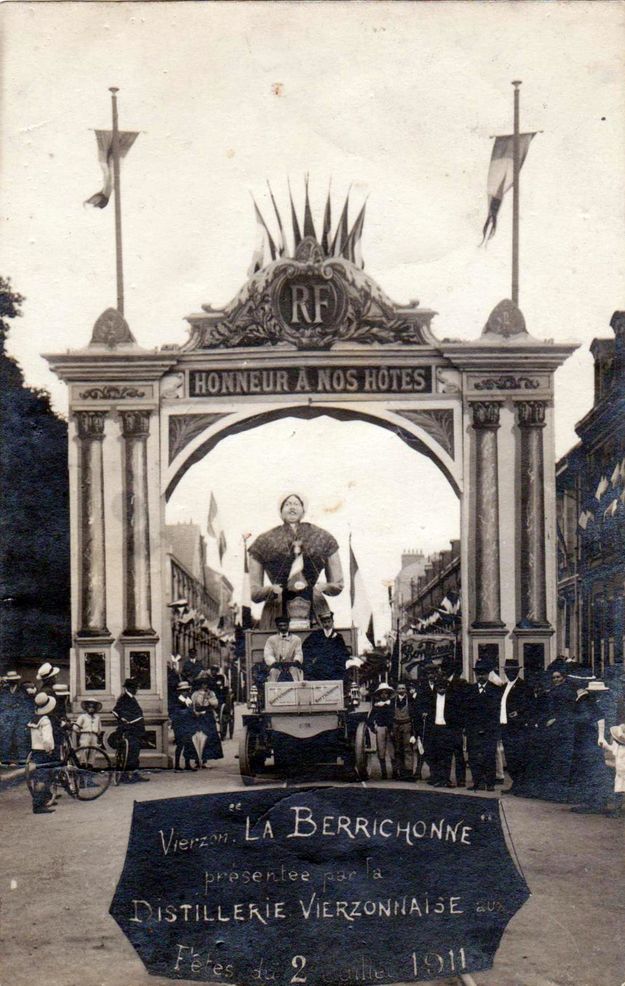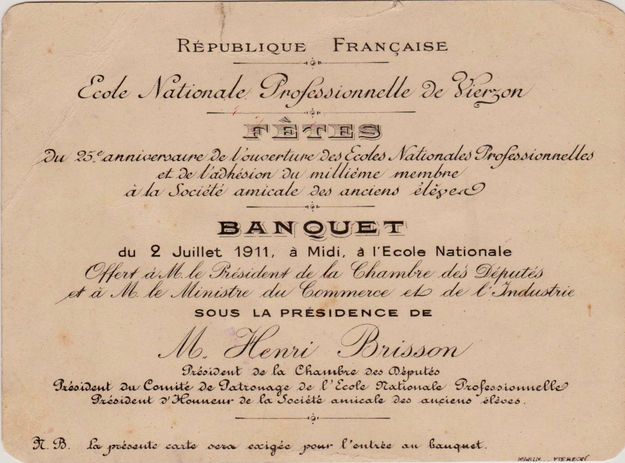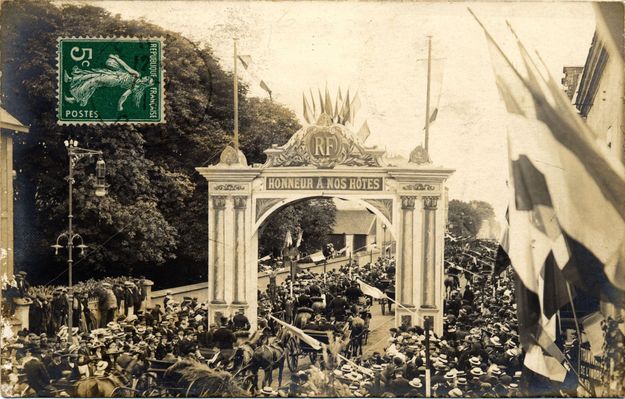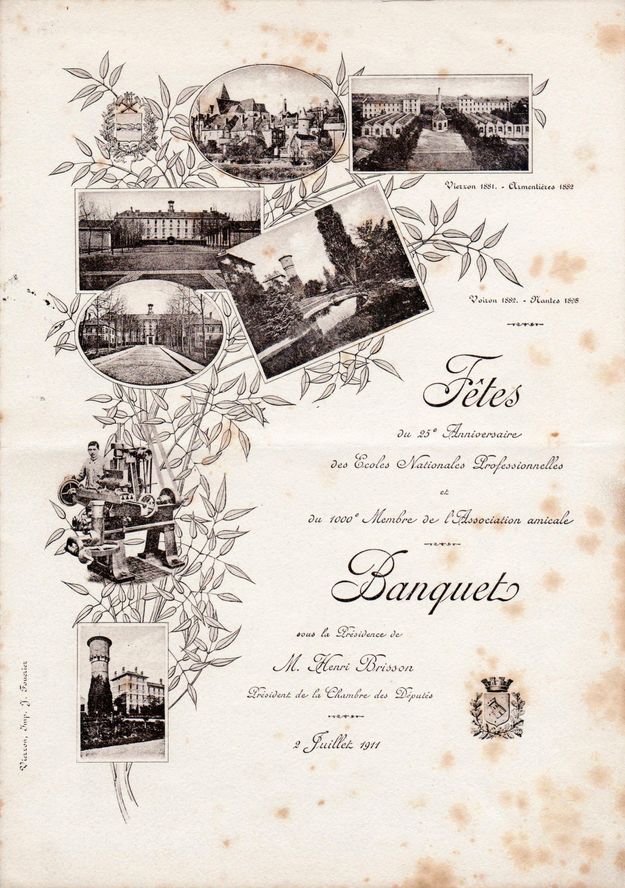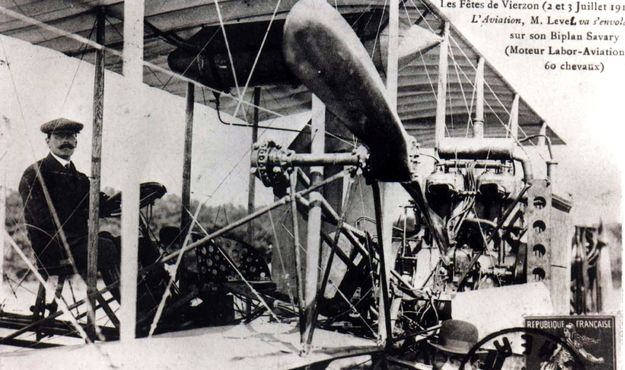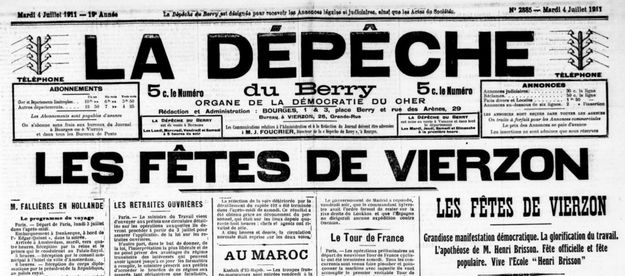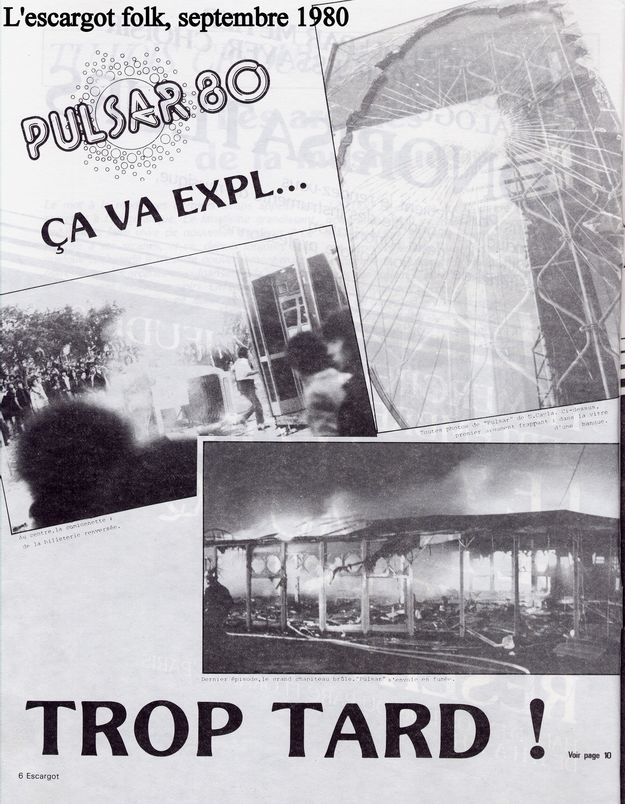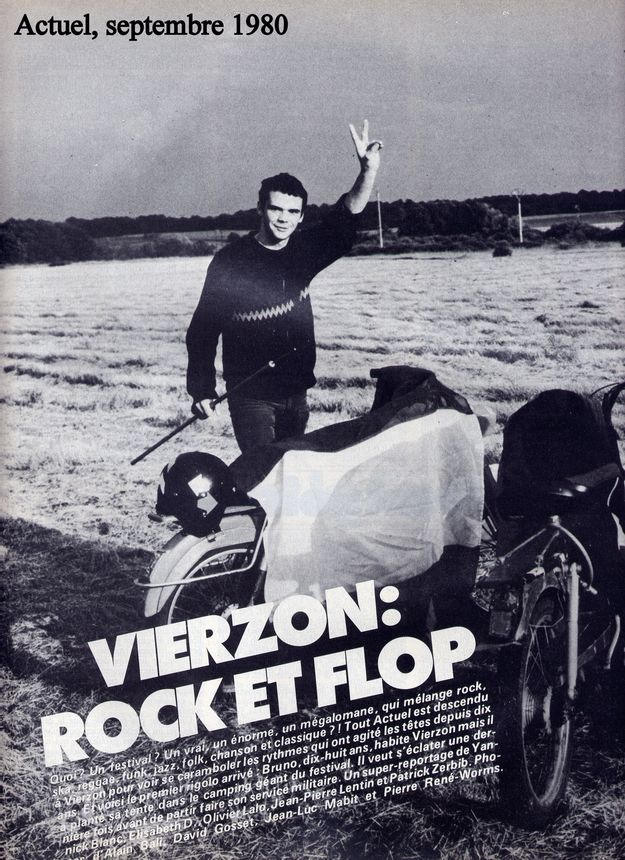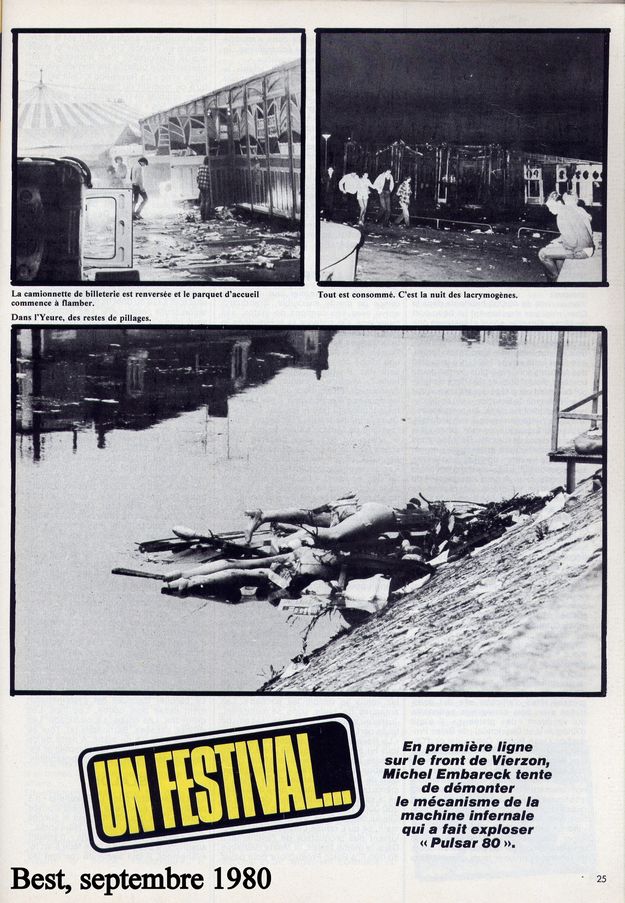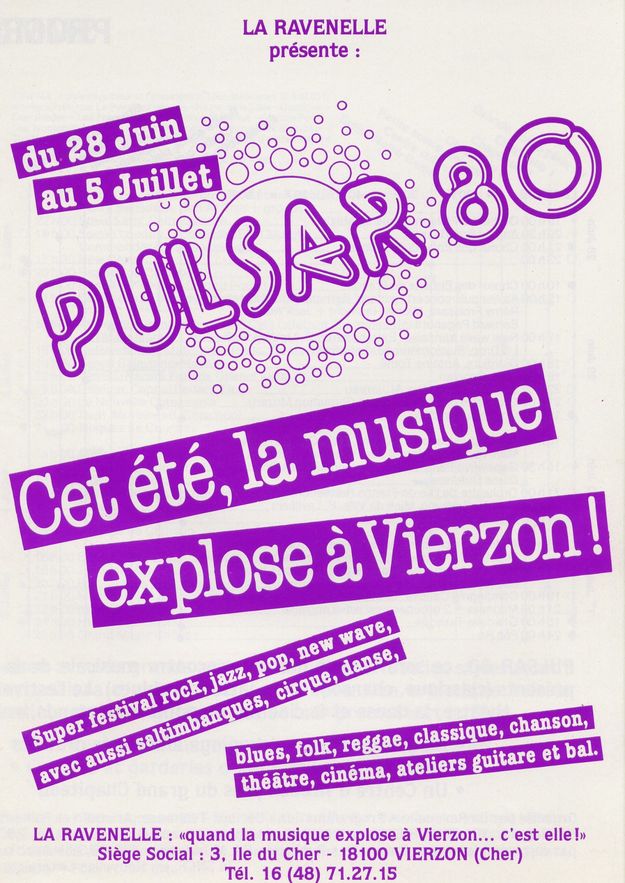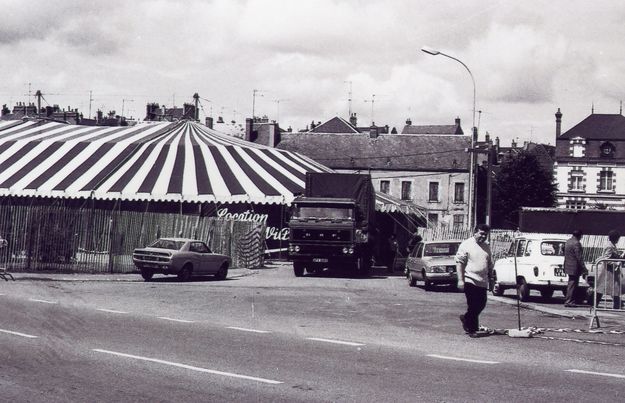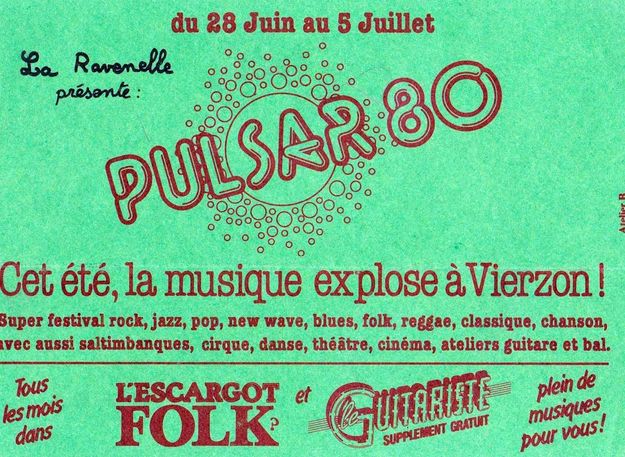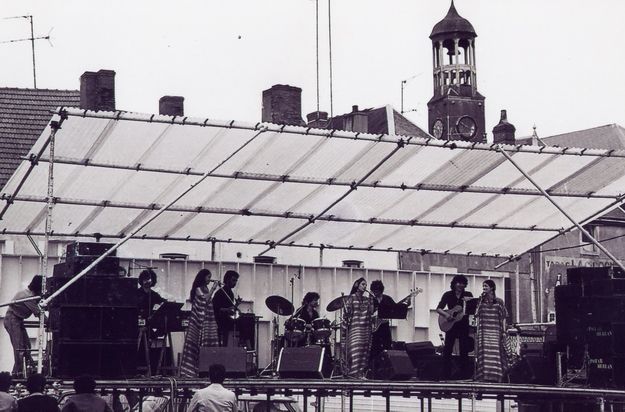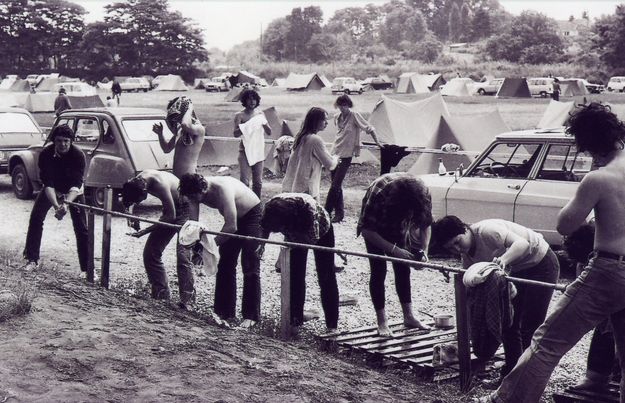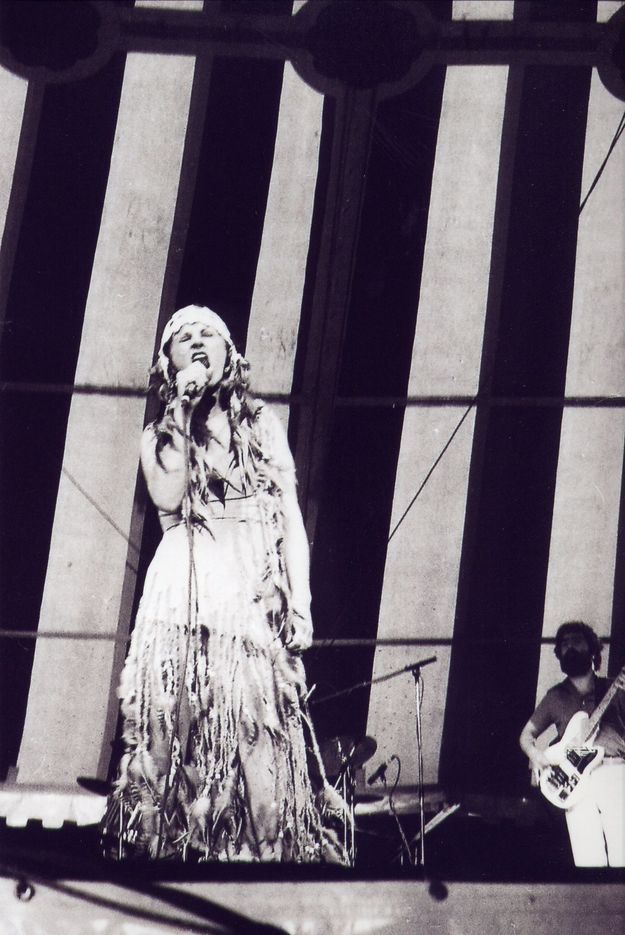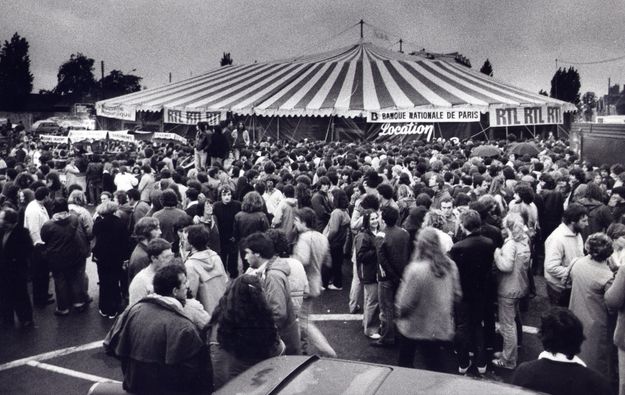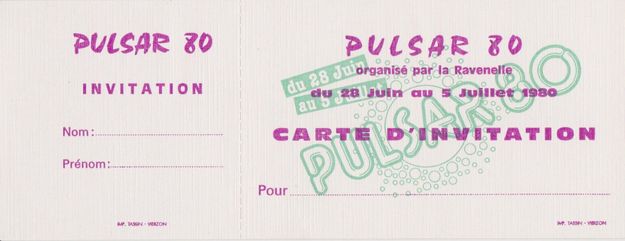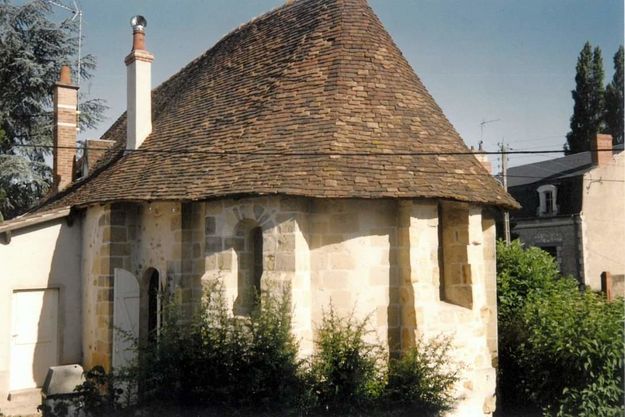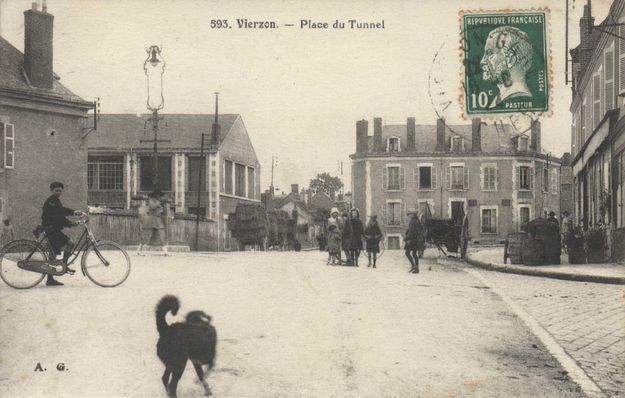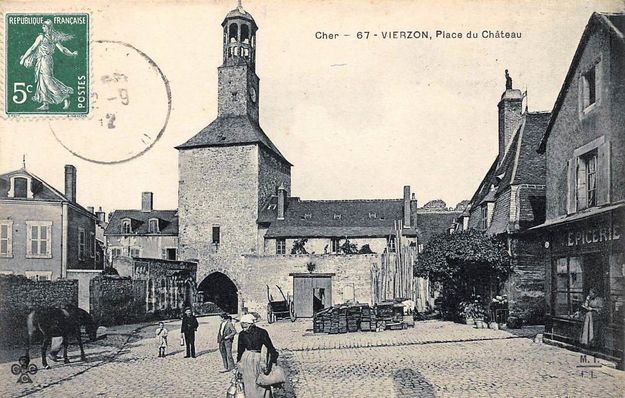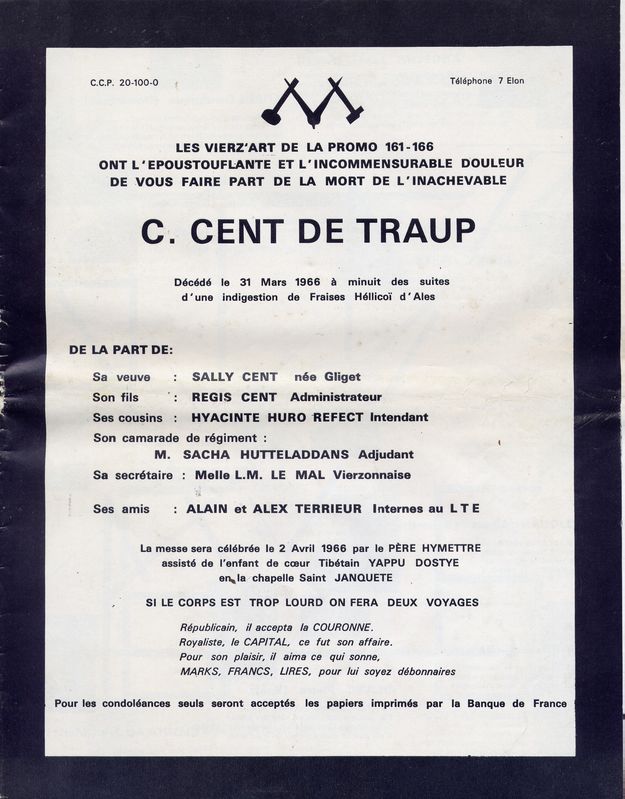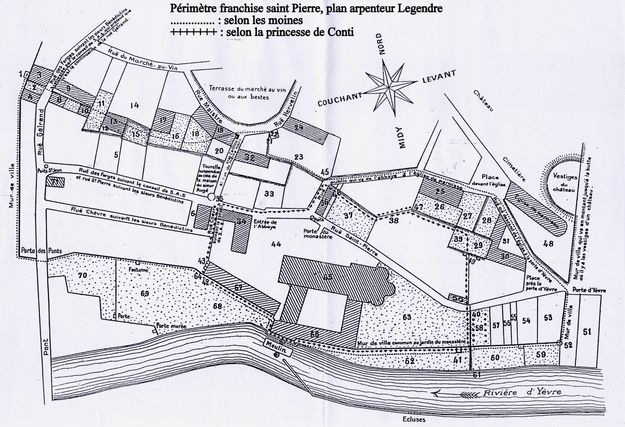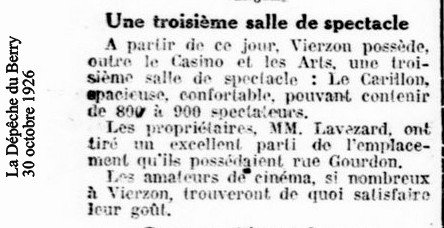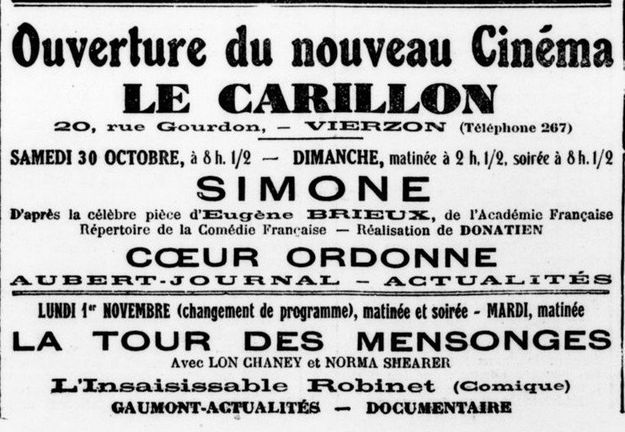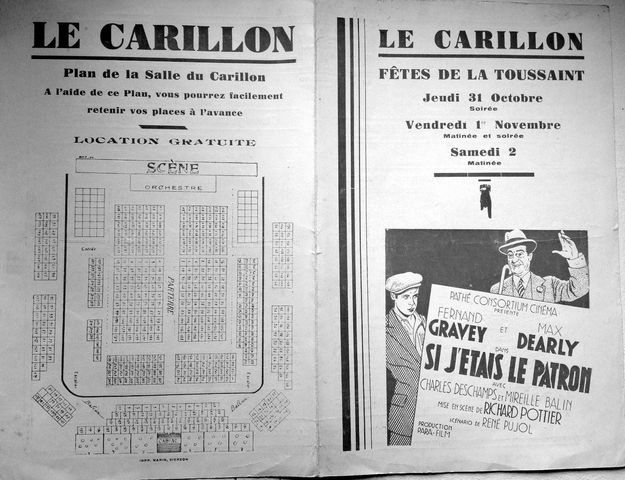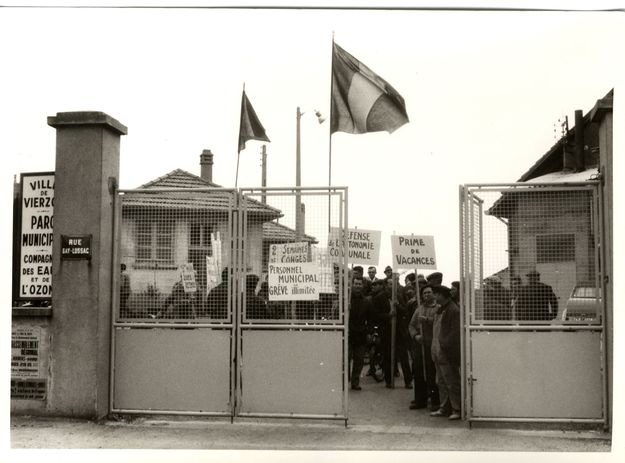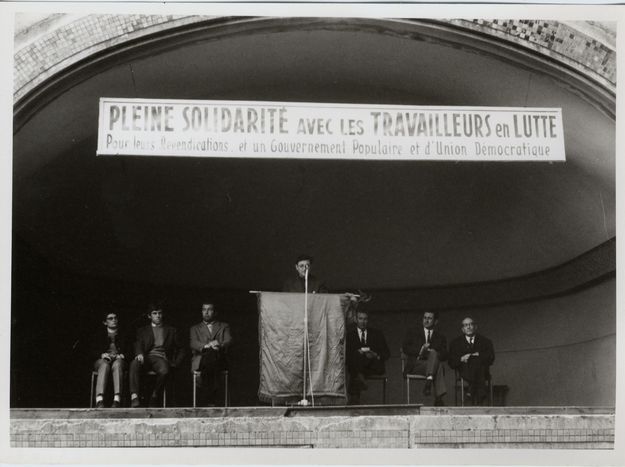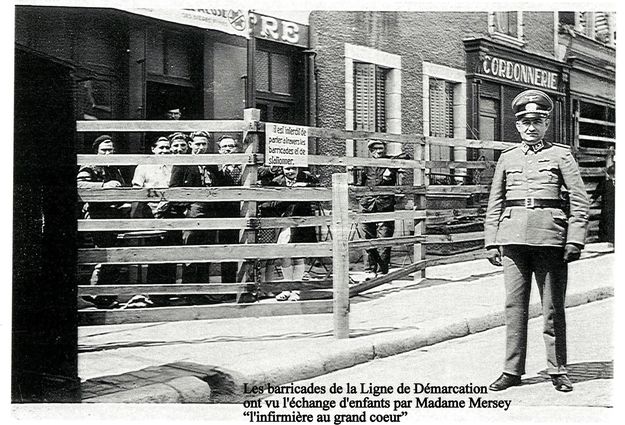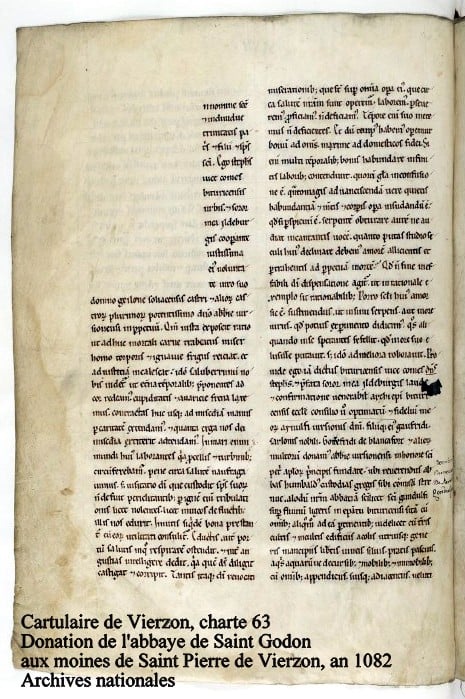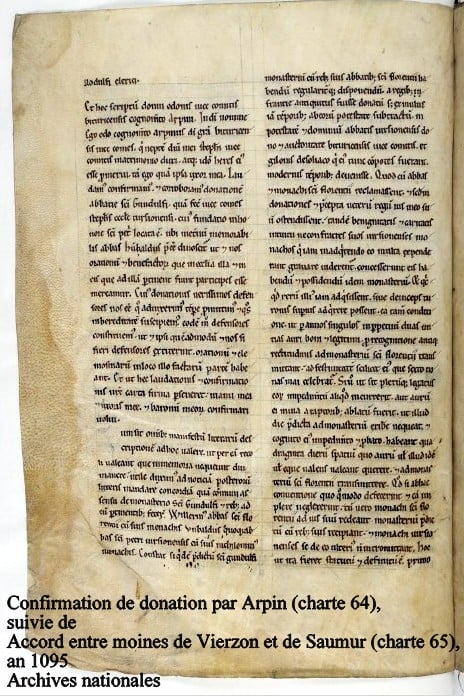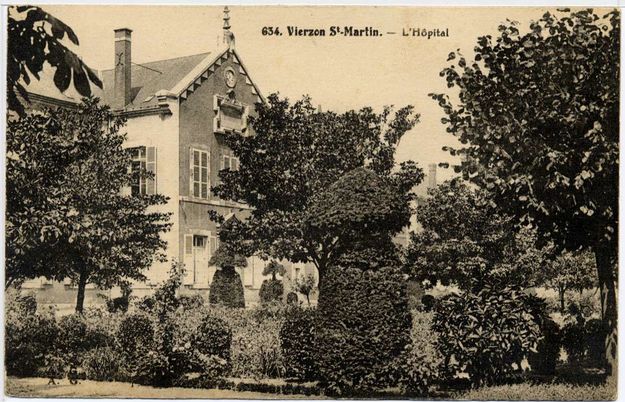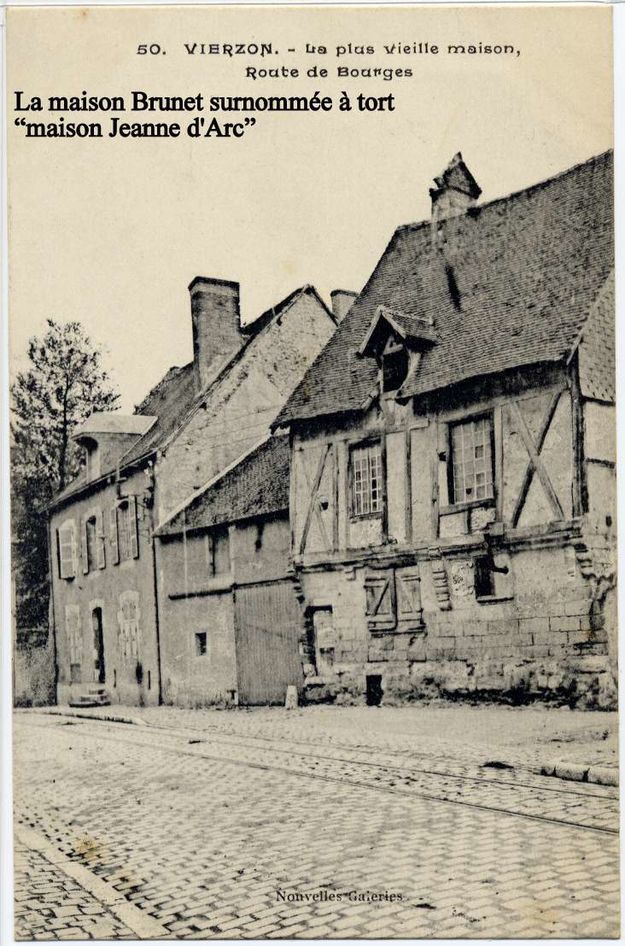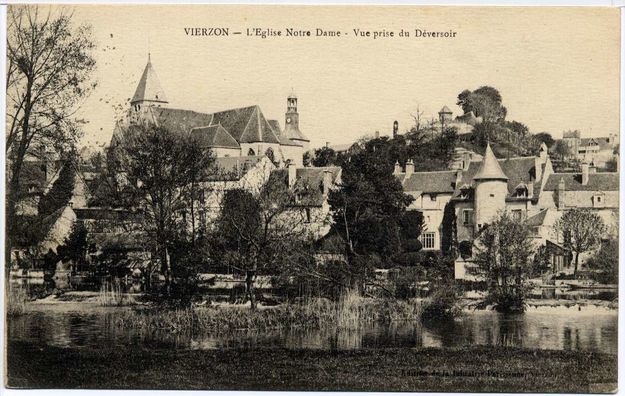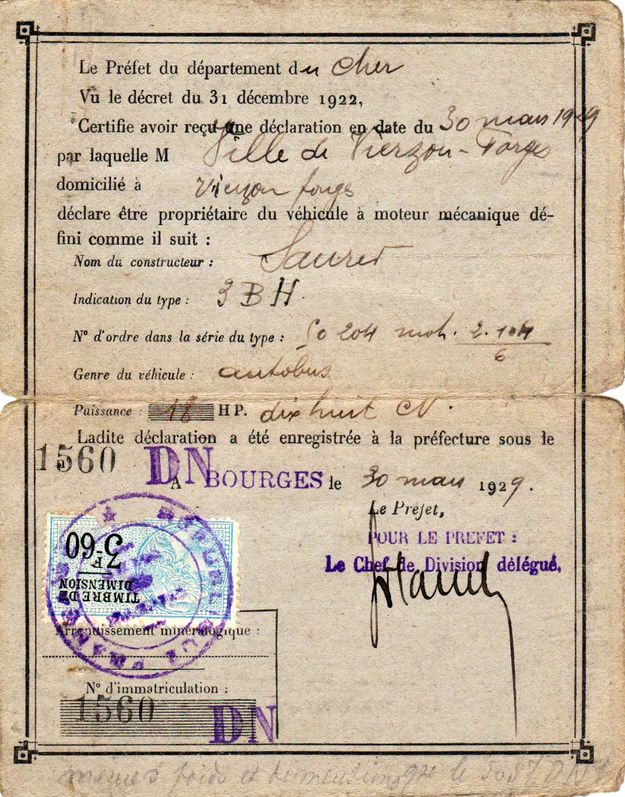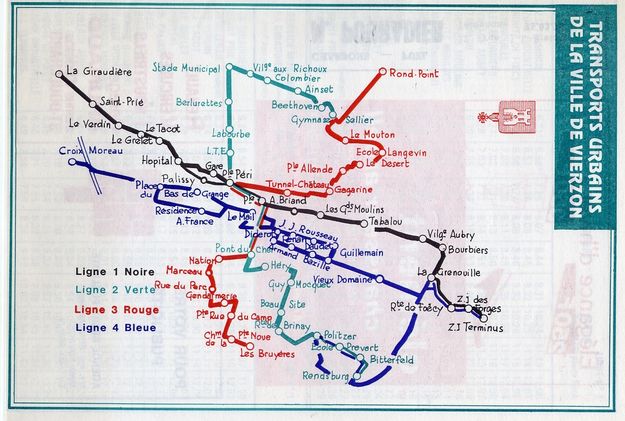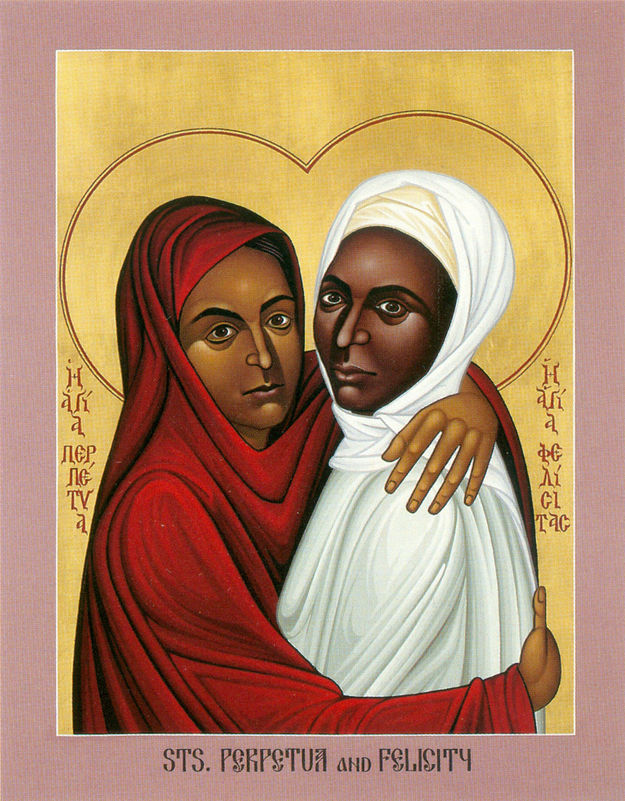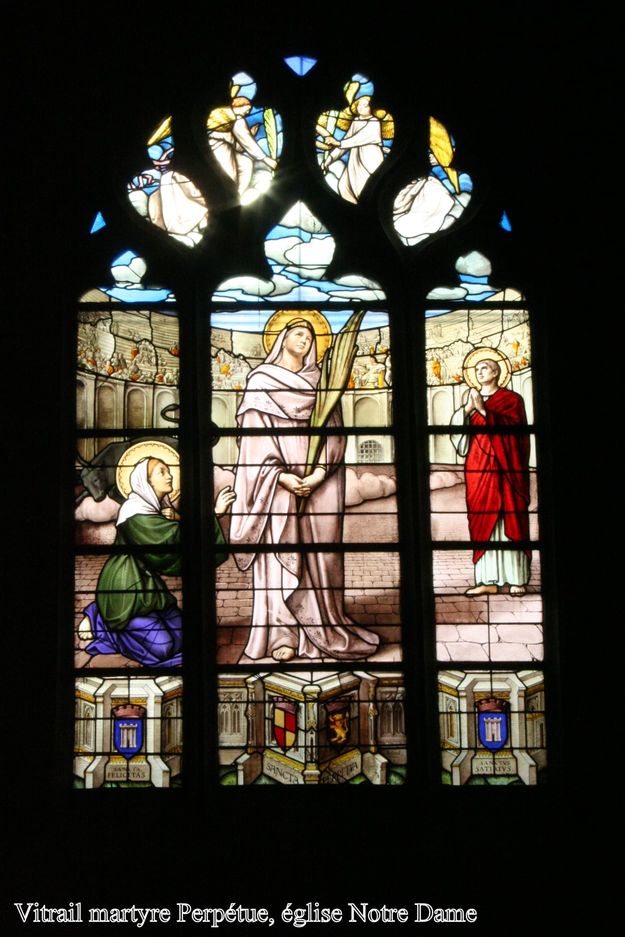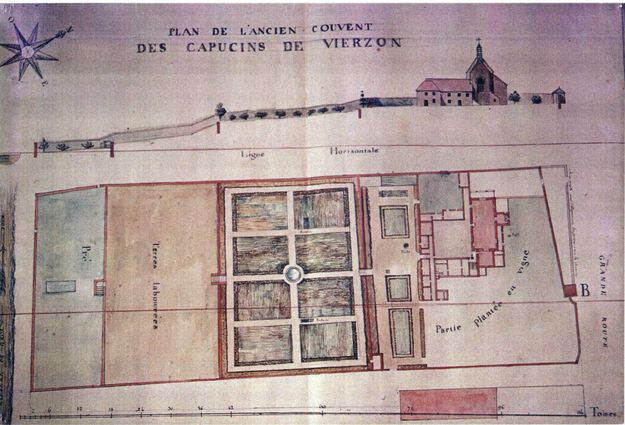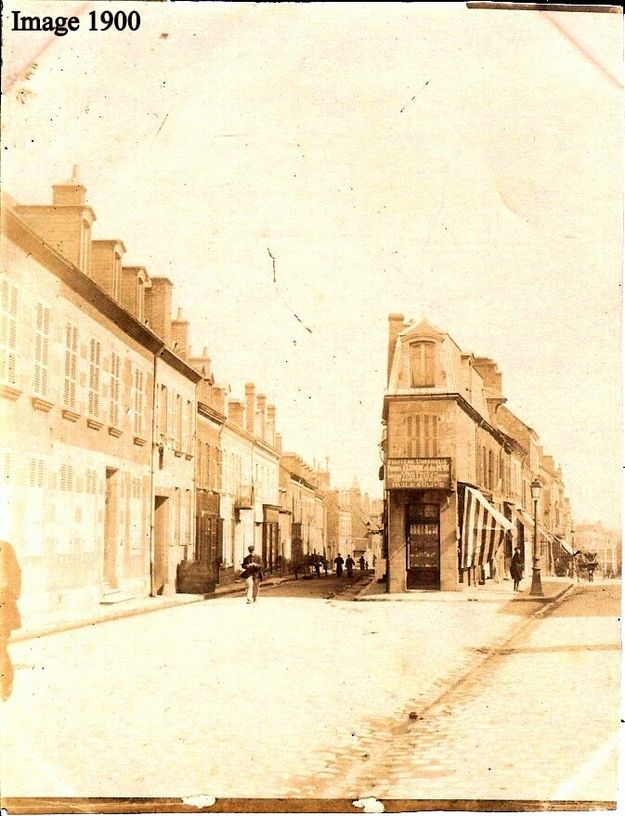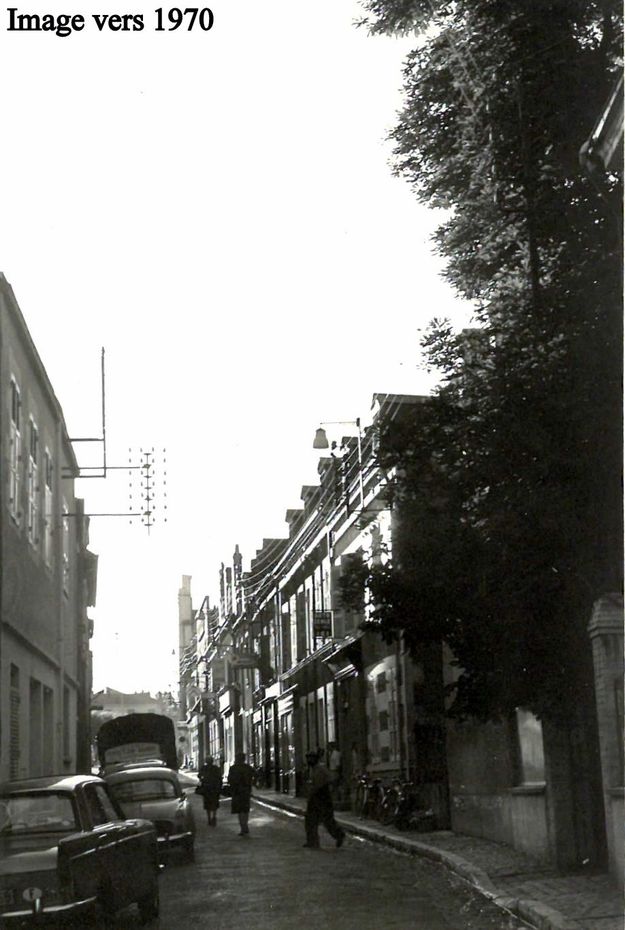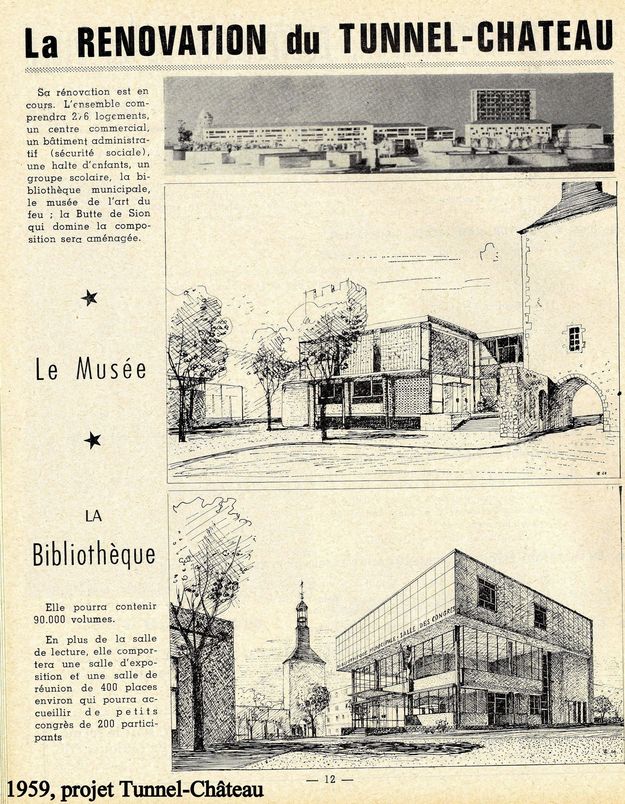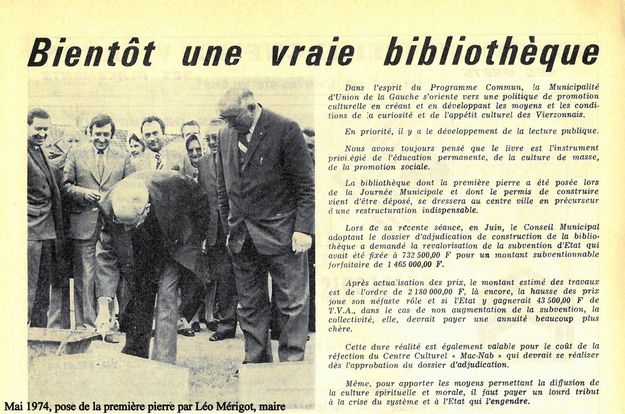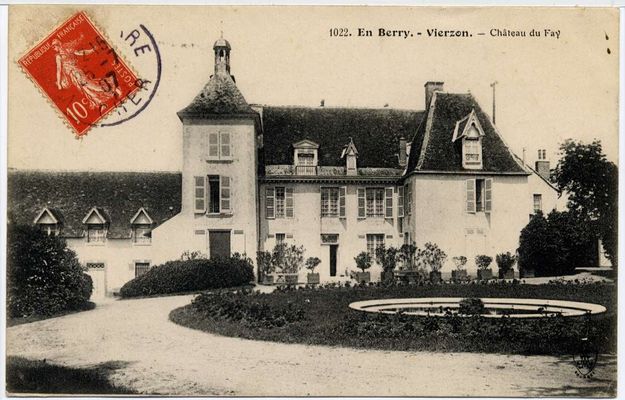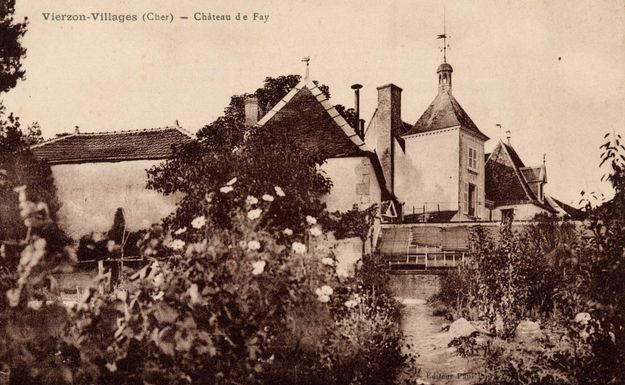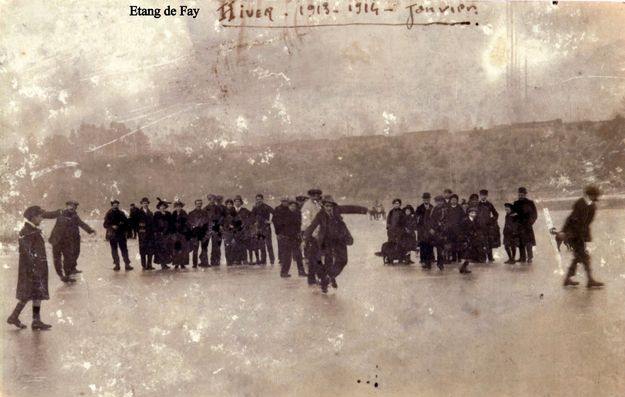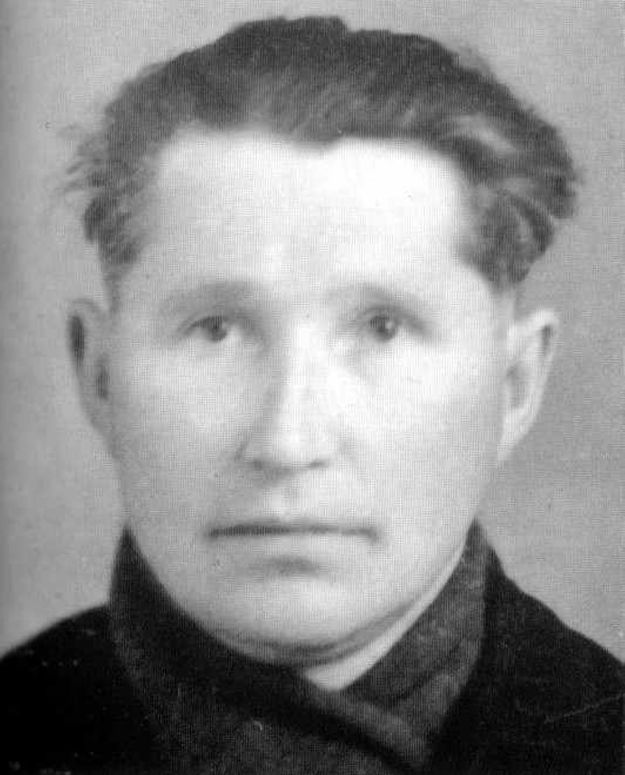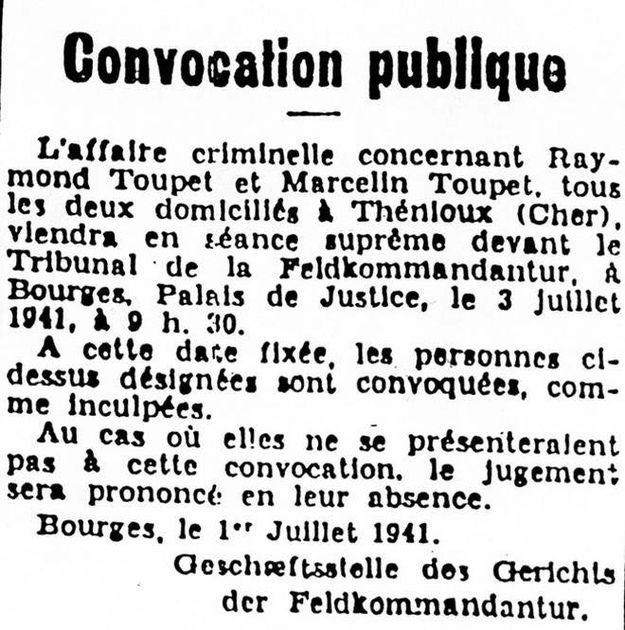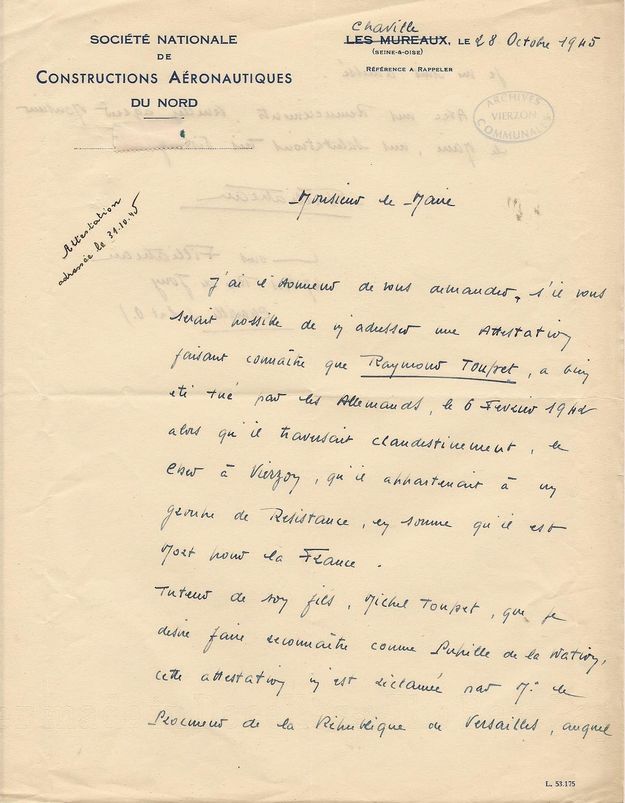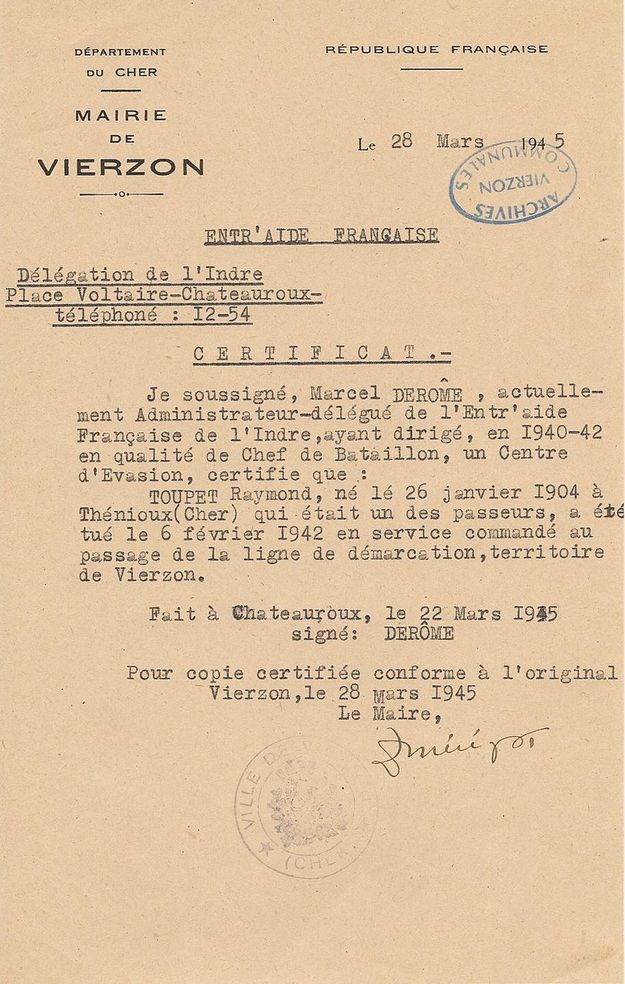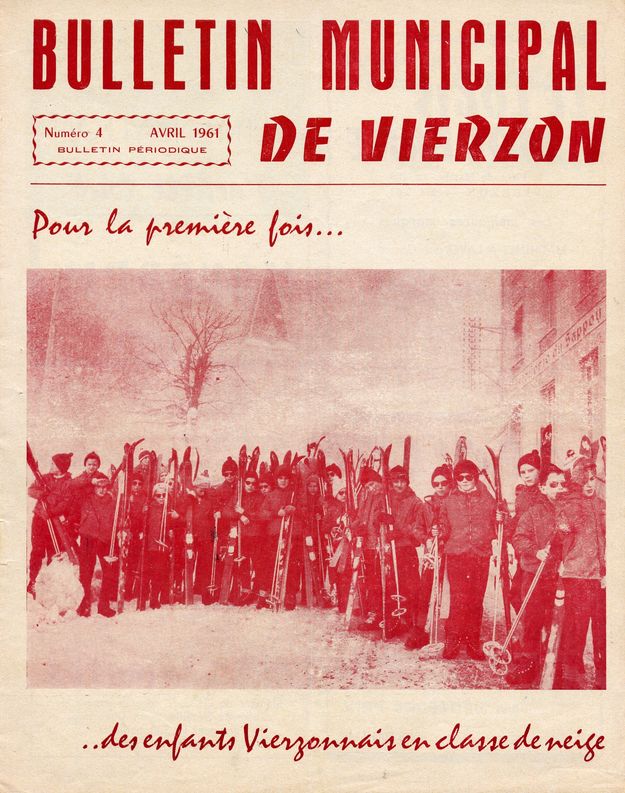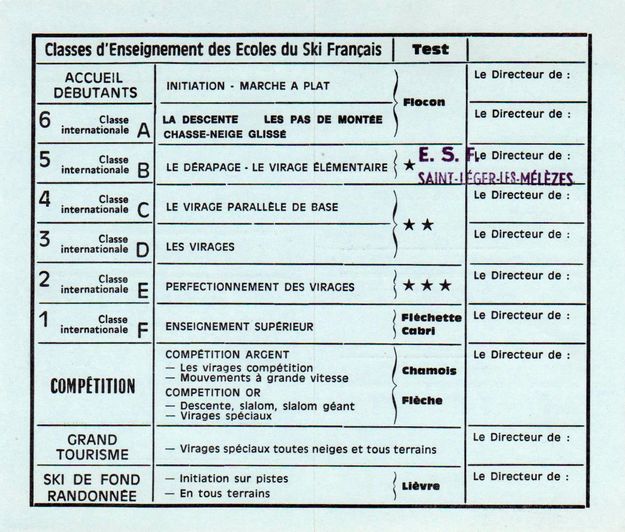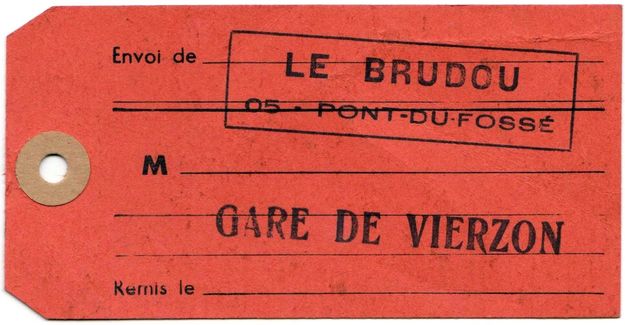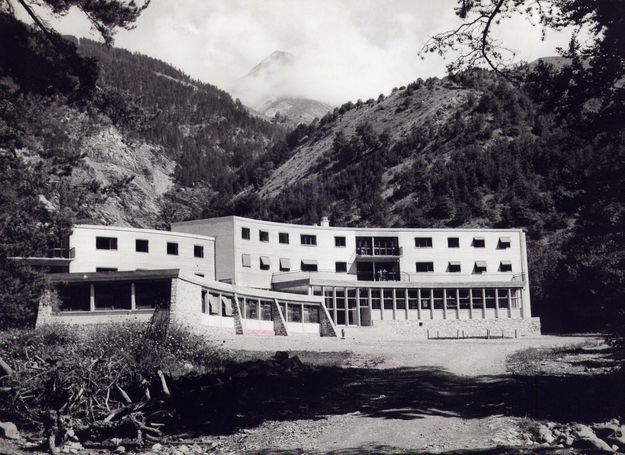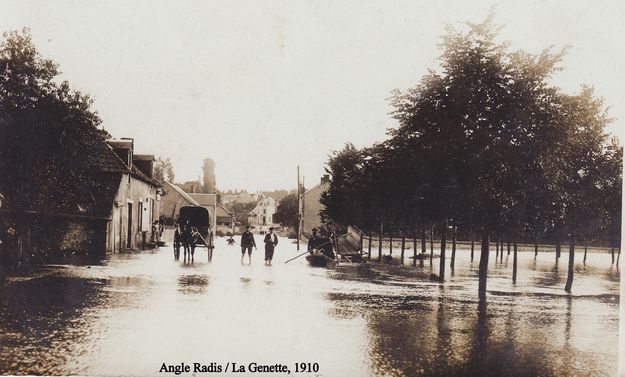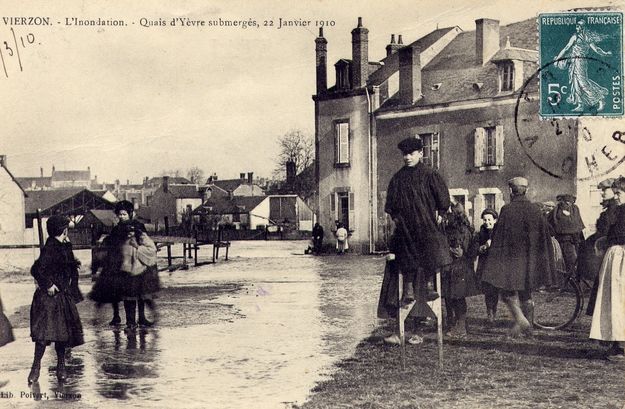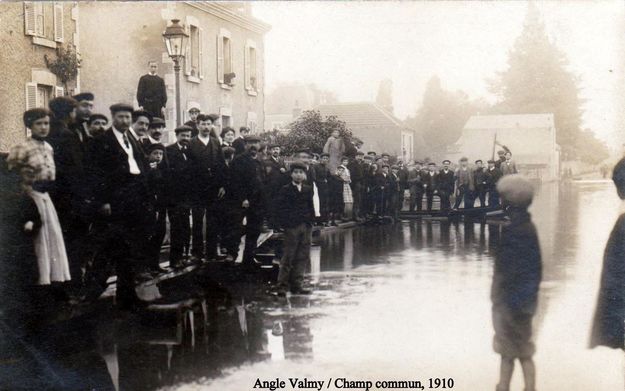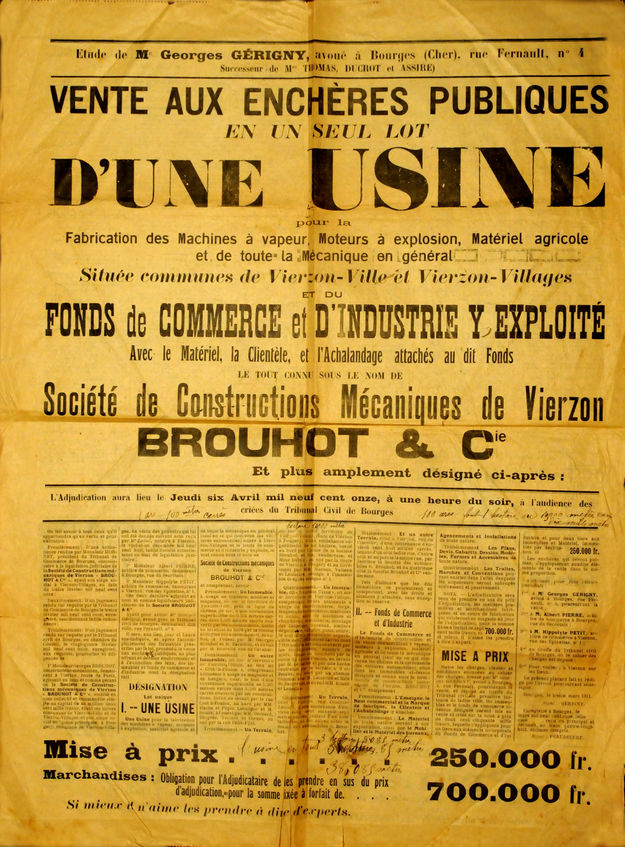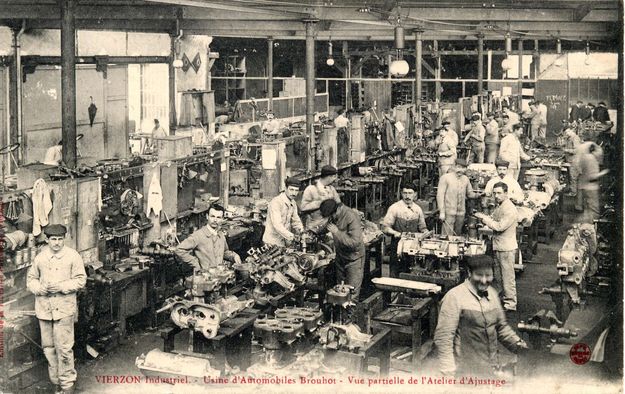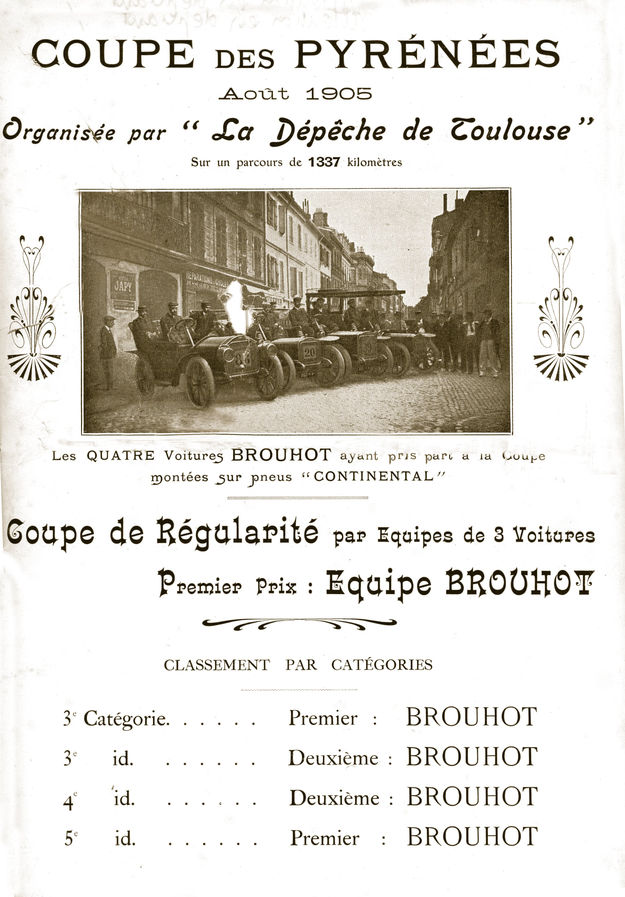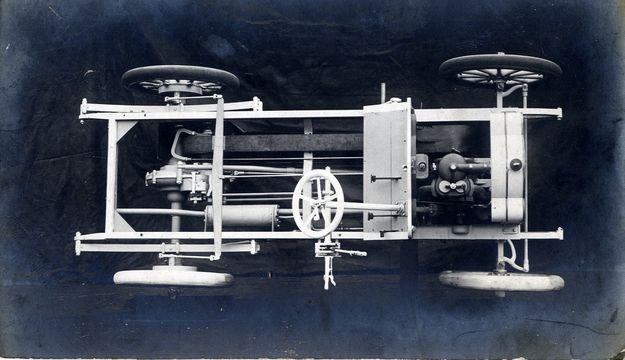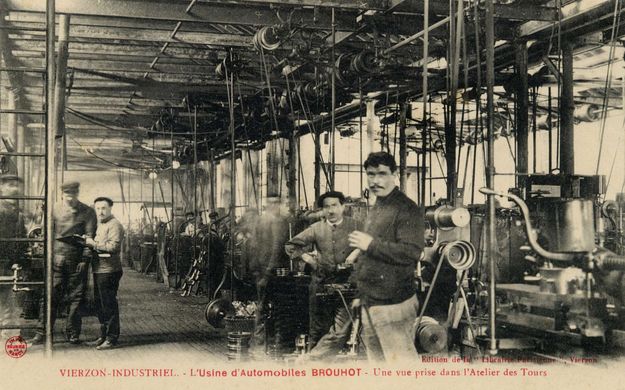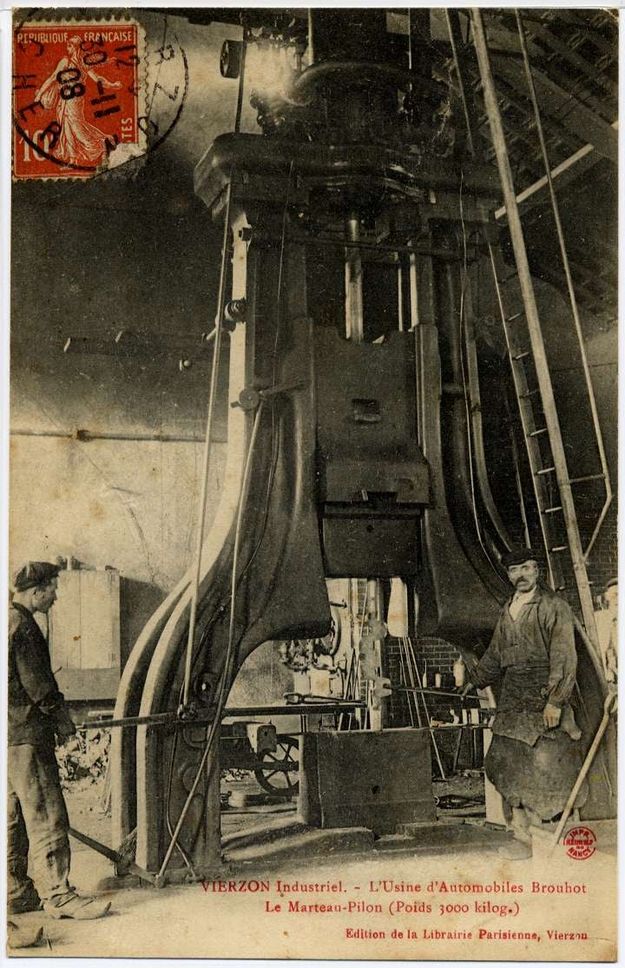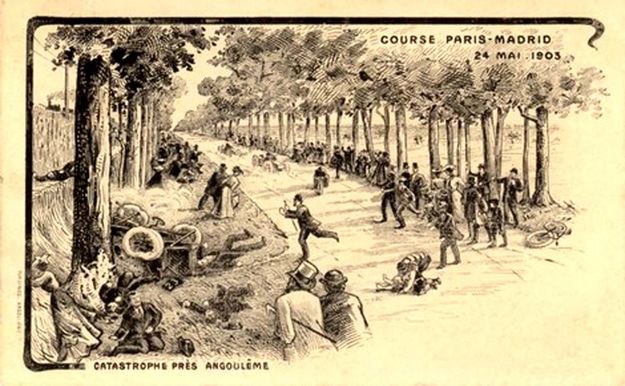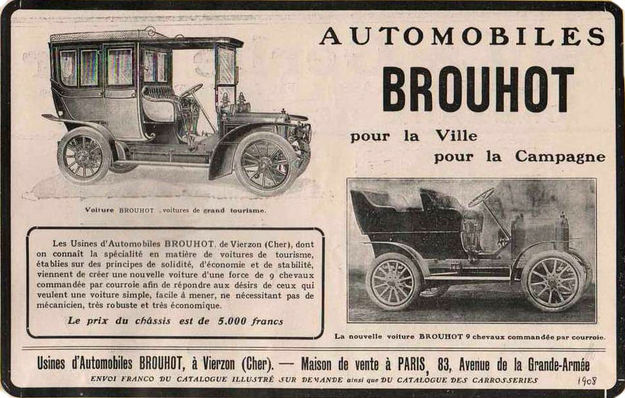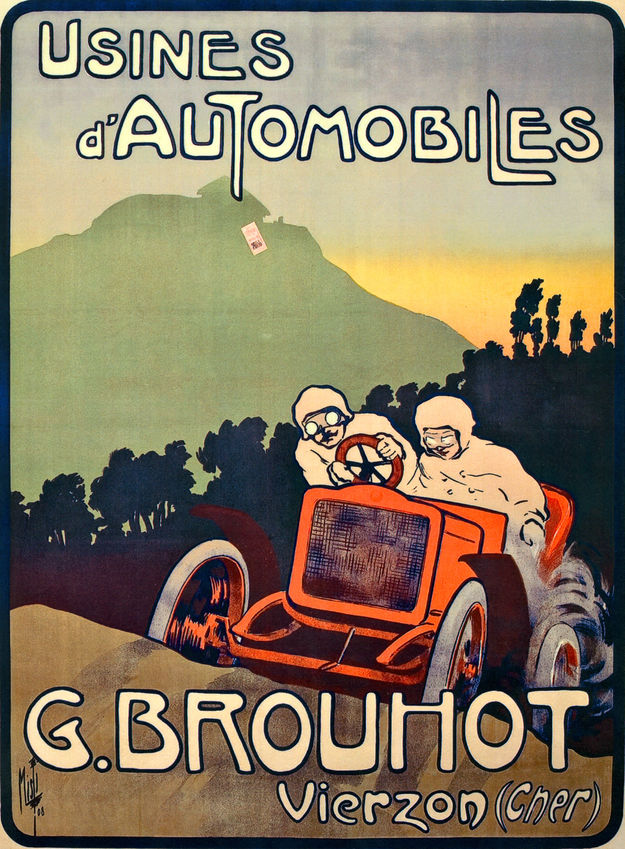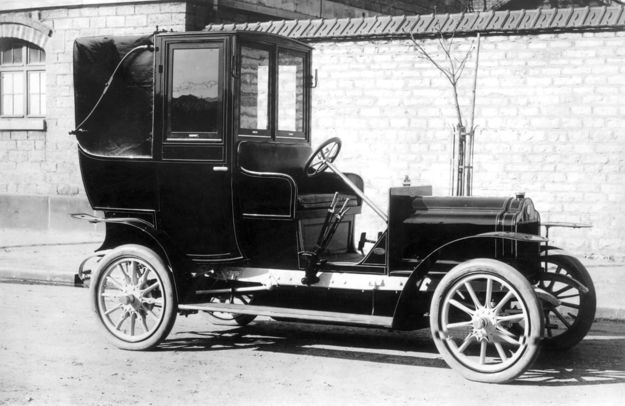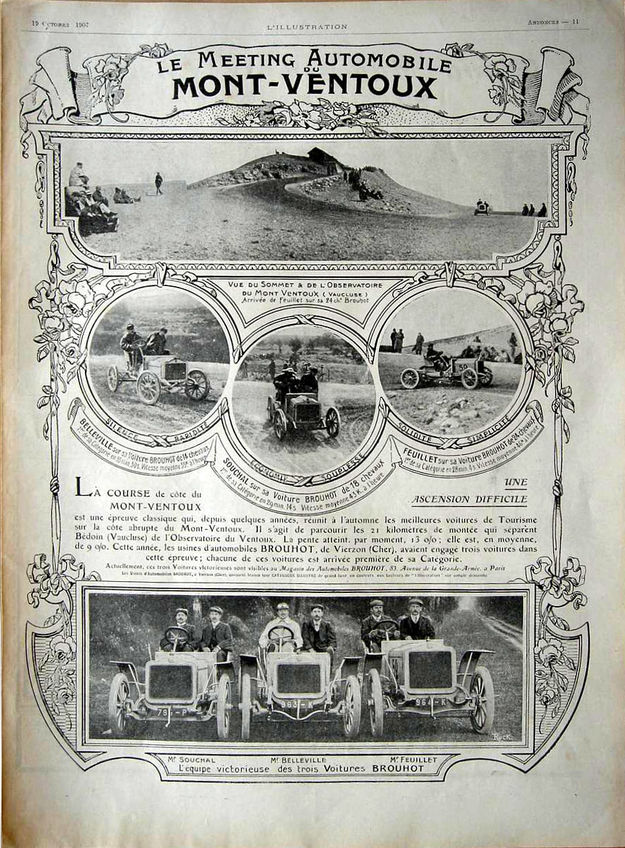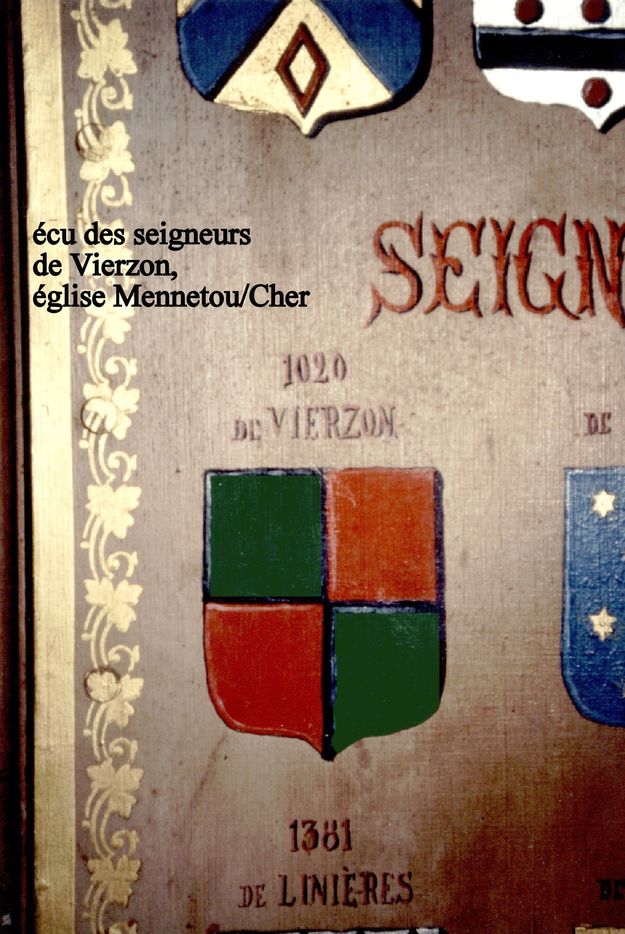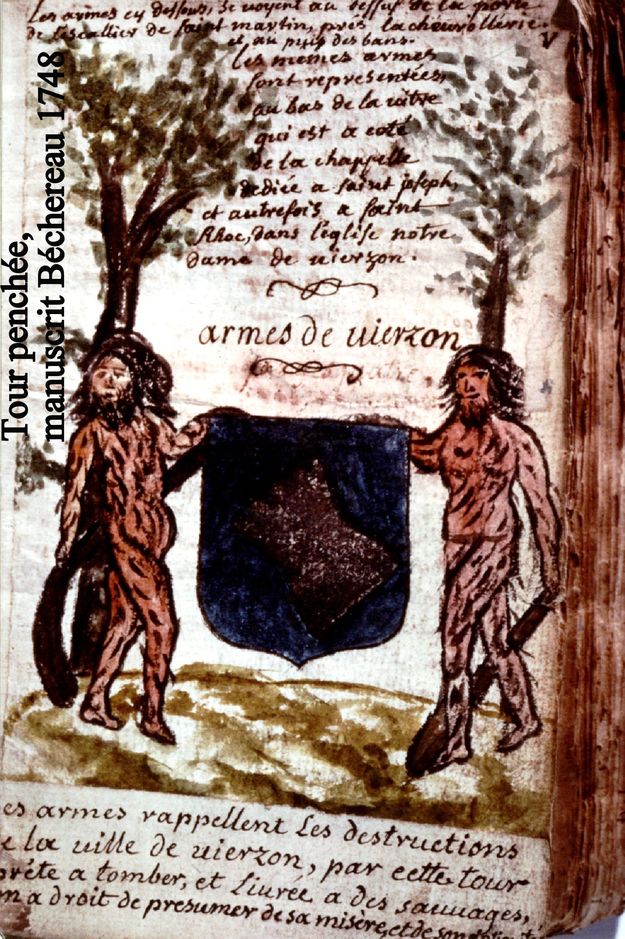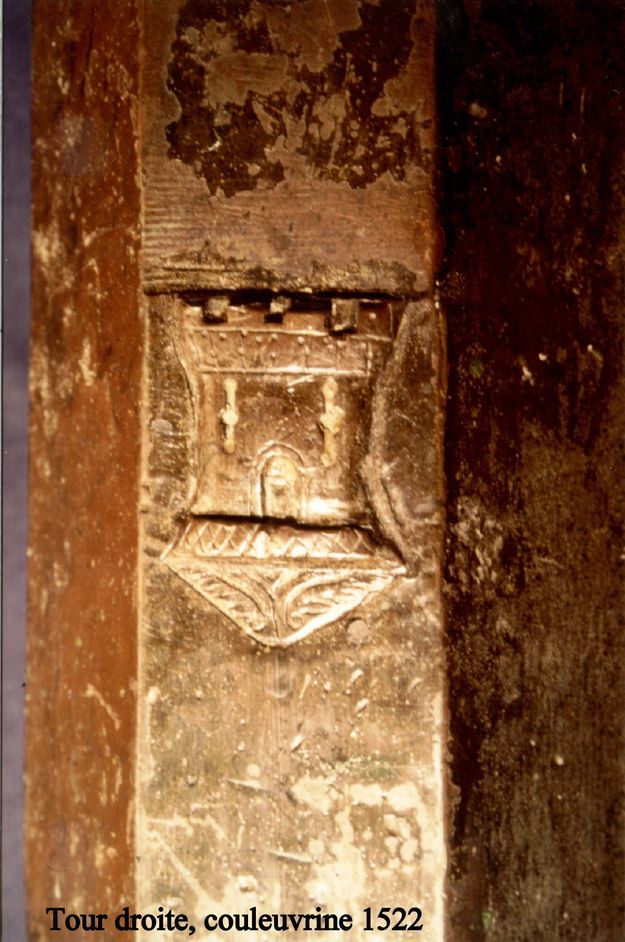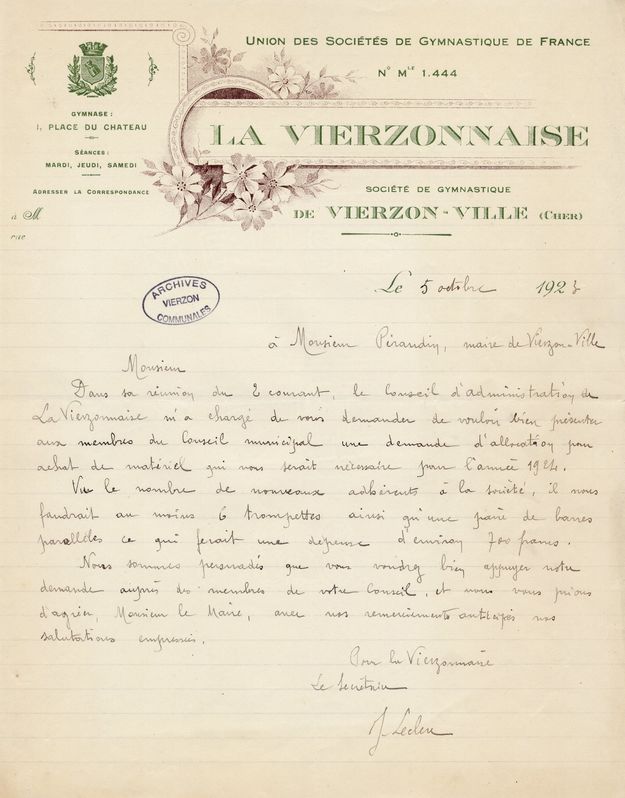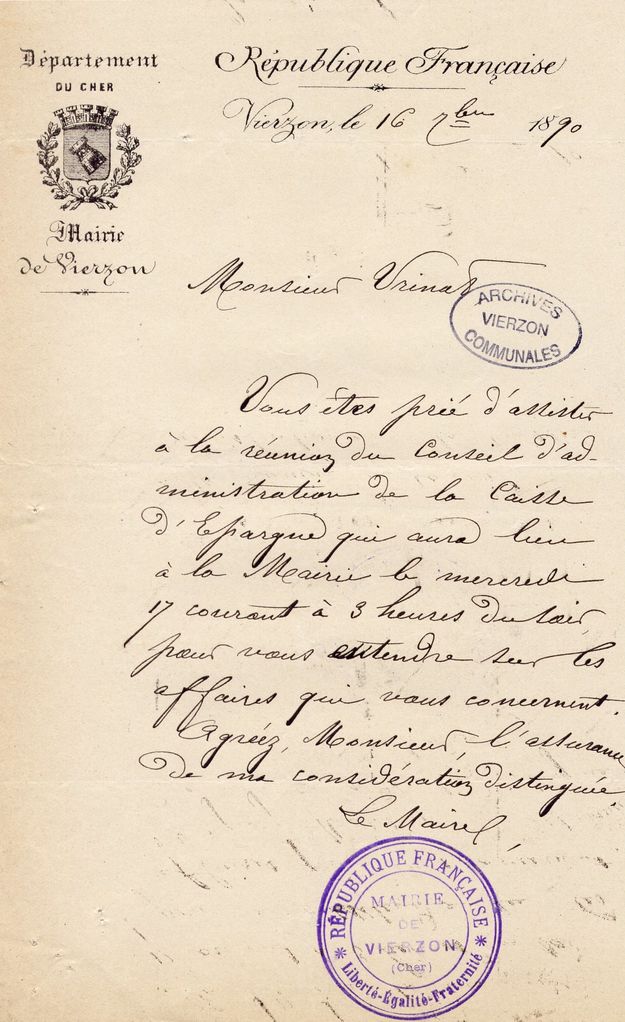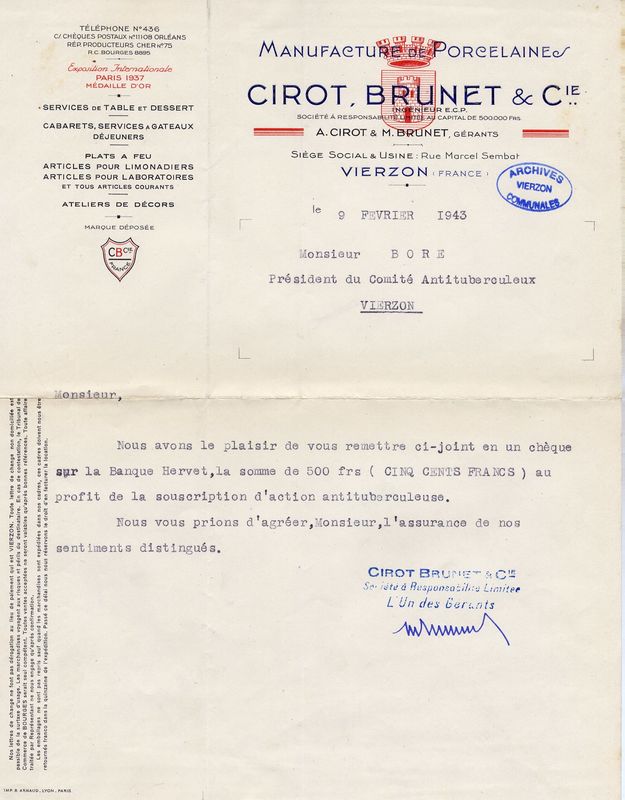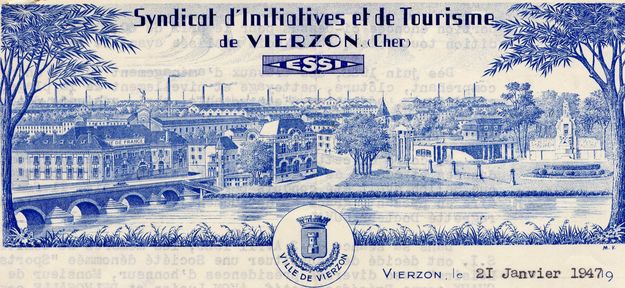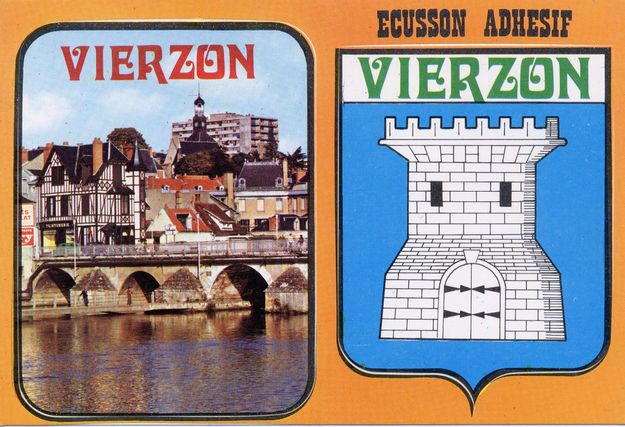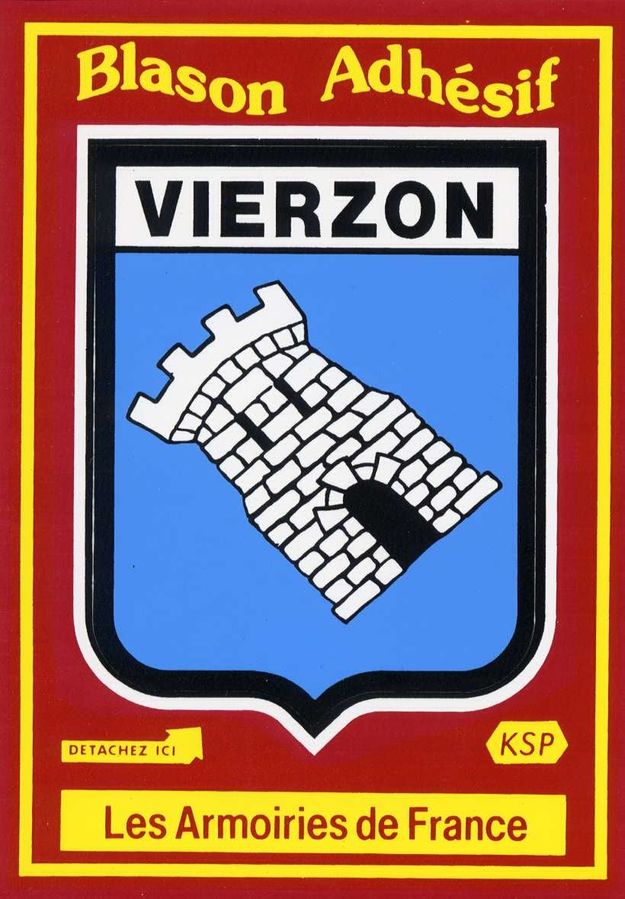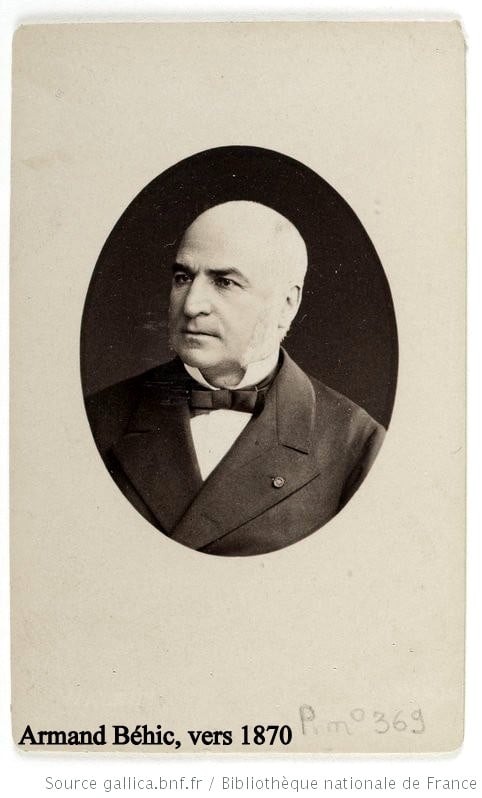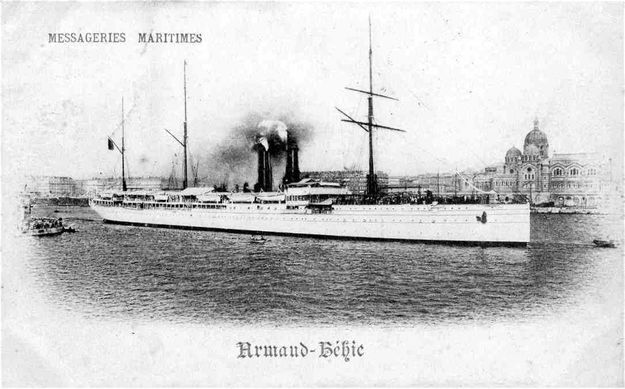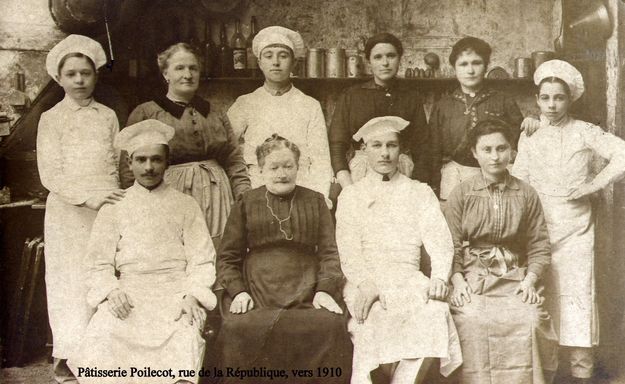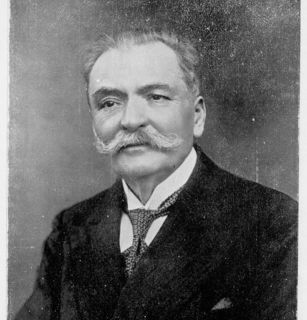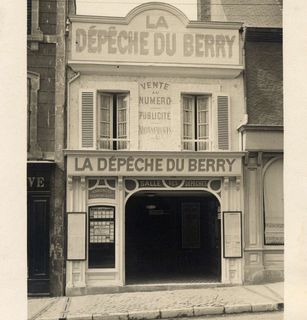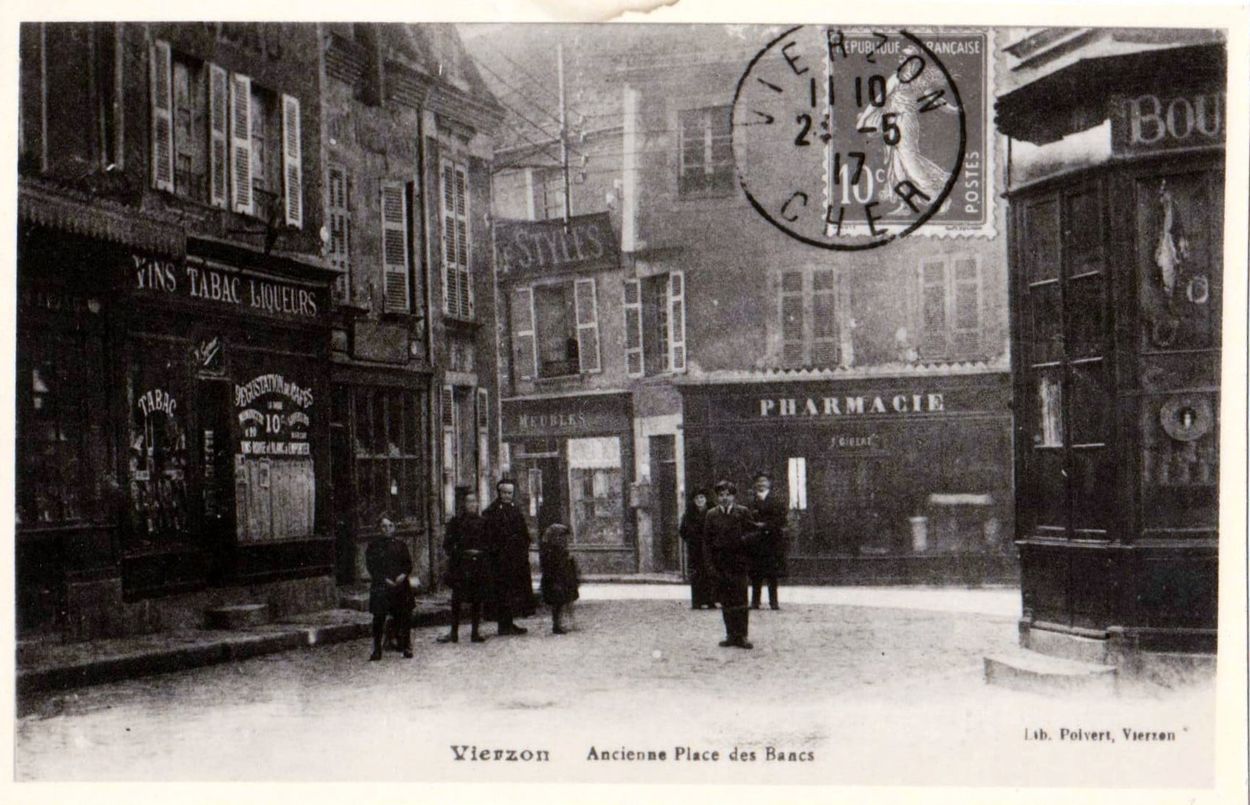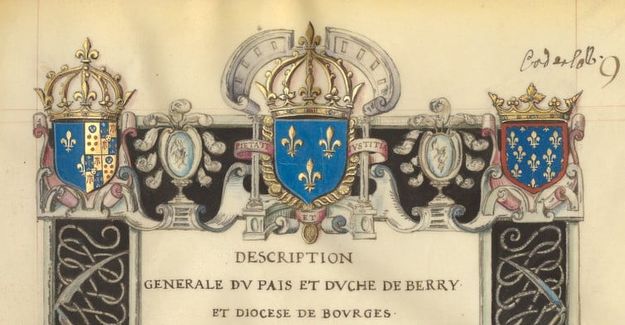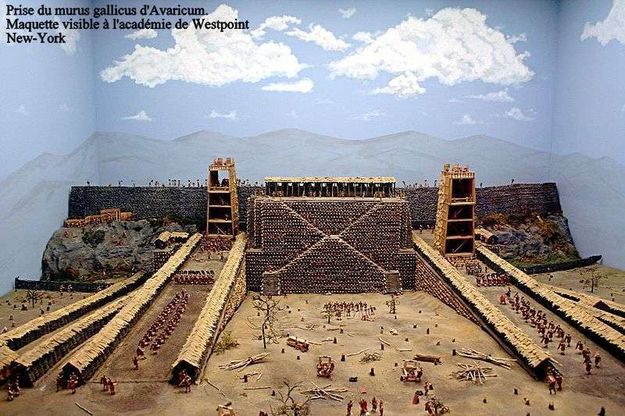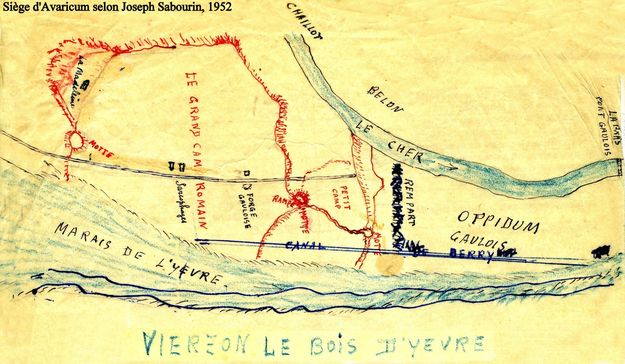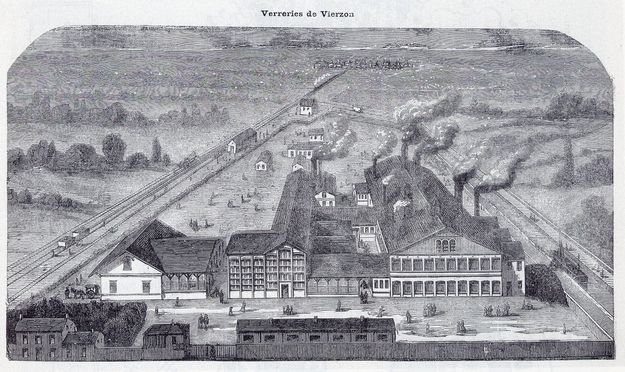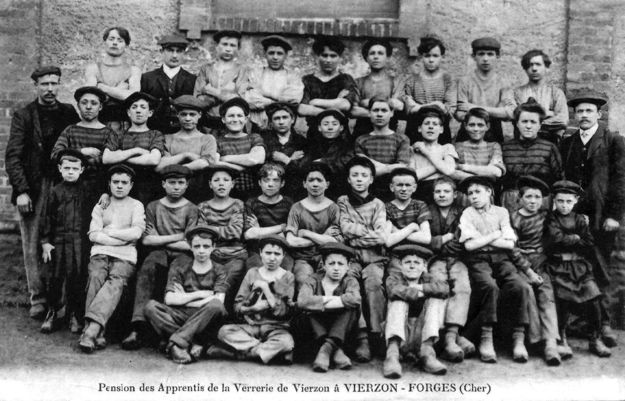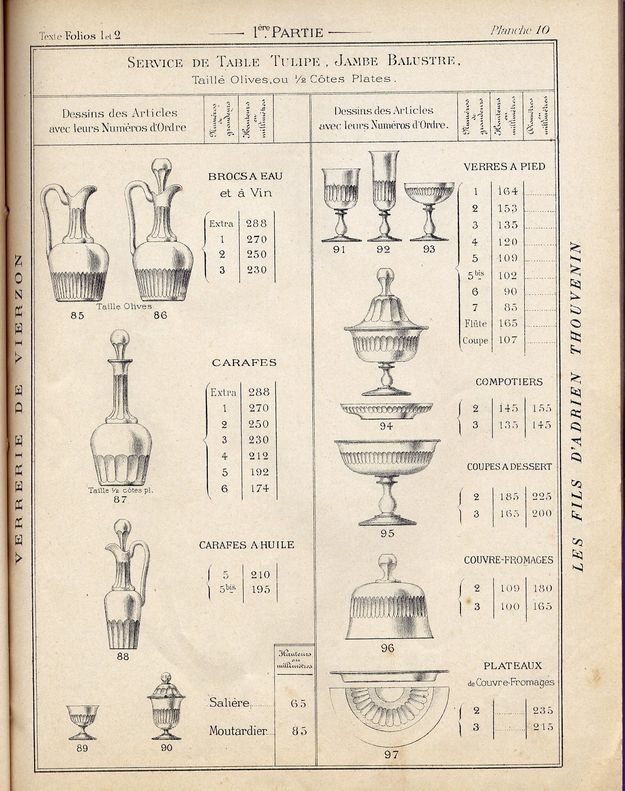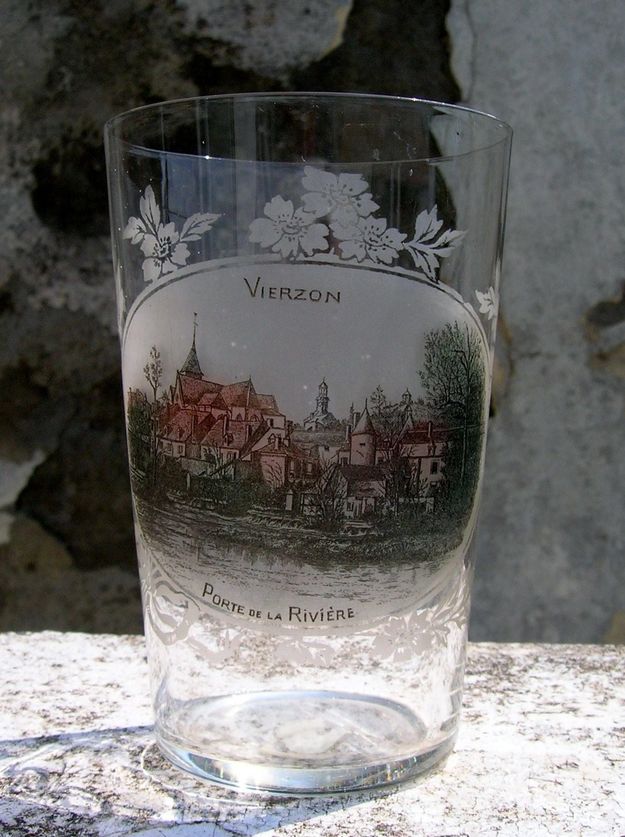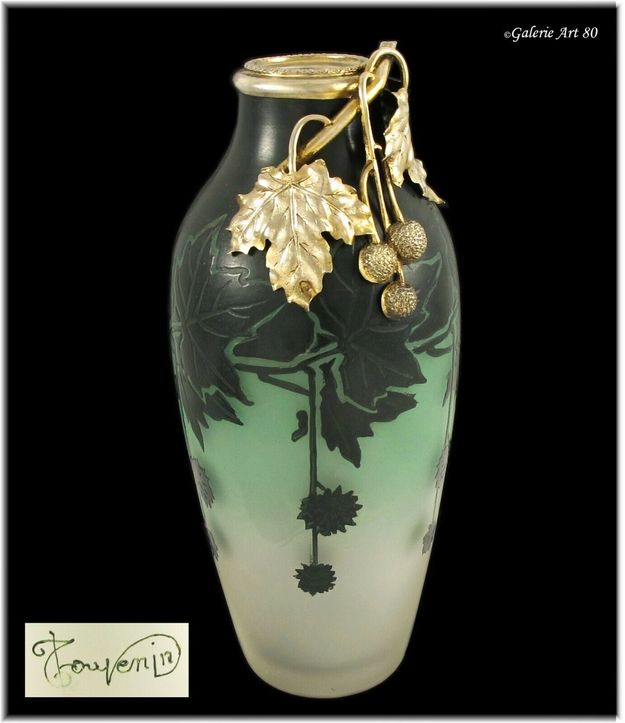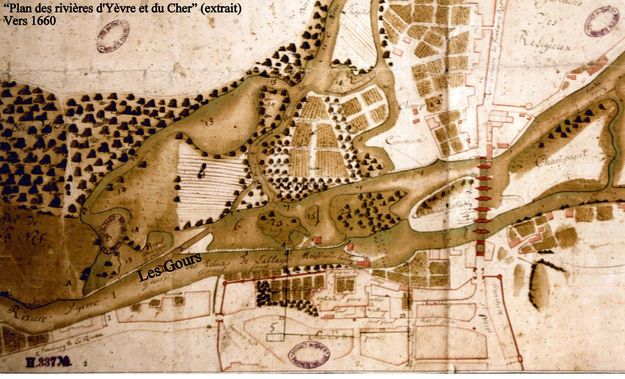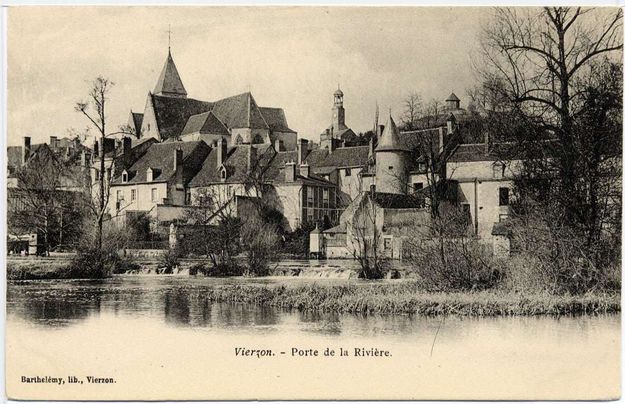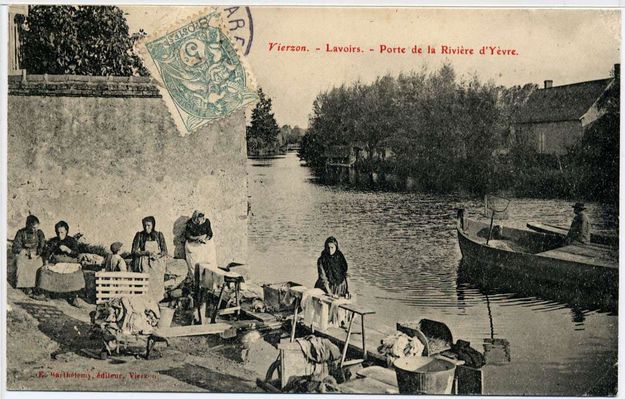Archives du vendredi
Chaque vendredi est publiée sur Facebook une archive sur l’histoire de la ville de Vierzon. Jean Foucrier, coup de feu rue des Changes, les fils d'Adrien Thouvenin, la ferme de Dournon... retrouvez ici toute l'histoire de notre ville.
1) L’inconnu devenu maire
Lucien Beaufrère est élu maire de Vierzon Ville lors des élections de 1929. Son mandat se déroule après celui de l’emblématique Émile Péraudin, recordman du plus long mandat de maire à ce jour : 29 années, sans compter ses mandats de député et conseiller général.
Beaufrère restera à tout jamais étiqueté « maire de la crise des années 1930 ». Titulaire d’un seul mandat, décédé au début du deuxième, il est un maire coincé entre les deux fortes personnalités que sont Émile Péraudin son prédécesseur et Georges Rousseau, son successeur et maire de la Fusion, si l’on excepte le court et anachronique mandat de Émile Cendre, de 1935 à 1937. Beaufrère restera à tout jamais lié au monument aux morts de Vierzon Ville. Le battage médiatique et cinématographique autour de son inauguration en 1933 en est pour beaucoup. Pourtant, Beaufrère, ce n’est pas que cela…
Lucien Beaufrère, tout comme Georges Rousseau d’ailleurs, est une homme d’une nouvelle génération, de ceux qui vont passer une partie de leur jeunesse dans l’enfer de Verdun ou du Chemin des dames…
Il est né dans le nord du Cher en 1883, fils de deux instituteurs, « hussards noirs de la République ». On imagine déjà que le jeune garçon se forge une conscience sociale qu’il gardera toute sa vie. Ses études le poussent vers le métier d’architecte, métier qu’il n’exercera quasiment pas.Il préfère acheter une usine frigorifique à Vierzon impasse Casimir Lecomte en 1914, juste avant le déclenchement des hostilités. Il ne quittera plus dès lors la seconde ville du Cher, excepté durant les quatre années de guerre où il est mobilisé dans un régiment du génie, sa formation initiale d’architecte se rappelant alors à lui. Durant cette époque, c’est son épouse qui dirige tant bien que mal l’entreprise qui arrive à survivre malgré la baisse du chiffre d’affaire.
La guerre a permis l’innovation industrielle dans de nombreux domaines. C’est le cas également dans le monde des frigidaires et de la conserve alimentaire. Rappelons qu’à Gièvres, à quelques kilomètres de Vierzon, avait été construit par les Américains en 1917 le plus gros frigidaire congélateur électrique au monde.
Revenu du front avec la croix de guerre, Beaufrère investit dans de nouveaux matériels pour son usine frigorifique qu’il transforme ainsi en usine de boîtes de conserves. C’est rapidement un succès pour ces nouvelles modes de consommation. Ses bénéfices lui permettent ainsi de proposer les congés payés à ses ouvriers, dix ans avant les lois de 1936.
Il devient alors un homme reconnu socialement, un patron qui entre dans des sphères qui lui étaient jusqu’alors fermées. Son ascension jusqu’à la tête de la mairie de Vierzon Ville a été étudiée par Frédéric Morillon, historien spécialiste du Vierzon contemporain.
Il montre que Beaufrère a commencé par franchir les marches consulaires. Il est inscrit sur les listes électorales de la Chambre de commerce, du Tribunal de commerce et du Conseil des prud’hommes. En 1923 il se présente à son tour et devient membre de la Chambre de commerce, côtoyant les patrons et industriels du département, se créant un réseau.
Il entre en politique sans aucune expérience dans ce domaine lors des municipales de 1929. Cette année-là Péraudin, 64 ans, se sent sans doute usé par 29 années de mandat de maire. Il ne s’est d’ailleurs pas représenté à la députation de 1928, André Breton lui ayant succédé. C’est lors d’une réunion du groupe du Comité des Républicains Socialistes le 31 janvier 1929 pour préparer les municipales de mai que les membres du conseil municipal apprennent la décision du maire de na pas se représenter. D’ailleurs Péraudin mais aussi Beaufrère n’apparaissent pas sur la liste Comité Républicain Socialiste.
Cela n’empêche pas Beaufrère, vierge de tout mandat politique, de demander audience au préfet du Cher, en temps que tête de liste « Concentration Républicaine et Socialiste » dès le lendemain de la réunion, le 1er février 1929.
Comment a fait Beaufrère pour prendre la tête de liste ? Il y a là un mystère. D’autant plus qu’un homme émergeait au sein du conseil municipal pour remplacer le maire : son adjoint Émile Charot, ancien directeur d’école, aimé de tous (contrairement à Péraudin), et connaissant bien les dossiers du conseil municipal.
Nous avons la chance d’avoir, dans les archives municipales, les archives personnelles de la campagne électorale de Beaufrère. Ce sont plusieurs pages écrites au dos du papier à lettre de son entreprise. On arrive à voir le cheminement d’un homme qui prépare son élection. Il dresse la possible liste de ses colistiers, la liste des thématiques qu’il va développer pour son projet, etc.
Et au passage il n’épargne pas Péraudin qui, quoique usé n’en a pas moins la réplique mordante : il redeviendra simple citoyen mais se réservera le « droit incontestable de critiquer comme il l’entendra l’administration et la politique de ses successeurs... ».
Trois listes se présentent aux élections de 1929, deux listes socialistes concurrentes, celle de Beaufrère et celle de André Breton et une liste communiste.
La liste de Beaufrère remporte le premier tour des élections mais c’est Émile Charot qui est le mieux élu, loin devant Beaufrère qui arrive 5e. C’est à nouveau le cas lors du du 2e tour de cette municipale. Et là Beaufrère n’arrive que 7e. Charot est toujours le mieux élu. Malgré tout, Beaufrère est installé maire par le conseil municipal le 19 mai, en ayant provoqué le hold-up idéal. Charot restera 1er adjoint de Beaufrère...
2) Le maire de la crise économique
Dans la précédente archive du vendredi, nous revenions sur la prise de la mairie de Vierzon Ville en 1929 par Lucien Beaufrère, cet illustre inconnu – ou presque – qui s‘imposait dans un paysage politique tout entier occupé par l’autoritaire Émile Péraudin.
En ce 19 mai, jour d’installation du conseil municipal, c’est pour lui le moment d’évoquer, dans son discours de politique générale, le programme pour lequel les vierzonnais l’ont élu.
C’est un programme ambitieux. Il a listé sept thèmes qui doivent mener Vierzon sur le chemin de la modernité.
On les retrouve au dos du papier à lettres de son entreprise : urbanisme, école, hygiène publique, sécurité, pompiers, approvisionnement, et aide aux Habitations Bon Marché HBM. Sur ses brouillons, il y a soit, une phrase, soit un mot, soit un long développement…
Pour l’heure, son discours de politique générale se termine par une prise de position non équivoque : Lucien Beaufrère est favorable à la « réunion administrative des quatre Vierzon, si souhaitable sous tous les rapports. » Pas sûr que tous ses colistiers soient du même avis…
Hélas, dans cette liste de projets ambitieux, se trame déjà les causes de la désaffection de ses administrés.
Là encore il faut se tourner vers Frédéric Morillon qui explique dans sa biographie de Beaufrère combien ce dernier fut le jouet d’un événement majeur du XXe siècle : la crise des années 1930.
Pour réaliser son programme, Beaufrère a besoin d’argent. Mais les ressources de la commune de Vierzon Ville ne sont pas extensibles. Les plus fortes rentrées sont celles liées à la location des communaux et la ville n’en possède pas et ne peut avoir recours qu’à l’augmentation des impôts (sauf de la patente qui reste à un niveau très bas)...
Et pour comble de malchance, la crise des années 30 va être un facteur aggravant par la crise sociale qui l’accompagne.
Pourtant, économiquement parlant, tout semblait bien commencer : Pour doper le commerce local Beaufrère jetait les bases de notre actuelle Foire-expo, reflet des savoir-faire de l’agglomération. En 1931 avait lieu la première « semaine de Vierzon ».
Sourdement le chômage augmente. La métallurgie boîte et la porcelaine tousse. En novembre 1931 on dénombre 2200 chômeurs partiels ou complets ; deux mois plus tard ils sont près de 4000.
Comme dans les autres Vierzon, Beaufrère improvise une politique d’aide sociale par la distribution de bons en argent aux plus démunis.
Et il fait appel à l’emprunt pour permettre de démarrer des chantiers qui seront dans l’obligation d’embaucher les chômeurs de la commune.
Outre la réfection des rues et l’agrandissement du cimetière, les chômeurs seront embauchés pour les travaux emblématiques de son mandat : les bains douches (1934) et « le jardin du souvenir », monument aux morts de la ville et auditorium (1933-1935) qui sera réalisé avec le concours de chômeurs sous les directives de l’architecte Eugène Henri Karcher.
A l’actif du maire il y a également la création de la colonie de vacances de Charentonnay « les Trois Brioux » et l’inspection sanitaire scolaire gratuite.
Il transfère dans un local plus grand le corps des sapeurs pompiers, demande mille fois réitérées du capitaine Marc Larchevêque. Les pompiers basculent jusqu’à l’île Saint Esprit, ancien local de l’usine élévatoire des eaux.
Dans l’enseignement il crée un cours secondaire au sein de l’ENP, qui, avec les cours municipaux du soir, permettent aux vierzonnais d’avoir une scolarité complète jusqu’au lycée.
C’est sur ce bilan et avec d’autres réalisations qu’il repartira à la chasse à l’électeur en 1935.
Mais en attendant, Monsieur le maire doit faire face aux critiques de son (ses) opposition(s).
Le Cocorico Vierzonnais, journal satirique local sera pour Beaufrère le plus caustique de ses adversaires. Le mensuel existe depuis 1927 et est tout entier dédié à la Fusion des quatre Vierzon. Cela ne l’empêche pas de disséquer la politique des élus et Beaufrère devient la tête de turc préférée des auteurs et de son illustre dessinateur Roger Rabot alias Regor.
Beaufrère avait commis une gaffe en 1929, il avait annoncer vouloir « économiser les deniers publics ».
Retour à l’envoyeur. Le Cocorico se fait un plaisir de passer les dépenses municipales au peigne fin. 4,5 millions d’emprunt nouveau, 200 % d’augmentation d’impôts, 128000 F d’émoluments pour le maire.
Regor s’en donne à coeur-joie. Il croque Beaufrère en seigneur d’Ancien Régime, grand Bourgeois portant monocle et culottes de golf.
Et surtout, le Cocorico est très suspicieux envers Eugène Henri Karcher, créateur du monument aux morts. La ville ne veut pas publier le contrat qui la lie à l’artiste. Cela doit cacher quelques chose. Hormis le prix exorbitant du jardin, cela cache surtout une clause qui laisse Karcher propriétaire de l’image du monument. Autrement dit, les photos sont interdites. On est prié d’acheter les photos officielles. Pour sa défense, l’artiste signalera reverser les sommes reçues à l’œuvre des Trois Brioux.
Malgré tout, fort de ses réalisations, Beaufrère repart à la conquête d’un nouveau mandat en 1935. L’ambiance générale est plutôt « Front Populaire ». Ce qui est vrai ailleurs reste « compliqué » à Vierzon. Beaufrère aura de fait la chance d’avoir plusieurs listes socialistes face à lui qui disperseront l’électorat.
Quatre listes sont en présence :
la liste « Républicaine et socialiste » du maire sortant,
une liste « Bloc ouvrier et paysan » du communiste Robert Crépat
une liste « Action ouvrière républicaine et socialiste » de André Breton
une liste « SFIO » de Robert Douceron
Le 5 mai Beaufrère surpasse Breton qui surpasse Crépat. Douceron est loin derrière. Mais, tout comme en 1929, Beaufrère n’est pas le mieux élu. La place en revient à un nouveau venu : Émile Cendre, retraité des chemins de fer (Charot ne s’est pas représenté).
Et le 12 mai, si la liste Beaufrère arrive encore en tête, c’est toujours Cendre qui est le mieux élu.
Une semaine plus tard Beaufrère, absent pour cause de maladie est installé maire de Vierzon. En fait, il ne retrouvera jamais le chemin de la mairie. Il décède chez lui le 24 juin 1935.
C’est officiellement l’adjoint Cendre qui devient maire jusqu’à la Fusion de 1937...
Tous les habitants du quartier Bourgneuf connaissent la rue André Hénault, traversante entre le boulevard de la Nation et l’avenue du Quatorze juillet. Pour les autres, il n’y a qu’à dire « Mais si, tu sais, c’est la rue de la salle Collier ! ».
Cette rue ne porte le nom de Hénault que depuis 1905. Entre 1901 et 1905 c’était la rue de la République, et avant cette date, ce fut longtemps la rue neuve.
Aujourd’hui simple quartier, Bourgneuf fut commune indépendante, de décembre 1886 jusqu’à avril 1937 et la fusion des quatre : Ville, Villages, Bourgneuf et Forges qui forment alors le « grand Vierzon ».
La commune fut donc totalement indépendante durant cinquante ans et son premier maire en fut André Hénault.
Tout au long du 19e siècle, l’industrialisation de Vierzon sera soutenue, notamment grâce au canal de Berry puis au chemin de fer. Après les forges du comte d’Artois la porcelaine s’installe, le machinisme agricole suit. La conséquence en est la prise de conscience ouvrière et ses revendications. La reconnaissance arrive enfin avec la loi sur la liberté syndicale de 1884, coïncidant avec la le début du suffrage universel masculin lors des élections municipales.
Et ce que l’on pouvait pressentir est arrivé à Villages : Une municipalité socialiste est élue, et Louis Samson en devient maire.
Villages était alors divisée en trois sections électorales, calquées sur les quartiers : Fay (Saint Martin), Bourgneuf et Forges.
Il était de tradition que le maire soit de Saint Martin et que ses deux adjoints soient de Bourgneuf et des Forges.
Or, en 1884, Bourgneuf ne détient pas de poste d’adjoint et s’estime sous-représenté au conseil municipal de Vierzon Villages. André Hénault, simple conseiller municipal du quartier multiplie les interventions orales en ce sens lors de les réunions du conseil.
De plus, une grève très dure explose à la Française en août 1886. La municipalité « rouge » de Villages soutient les grévistes… au grand dam des habitants de Bourgneuf.
En effet, la sociologie de Bourgneuf est bien différente des autres quartiers de Vierzon à l’époque.
Le quartier fut oublié par l’industrialisation galopante de l’agglomération. Le Cher devenait un vrai obstacle à son développement. Un seul pont permettait alors son accès, synonyme de transports coûteux pour les industriels qui préféraient s’installer le long du canal et à proximité de la ligne de chemin de fer. Bourgneuf, pour les ouvriers qui y résident, est synonyme de cité dortoir. Ils partent le matin pour rentrer le soir. La majorité des habitants est composée, d’artisans, d’agriculteurs, de boutiquiers, de maraîchers à l’instar du futur maire Félix Chariot.
En attendant, la grève de la Française, est le révélateur des tensions au sein du conseil municipal de Villages. Des voix s’élèvent contre le soutien aux grévistes. L’idée est lancée de former une commune indépendante. Une demande arrive sur le bureau du préfet du Cher qui ordonne alors une enquête commodo incommodo qui démontre la volonté des habitants de se voir indépendants vis-à-vis de ceux des Forges ou de saint Martin qui sont tous à mettre dans le même sac.
Le conseil d’État accorde donc à la nouvelle municipalité le droit de s’auto-administrer. Et le premier maire en sera André Hénault, élu en février 1887. De sa conviction politique, on ne sait pas grand-chose. Des élections de février, on en sait encore moins. Est-ce son passé de rebelle au sein du conseil de Villages qui a propulsé Hénault tête de liste ? Avait il une vraie ambition ? Etait-il poussé par des amis ? Sa fiche de police, en préfecture est quasi vide. Outre son adresse et sa profession d’épicier, il n’y a qu’un seul mot « républicain », donc de gauche selon le vocabulaire de l’époque.
Sur André Hénault, on peut dire quelques mots. C’est un homme issu de la bourgeoisie locale. Son père est charpentier de marine ; le quartier du Bourgneuf s’est fait une spécialité de construire des bateaux. Le Cher fut longtemps navigable et l’arrivée du canal a transformé les charpentiers de marine en constructeurs de péniches « berrichonnes ».
Sa mère est épicière, à l’angle des actuelles rues André Hénault et du 14 juillet, au cœur du quartier. Lors du vote du conseil municipal, il se dit négociant. En fait il a repris l’épicerie de sa mère et y a ajouté la vente en gros, dont le vin et le charbon. A ce titre, il dispose de plusieurs voitures à son nom qui sillonnent les rues de l’agglomération, livrant les denrées chez les uns ou chez les autres.
C’est donc un maire jeune qui se présente à l’élection (il a 36 ans en 1887) et la gagne.
Durant ses cinq années de mandat, André Hénault aura mis sur pied une vraie municipalité : création d’une mairie – école, d’un cimetière, d’un bureau du télégraphe ; sans oublier des réalisations dans les domaines de la voirie, de l’éclairage public, des eaux usées.
Mais pour mener à bien tous ces projets, il faut de l’argent. Et la seule mise en location des communaux n’est pas suffisant et les impôts augmentent fortement pour les habitants durant son mandat.
La hausse des impôts aura rendu André Hénault très impopulaire et renverra le balancier vers la droite réactionnaire aux élections de 1892, en la personne de Henri Barthélémy
Quelques cartes postales jaunies, quelques images devenues floues avec le temps. Et très peu d’écrits, trop peu d’écrits… Aujourd’hui tenter une reconstitution de l’histoire du pensionnat Saint Joseph, « Saint-Jo » pour les connaisseurs, relève du défi. Défi accepté.
L’apparition du pensionnat Saint Joseph dans les archives municipales remonte à l’année 1888. Rachelle Dubois, dite sœur saint François d’Assise succède à Henriette Jamet dite sœur Marie à la direction du « pensionnat et externat primaire privé 11 rue Gourdon ».
Nous sommes pendant Troisième République. L’école est un enjeu majeur de la République suite aux lois Ferry sur l’enseignement obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans ; les instituteurs deviendront les « hussards noirs de la République ».
A côté des écoles publiques, coexistent néanmoins des écoles privées, dites libres. Ce terme vient de la liberté pour un quidam, d’ouvrir une école privée dans une commune. Ce sont deux lois, Guizot en 1833 et Falloux en 1850 qui confirment cette liberté d’ouvrir des écoles, depuis le primaire jusqu’au secondaire. Et Jules Ferry ne les a pas abrogées. Cette liberté permet alors aux congrégations religieuses d’ouvrir leurs propres établissements, comme c’est le cas avec le pensionnat Saint Joseph de Vierzon. Il suffisait alors pour l’établissement privé de se soumettre à la simple déclaration d’ouverture de classes.
Cette archive municipale arrive bien tardivement déjà dans la vie du pensionnat. En effet c’est dès 1861 que les sœurs de la charité de Bourges vont ouvrir un établissement d’enseignement primaire à Vierzon, rue de l’étape. Elles y ouvrent une salle d’asile et deux salles de classe dont une payante. Bien vite il faut s’agrandir et penser à changer de locaux. C’est ainsi que la congrégation achète un terrain au 11 rue Gourdon, entre la rue et la voie de chemin de fer, en 1876. L’année d’après, le bâtiment « Pensionnat Saint Joseph », ce sera alors son nom, est près à accueillir les nouveaux élèves, internes et externes.
Le changement de statut en 1904 (interdiction des congrégations) voit arriver du personnel enseignant non religieux ; les sœurs restent néanmoins directrices de l’établissement. C’est sous leur impulsion que l’établissement va s’agrandir, notamment avec la construction de la salle de gym dans les années 1930.
Mai la guerre arrive et l’école va devoir se métamorphoser. Elle est réquisitionnée et devient hôpital temporaire en 1939. Il faut bien vite trouver des locaux pour les élèves. Les classes primaires seront logées chez le porcelainier Larchevêque, les classes secondaires iront dans l’ancienne école de la rue des changes et côtoieront les services municipaux qui s’y sont installés. Parallèlement, pour augmenter le nombre de places en chirurgie, l’hôpital envoie au 11 rue Gourdon une partie de ses vieillards. Cela permet au pensionnat d’éviter la réquisition pour le logement des troupes d’occupation après le 20 juin 1940 et l’installation allemande.
La pression diminue quelque peu et les classes installées chez Larchevêque peuvent réintégrer leur école… pour peu de temps. En effet les bombardements de juin-juillet 1944 visent la gare et la ligne SNCF. Le pensionnat, trop proche de la voie de chemin de fer doit à nouveau déménager : maintenant c’est à Bourgneuf que les primaires iront étudier. Et la fin de la guerre n’est pas pour autant synonyme de retour au 11 rue Gourdon. Le pensionnat se voit en effet redevenir hôpital temporaire ; et l’ensemble des cours, primaires et secondaires trouvent le chemin de l’usine Hache désaffectée. On y installe également la cantine. Enfin, en août 1945 les locaux sont tous rendus à leur première destination. Mais les sœurs sont face à un dilemme : le bâtiment a gardé de nombreux stigmates de la guerres : Faut-il faire des travaux et repousser encore l’entrée des élèves ? Les sœurs ont choisi. La bougeotte a assez duré. La rentrée des classes se fera normalement au pensionnat au 1er octobre, avec ses 220 élèves dont 30 internes. Les travaux se feront peu à peu, au gré du paiement des indemnités de guerre.
C’est ainsi qu’en 1961, le pensionnat fête son centenaire. Et la même année signe son contrat d’association avec l’État (loi Debré)
Les sœurs de la charité resteront à la tête de l’établissement jusqu’en 1988. Les trois dernières sœurs quitteront définitivement Vierzon en 2006...
Bientôt la France va commémorer les 80 ans du débarquement en Normandie, prélude à la libération du territoire français du nazisme. Vierzon prendra sa part de commémoration lors de la journée du 4 septembre prochain, date anniversaire de sa libération par les FTP, 1944.
Dans ce cadre, peut-être verrons-nous réapparaître sur les écrans, petits ou grands, des films relatant la période sombre de l'Occupation. Et parmi toute la filmographie disponible, il en est un qui a en partie été tourné à la gare de Vierzon : « Le jour et l’heure », de René Clément. Pierre Vergnolle, ancien cheminot et célèbre acolyte de Georges Poitrenaux pour animer les festivités vierzonnaises depuis les années 1950, se souvenait volontiers du tournage du film dans lequel il a fait une courte apparition.
Vierzon, printemps 1962. Effervescence du côté de la gare. Les techniciens de cinéma viennent repérer les lieux avant le tournage du prochain film de René Clément. Il s’appellera « le jour et l’heure », aura Simone Signoret comme vedette et l’Occupation allemande comme trame dramatique. Moins d’un an plus tard il sera sur tous les écrans français, mettant Vierzon et ses cheminots sous les feux de la rampe.
Pierre a 29 ans en 1962. Il est facteur d’écriture au service Exploitation de la gare de Vierzon. Autrement dit il relève les numéros des wagons en fonction de leur future destination.
Il se trouve au travail lorsqu’il tombe sur une note de service du secrétariat : La production franco-italienne du prochain film de René Clément recherche une centaine de figurants.
Le casting sera vite bouclé. La production a besoin de français moyens, de soldats allemands, de gestapistes et de miliciens.
« En fait, dans l’histoire, Simone Signoret se fait arrêter sur la ligne de démarcation à Vierzon. Donc des copains à moi ont joué les passagers du train, d’autres des soldats allemands, d’autres encore des gars de la gestapo. Ceux qui étaient en civil touchaient 30 francs par jour, ceux qui étaient en costume, 40 francs ». Mais Pierre portait fièrement la moustache. Il ne pouvait donc pas jouer les soldats allemands, tous bien rasés. C’est donc dans la peau d’un milicien qu’il apparaîtra à l’écran.
Béret et capote aux sinistres insignes, Pierre attend. « Le tournage à Vierzon a duré une semaine, pas loin. Nous on faisait ça en dehors du boulot, après 21 heures essentiellement. Y’en avait qui pouvaient faire plusieurs rôles. Un jour un soldat allemand poussant un voyageur, une heure après le voyageur présentant son billet à un gestapiste. Moi mon rôle de milicien s’est borné à houspiller les voyageurs, à faire dégager rapidement les soufflets entre les voitures pour laisser place nette à la gestapo. Sept jours de tournage et onze prises pour une minute d’apparition à l’écran !
Et pourtant, un jour il s’est fait engueuler. À cause d’un copain qui admirait les costumes et qui se tourne vers lui. « Il me dit : Pierre, regarde comme on est beau ! Et là on a entendu : Coupez !! Mais quel est le con qui parlait ? »...
Mais voir l’envers du décor est une chose non permise à tous. « Bien sûr qu’on regardait. Y’en avait du monde sur le quai. On a appris plein de trucs. Par exemple, pour faire avancer les wagons, devant la caméra, c’était des gars à nous qui poussaient. Il fallait pousser juste pour être dans l’axe de la caméra et s’arrêter juste au bon moment.. Sinon ils recommençaient.
Ils avaient refait un décor entier de la gare dans l’ancienne bibliothèque. On voyait les techniciens qui s’affairaient.
Quant à Simone Signoret, c’est le plus beau souvenir de Pierre. « Elle avait avec elle son chauffeur, son coiffeur, son habilleuse et sa doublure. Mais, pour une actrice au sommet de son art, elle n’était pas bégueule pour deux sous. Je me souviens d’avoir échangé quelques mots avec elle. Des banalités à faire pleurer mais elle était à l’écoute, disponible. »
Par contre, sur le partenaire de Simone Signoret Stuaret Whitman, Pierre n’avait pas les mêmes souvenirs : « Si j’ai tenu Simone Signoret dans mes bras, c’est grâce à lui. Un jour Clément devait tourner une scène à la Gratouille, quartier de Vierzon qui avait été lui-même beaucoup bombardé en 1944, alors c’est normal y’avait encore pas mal de trous d’obus. En fait Signoret et Whitman devaient s’enfuir sous les bombes. La vraie scène était sensée se dérouler à Orléans. Et Clément a passé la journée à chercher Whitman. Voyant qu’il était pas là, on m’a demandé de le remplacer, moi, le milicien figurant ! T’as son gabarit, tu feras ci et tu feras ça ! Et me voilà courant sous les fausses bombes avec Signoret à mon bras, allant de tas de cailloux en trous d’obus ! On se serrait fort par la main, Simone et moi. »
Et on a fini par remettre la main sur Whitman. « Il était à La Loge, petit bled pas loin sur la route de Paris. A l’époque il y avait un routier célèbre qui servait à boire et à manger 24 heures sur 24. C’est là qu’ils ont mis la main dessus. Il était complètement rond, la tête à l’envers. Inutile de dire qu’il s’est fait complimenter pour son absence »…
Si Vaillant et Pyat sont les deux figures vierzonnaises connues de la Commune de Paris et au-delà du socialisme français, il ait des personnages qui ont grandi à la chaleur des usines locales et qui ont également pris part à cette tentative avortée de 1871. Jean-Baptiste Chardon en fait partie.
Chardon n’est pas à proprement parler un vierzonnais. Il est né à quelques lieues de Vierzon, à Souvigny, le 19 juillet 1839. On ne sait que peu de choses sur sa famille. Même les archives départementales du Cher sont pauvres à son sujet. Pourtant de nombreux rapports sur ce « dangereux individu » ont été rendus au préfet par les commissaires spéciaux, ancêtres de nos RG.
On imagine une famille modeste. Adolescent, son père l’envoie faire son apprentissage chez son oncle, Lecomte, chaudronnier à Vierzon Ville. L’atelier qui emploie une demi-douzaine d’ouvriers est situé rue du boulevard, actuelle rue du docteur Roux. Ses copains sont les verriers ou les métallos de la rue.
Sa conscience politique s’éveille aux côtés de son oncle, grand ami de… Félix Pyat, avocat, de 20 ans son aîné et actif militant de la République de 1848. Pyat banni par l’Empire, Chardon quitte Vierzon en 1862, embauché comme métallo aux ateliers de réparations du chemin de fer d’Orléans, gare d’Ivry. S’ensuit sa première condamnation, pour vol de cuivre à ces mêmes ateliers.
En 1866 il épouse à Vierzon Thérèse Voulu qui n’hésitera pas à donner de sa personne pour aider Bazille à proclamer la Commune à Vierzon, en mars 1871 (1).
Non content d’avoir volé du cuivre à la Compagnie du Paris-Orléans, Chardon se fait aussi remarquer comme orateur auprès de ses condisciples ouvriers. La compagnie se sépare de lui en mars 1870 pour « manifestations d’idées politiques plus que révolutionnaires. » Motif peut valable, le PO tentera de faire reconnaître une supposée ivrognerie de débauché sur un faux rapport de police.
S’ensuit une carrière entrecoupée par des séjours en prison. Chacune de ses harangues se termine immanquablement par une arrestation (2).
A la chute de l’Empire et profitant d’un temps où il n’est pas prisonnier, il se fait élire capitaine d’une compagnie de la Garde Nationale.
Lors de la journée d’insurrection populaire du 31 octobre 1870 contre l’échec du gouvernement de Défense Nationale, il exhorte son bataillon à marcher sur l’Hôtel de Ville. Le même jour il est nommé colonel de la 15e Légion de la Garde Nationale. Ce sont là des renseignements qui ne seront connus qu’en 1879, bien après le procès des Communards.
Profitant de sa nouvelle notoriété, le blanquiste Chardon fonde dans le 13e arrondissement de Paris le club des démocrates socialistes, un des principaux clubs activistes qui adhère à l’Internationale.
Il signe, avec Vaillant et Vallès l’affiche rouge du 7 janvier 1871, véritable appel au soulèvement populaire de Paris, contre le gouvernement du 4 septembre qui a failli à sa mission, et à l’Instauration d’une Commune. Il faut dire qu’il fait froid et que les Parisiens ont faim. N’oublions pas que Paris est assiégée et à la portée des canons Allemands. L’Armistice franco-allemand du 29 janvier repoussera le soulèvement populaire au 18 mars.
Chardon est élu le 26 mars membre de la Commune par le 13e arrondissement. Il fait partie de la commission de la guerre. Il en démissionne pour devenir membre de la Sûreté Générale à la préfecture de police aux côtés du Général Duval. Il lui succède le 5 mai et devient alors Commandant Militaire de Paris, membre de la cour martiale.
Lors de la semaine sanglante, fin mai 1871, il arrive à échapper aux Versaillais on ne sait comment. C’est vers Vierzon qu’il se dirige mais là non plus sa sécurité n’est plus assurée. Pyat et Bazille sont en fuite, Chardon doit faire de même.
C’est vers la Suisse, terre d’accueil pour 54 proscrits de la Commune (3), qu’il décide de se diriger. Il le fait avec la complicité de ses anciens collègues cheminots qui le cachent lors du passage de la frontière, dissimulé dans le charbon du tender.
Au même moment il est condamné à mort par contumace en France, tout comme Pyat, le 19 juillet 1872.
Surveillé, il n’en demeure pas moins membre du club des 54, club de « propagande et d’action révolutionnaire socialiste ».
Mais la révolution ne nourrit plus son homme et c’est le métallo qui doit subvenir à ses besoins. Ouvrier d’Etat à la compagnie des tramways de Genève, il ne tarde pas à se faire remarquer par ses nouveaux patrons. Il est envoyé en Egypte et devient le spécialiste de l’installation des machines à glace. Après un nouveau départ comme restaurateur à Port-au-Prince, il revient à Vierzon en 1900 dans la peau d’un rentier ayant fait fortune dans la cuisine.
Mais Chardon n’était pas fils unique. Il avait une sœur… bonne sœur. L’ancien Communard ayant porté l’uniforme à revers rouge et l’écharpe rouge est aujourd’hui enterré au cimetière de Vierzon Ville non sans être passé par la case église. Sans doute le moyen pour sa sœur d’essayer de lui faire gagner le paradis...
Aux environs de l’an Mil, la paroisse de Vierzon était beaucoup plus étendue qu’elle ne l’est aujourd’hui. Rappelons qu’une paroisse est une circonscription territoriale dépendant d’un diocèse, en l’occurrence celui de Bourges.
À l’origine, donc, la paroisse Notre Dame, englobait les actuelles ville et villages de Vierzon, Saint Hilaire de Court, Thénioux, Méry sur Cher et Saint Georges sur la Prée. Thénioux, Méry et Saint Georges ont été érigées en paroisses indépendantes dès le 11e siècle. Notre Dame devenait donc le lieu de culte communautaire catholique de Vierzon et Saint Hilaire de Court.
Si la Révolution a calqué son administration territoriale communale sur les anciennes paroisses, le cas se complique à Vierzon.
1790 : La Constituante sépare Vierzon en deux communes distinctes : Vierzon Ville au centre et Vierzon les Villages tout autour. Ce sont trois communes qui sont regroupées en une seule paroisse : Ville, Villages et Saint Hilaire.
Et l’entretien de l’église Notre Dame comme du presbytère incombait au conseil de fabrique mais aussi aux communes, au prorata de leur nombre d’habitants. Cela ne va pas sans heurts. Les travaux sont toujours trop chers, la quote-part des communes, toujours trop élevée. Et avec la montée du mouvement ouvrier, les communes aux « idées avancées » comme on les appelait, oubliaient régulièrement de régler leur quote-part. Ajoutez à cela un conflit ouvert entre les communes de Ville et Villages, cette dernière accusée d’utiliser les infrastructures de Ville (cimetière, école...) sans subvenir à leur entretien.
C’est ainsi que le presbytère Notre Dame tombe peu-à-peu en décrépitude ; il prend l’eau au sens propre du terme.
En 1867, il ne peut plus être question de réparer la cure mais bien de la reconstruire entièrement. Dans le descriptif des travaux, le mur gauche de l’ancienne cure correspond au mur droit du nouveau presbytère. Le presbytère projeté aura au rez-de-chaussée un vestibule, une cuisine avec annexes, une chambre, une salle à manger. Le premier étage aura six chambres et cabinets de toilettes. Le grenier pourra être ultérieurement aménagé. L’ensemble des travaux est estimé à la somme de trente mille francs.
Si chaque commune est bien consciente de la nécessité de tels travaux, l’empressement est moindre pour les financer. En 1868, un premier compromis est trouvé : le conseil de fabrique paiera la somme de 13820 francs, les trois communes réunies 8180 francs, un secours de 8000 francs sera demandé à l’État. Premier bémol : l’État, en juillet 1868, n’accorde que 6000 francs de subvention. Qui va payer la différence ? Saint Hilaire « oublie » de voter la dépense, Villages rechigne. 1871, alors que les travaux sont commencés et que Ville demande le versement de la subvention, l’État lui répond que le nouveau régime (3ème République), « réfléchit actuellement à l’opportunité de poursuivre la politique engagée et de payer des dépenses de cette nature. »
Entre temps, des soldats Prussiens ont été logés dans la cure en travaux, en décembre 1870. Les « chaussures à clous » ont littéralement saccagé les parquets, Tout est à refaire. Mai 1871 : Vallet fils, entrepreneur en charge des travaux refuse de continuer le travail s’il n’est pas payé pour ce qu’il a déjà réalisé et que les Prussiens ont détruit. Vallet n’est pas un inconnu, son père avait largement freiné le percement de la rue Gourdon. C’est contre espèces sonnantes que le fils avait permis la fin du chantier. Pour le presbytère, un procès va s’ouvrir, qui va durer un an pendant lesquels les travaux ne reprendront pas.
En septembre 1872 le préfet ordonne la poursuite des travaux et le paiement de Vallet fils par par Vierzon Ville.
En juillet 1873, il faut 13000 francs supplémentaires pour achever les travaux. Les trois communes paieront au prorata de leur population, dépense imposée par le préfet qui demande à voir si les lignes budgétaires ont bien été votées en conseil municipal. Ils ne seront réceptionnés qu’en novembre 1874, date à laquelle le curé pourra réellement rentrer dans ses murs…
1) Le percement de la rue Gourdon
Dans la famille Vallet, il y a le père, et il y a le fils. Tous deux auront maille à partir avec la municipalité, ayant la rancune tenace. Vallet père arrive sur scène au moment du percement de la rue Gourdon…
Le projet de créer cette rue est né au sein de la municipalité Manceron, en 1861. Nous sommes dans la deuxième moitié du 19e siècle et les industries qui s’installent permettent l’augmentation du revenu de la commune de Vierzon Ville, pauvre de n’avoir jamais eu de communaux à louer. De plus les nouvelles infrastructures que sont le canal de Berry et le chemin de fer augurent d’un développement rapide de la cité. Les élus vont accompagner ce développement économique et démographique en transformant leur ville. Les années 1860 et 1870 sont celles des grands travaux : l’agrandissement de la place du marché aux blés, la construction d’un abattoir moderne à l’écart, la construction d’un nouvel hôpital, le percement de la rue Gourdon. Vastes chantiers…
La nouvelle voie, future rue Gourdon, doit relier la route de Neuvy à la gare par la prolongation en ligne droite de la rue du boulevard (docteur Roux) jusqu’à la Croix blanche. Elle devra se substituer à la rue Victor Hugo, trop étroite.Mais c’est un projet coûteux pour la ville au vue de sa politique de grands travaux. Lors de l’enquête d’utilité publique, de nombreuses voix s’élèvent contre le projet d’une nouvelle rue. Frédéric Delaporte : « Cette nouvelle voie se trouverait parallèle à la rue des capucins (Victor Hugo) et nuirait au commerce et à l’industrie de cette dernière. » Le maire passe outre ces remarques en ces termes : « …La population qui augmente, l’industrie qui progresse ne trouveront plus de logements ou terrains à bâtir. La rue projetée laisse à droite et à gauche de vastes emplacements… »
La nouvelle rue, dite rue neuve du boulevard va donc être créée en trois tronçons, de 1863 à 1872. C’est le premier tronçon qui va être le plus dur à réaliser, entre la rue des pompes (Roosevelt) et la rue des épinettes : il faut démolir une partie du cul de sac des fossés, notamment la propriété Vallet jouxtant les escaliers qui montent à la rue du boulevard. La maison Vallet empiète en effet de onze mètres sur le futur alignement de la rue projetée. Le problème est que cette construction est très récente et que la pilule va être difficile à avaler pour son propriétaire.
Sommé de démolir, Vallet refuse. S’ensuit une procédure de quatorze années, pendant lesquelles le chantier reprend, s’arrête, repart… Les menaces et les noms d’oiseaux fusent dans la bouche de Vallet. Les voisins se plaignent, comme Gibault en 1864 : « il m’est impossible de jouir de ma propriété dans laquelle je ne puis introduire qu’à bras les objets qui me sont indispensables tandis qu’auparavant l’accès s’y faisait par voiture. » Vallet père mort en 1871, c’est son fils qui va reprendre le flambeau de cette fronde.
Finalement c’est contre espèces sonnantes et trébuchantes qu’il va accepter l’année suivante la démolition de ces onze mètres de maison empêchant l’achèvement de la rue. De plus la ville donne à Vallet fils une partie du cul de sac des fossés. C’en est fini du projet d’escalier qui devait rejoindre la nouvelle rue. Le cul de sac des fossés restera une impasse.
C’est le 23 décembre 1869 que la « rue neuve du boulevard » va changer de nom. Le conseil municipal lui donne alors le nom de Gourdon, vieille famille vierzonnaise et présentement donatrice du terrain de l’hôpital. Deux mois plus tard, le décret impérial arrive qui confirme cette dénomination.
Tours avait le cirque Pinder, Blois le cirque Amar, Bourges le cirque Bureau. Et Vierzon peut s’enorgueillir d’avoir accueilli le sien : le Cirque National. Son fondateur, Monsieur Amédée est le patriarche d’une famille, la famille Ringenbach qui aura brillé sur les pistes des plus grands cirques de France et d’Europe.
Aujourd’hui l’archive du vendredi revient sur l’histoire de cette grande famille d’artiste qui a conservé Vierezon au coeur.
Lorsque le Cirque National s’installe sur le quai du bassin à Vierzon, en 1941, c’est pour le temps d’une représentation. De fait, Amédée Ringenbach, « Monsieur Amédée » comme on l’appelle, ne quittera plus la ville et en fera la résidence hivernale de la famille.
Amédée Ringenbach est un « pantre », terme employé pour désigner les artistes qui ne sont pas nés sous un chapiteau. Il est né à Lyon en 1891, son père était mécanicien ajusteur. C’est au sortir de la grande conflagration de 1914 – 1918 qu’il bifurque vers le métier de la piste en créant un numéro de mains à mains en force avec un ami et avec lequel il débute en « palc » c’est à dire en plein vent, sans chapiteau. Ses pérégrinations l’ont conduit jusqu’aux portes du cirque Bureau – Glasner de Bourges. Venu pour effectuer son numéro en remplacement d’un athlète défaillant, le jeune Amédée, qui a alors 31 ans, se lie d’amitié avec son employeur qui décide de le garder comme avant-courrier, personnage central chargé de négocier avec les municipalités les futures dates des tournées.
Sa rencontre avec la grande famille des artistes de cirque est déterminante. En 1933 il épouse Yolande Sturla, fille d’Edouard Sturla et de Hélène Ricono, une autre grande famille du cirque. Aidé de sa femme et de ses beaux parents il franchit le rubicond et monte en 1935 son premier cirque, le Cirque des Alliés. C’est un très beau deux mats diraient les charpentiers de marine. L’expression est également valable dans le milieu des enfants de la balle.
Ce nouveau cirque part à la conquête des petites villes de province avec des numéros de qualité. Il se fait ainsi un nom grâce notamment à la troupe des Ricono qui sont d’excellents jockeys et parmi laquelle on peut trouver les noms de André et Alexis Gruss.
Mais la guerre arrive. 1940, les Allemands sont en France. Il est mal vu de garder le nom de Cirque des Alliés. Amédée le débaptise et le transforme en Cirque National. Malgré tout, le cirque est arrêté à Vannes.
« Ah là, ce fut dur. J’ai bien cru que la guerre allait anéantir tout ce que j’avais créé. Je me suis accroché avec la force du désespoir et j’ai réussi. » Tels sont les termes employés à l’époque par Monsieur Amédée.
La troupe était dispersée, il fallait tirer le matériel avec camions à gazogène… Après un passage à Sancoins puis Issoudun, le cirque s’arrête à Vierzon pendant l’hiver 1940 – 41.
C’est là qu’Albert Ringenbach que ses amis appellent affectueusement Bébert voit le jour, au 41 de la rue du Champanet, mis au monde par le docteur Mérigot, futur maire.
Malgré la guerre le cirque continue à donner des représentations dans les villes du Cher. La troupe s’est réduite comme peau de chagrin et se concentre autour d’un noyau dur familial. Qu’à cela ne tienne, c’est parmi les vierzonnais que Monsieur Amédée va recruter ses artistes. Des noms apparaissent ainsi : Marcel Clément alias Francis Marclem, Berthier, Sacco, Dagot, musiciens, acrobates, monteurs ou simples colleurs d’affiches.
Les choses prennent de l’ampleur en 1946, après la Libération. Les tournées reprennent, le « Cirque National, super cirque français » part à la conquête d’une renommée qui va l’entraîner sur les routes de France, d’Espagne, d’Italie, du Luxembourg.
Sur les routes, le Cirque National ne passe pas inaperçu. « Sur les routes de montagne, dans les Alpes, nous avons un jour croisé un bus exténué qui ne voulait plus monter la côte. Or ce bus bloquait notre cortège. C’est alors qu’on a fait sortir les éléphants de nos camions et qu’ils ont poussé le bus. Une autre fois nous devions donner une représentation sur l’île d’Oléron. Nos camions étaient trop grands pour tenir sur une seule barge. Les marins ont accolé deux barges : l’avant des camions sur l’une, l’arrière sur l’autre. Oui mais voilà, les entraves entre les deux barges ont cassé et elles ont commencé à s’éloigner l’une de l’autre. Nous avons eu peur pour nos éléphants et notre matériel. Heureusement que les marins étaient très bons… »
Tous les hivers, retour à Vierzon, au Cavalier pour répéter.
Monsieur Amédée avait racheté en 1946 une partie des usines Brouhot de machinisme agricole, rue du Cavalier. C’est là que le cirque passe les hivers, de novembre à février. C’est dans les hangars que l’on installait tout le matériel pour répéter les numéros : corde trapèze… C’est dans ces hangars aussi que les mécanos entretenaient le matériel, montaient des décors, réparaient les camions si besoin était. La première représentation de l’année avait toujours lieu à Vierzon place de l’abattoir.
Jusqu’en 1957 le Cirque National portera haut les couleurs de la famille Ringenbach. De nombreux artistes s’y sont produits : les Ballan acrobates sur bascule et à vélo, Taggiasco de leur vrai nom, vierzonnais d’adoption. Mais, dans un inventaire à la Prévert on pourrait citer dans le désordre Rigoulot l’homme le plus fort du monde, Vals le ventriloque, Al Scott le martien, Eskamo le magicien, sans oublier les clowns, Grock et Zavatta.
La fin ? Le Cirque National de Monsieur Amédée connaît sa dernière tournée en 1957. Monsieur Amédée louera ensuite ses installations à des radios périphériques. Par les contacts pris alors Bébert transformera en 1962 le chapiteau en cabaret dansant itinérant sponsorisé par Radio Luxembourg…
Aujourd’hui, c’est la troisième génération de Ringenbach qui dirige le cabaret National Palace, créé en 2007, mélange de Music-Hall et d’arts du cirque. Et le chapiteau est toujours planté rue du Cavalier...
Difficile cette semaine de trouver une illustration locale au texte qui suit :
En effet, cette semaine, l’archive du vendredi aura le vin doux et la jambe légère. Il va être question de bars montants, cabarets et autres lieux de pratiques olé olé.
Rappelons si c’était nécessaire, le passé industriel de notre ville. La forge, les porcelaines, la verrerie, le matériel agricole… autant de secteurs, sans oublier le chemin de fer, qui ont permis à Vierzon de multiplier sa population : 7000 habitants en 1789 ; 24000 à la veille de la Première Guerre mondiale.
Tout au long du 19e siècle, c’est une population d’hommes jeunes qui sont venus en ville chercher du travail. Et c’est là une population étroitement surveillée par les autorités car bruyante et turbulente par définition. On tente de l’encadrer, quitte à aller jusqu’à bâtir un habitat ouvrier spécifique, si possible non loin de l’usine et le plus loin possible du centre ville, comme ce fut le cas à la pointerie qui voit ses premiers logements ouvriers émerger dès la Restauration.
Mais jamais rien n’empêchera cette population d’aller dans les bistrots, y compris pour rechercher une compagnie éphémère.
Il ne s’est jamais agi d’interdire mais bien d’encadrer les « loisirs » des ouvriers ; et d’encadrer celles qui leur ponctionnaient régulièrement leur salaire. Le « système français » tel que décrit par Parent Duchatelet est de contrôler « ce mal nécessaire » afin que les prostituées ne transmettent pas leurs vices.
Les filles se doivent donc d’être dans un milieu clos, invisibles des enfants, des filles et femmes honnêtes. Et ce milieu clos doit être sous le contrôle de l’administration. Hermétique aux honnêtes gens tout en étant transparent pour la police.
On voit là apparaître la notion de maison close, ou maison de tolérance, puisque les abus sexuels qui y sont pratiqués sont « tolérés » par l’administration. Cette maison close devra être tenue par une femme. Parent Duchatelet pense en effet qu’une femme sera naturellement plus soumise à l’autorité de la police.
Ce lieu de maison close a bel et bien existé à Vierzon. Il avait pour nom de cheval blanc et était installé en plein centre ville, rue de la République. Au fond de la cour, sur la rue Victor Hugo, se dressait un bâtiment avec bistrot au rez de chaussée et balcons au dessus. Et la sortie « des artistes » s’effectuait dans la rue Victor Hugo. Bernard Giraud, enfant de la rue, plus connu sous son nom de scène Patrick Raynal alias Berlodiot, racontait cette anecdote : Comment il voyait les clients, sortir précipitamment par la rue Victor Hugo, et, une fois un homme avec son pantalon sous le bras. Pour lui cela voulait dire que les pandores entraient par la rue de la République…
Tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle, l’administration municipale a été destinataire de courriers demandant l’ouverture de maisons closes. Témoins ces lettres :
Vierzon, le 16 mars 1852
« J’ai l’honneur de vous prier d’autoriser monsieur Alexandre B. à fonder un estaminet de tolérance dans ma maison petite rue de Grossous numéro 33 dont je ne retire pas de produit depuis longtemps et dont monsieur B. m’offre six cent francs par an pour son établissement et pour lequel il s’engage à donner pour chaque année pour les pauvres de votre commune une somme de trois cents francs. J’ose espérer monsieur le maire, que cette autorisation sera accordée en vous donnant toute garantie convenable ainsi qu’à moi pour cet établissement. Votre très honorable serviteur, X, capitaine d’artillerie en retraite. »
8 décembre 1866
« … monsieur le maire, quoique je sois une mère de famille, si vous êtes assez bon pour m’autoriser à tenir une maison de société dans votre ville, mes enfants n’habiteront pas chez moi… Si ma maison nécessite l’emploi d’un agent de police, je m’oblige à payer la moitié de son traitement de même que pour la sûreté de la communication des mals nuisibles, j’aurai à mes frais un médecin qui viendra à mon domicile visiter les dames… Je verserai à la caisse du bureau de bienfaisance la somme que vous fixerez. »
sans date
« J’ai l’honneur de vous adresser une demande tendant à ce qu’une construction dont je suis propriétaire au Grelet, commune de Vierzon Villages, soit affectée à une maison de tolérance. Cette construction entièrement entourée de murs et de grillages desquels elle est éloignée de 10 mètres environ par devant et derrière et 7 mètres sur chaque côté me paraît réunir toutes les conditions désirables de sécurité… Je prévois que votre première objection pourrait être qu’il n’y a pas de troupes à Vierzon, permettez-moi de vous dire à ce sujet qu’il existe à Saint Amand, ville également sans troupe et moins populeuse que Vierzon, deux établissements de ce genre. Vierzon est en effet une ville ouvrière, toute la force du terme et les nombreux ateliers, usines, fabriques qui font son commerce attirent journellement dans son sein une foule de jeunes gens étrangers à la commune qui en partent après avoir souvent fait quelques victimes. Ma demande… a un but essentiellement louable : elle consiste en effet à empêcher que la prostitution déjà en pied à Vierzon s’exerce sur une plus grande échelle. Au moyen de cet établissement, les tentations de débauche seraient moins fréquentes et la morale s’en trouverait bien. : les jeunes filles enfin moins obsédées seraient moins enclines à faillir. Les pauvres eux-mêmes trouveraient leur compte car si, comme j’ose espérer, vous voulez bien, monsieur le Maire, accepter favorablement ma supplique, je prendrai l’engagement de verser annuellement une somme de deux mille francs pour eux. »
A toutes ces demandes, exemples que l’on peut multiplier, la réponse des autorités municipales aura toujours été négative.
Néanmoins, la prostitution ne se pratique pas que dans les maisons de tolérance. Les simples bars ou cabarets peuvent être « montant ».
Une statistique officielle de 1890 recense cinq lieux de prostitution à Vierzon, avec entre trois et cinq filles par lieu. Pourtant, quelques années plus tôt, en 1878, la police recensait 9 bouges :
1 place du marché au blé, 2 dans la rue Porte aux bœufs, 1 sur la place des bans, 3 dans la Grande rue, et 2 dans la rue de la prison ; soit tous dans l’actuel Vieux Vierzon. Et il semblerait que Neuvy soit plaque tournante de la prostitution vierzonnaise. A Neuvy, il existe l’auberge du sieur S. « Les filles ne sont jamais les mêmes dans l’auberge du sieur S. On les retrouve souvent dans les bouges de Vierzon après leur passage dans cette auberge ».
Bien souvent, la police a un allié de poids dans la surveillance des « lieux de débauche » : les riverains. Des lettres de délation arrivent en mairie, également très intéressantes pour connaître la géographie locale des établissements. Alors le maire doit user de courriers officiels menaçant tel ou tel établissement de fermeture, « si le scandale perdure ».
La fin des maisons de tolérance aura lieu après guerre avec l’arrêté Marthe Richard. Les maisons fermées, la prostitution est sortie de son semi-anonymat pour rentrer dans la clandestinité.
Et le dernier mot sera pour Patrick Raynal qui expliquait que le bâtiment rue Victor Hugo fermé, alors la prostitution s’est déplacée dans les arrières salles des bistrots alentours. Par contre, la « consommation » se faisait dans des garnis en dehors des débits de boisson….
Alors que des travaux de mise en sécurité du pont de Toulouse vont débuter cette fin de semaine, l’archive du vendredi se propose de revenir sur l’histoire de sa réalisation.
Lorsque le tracé de la ligne Orléans-Bourges du chemin de fer est entériné dans la traverse de Vierzon, le choix a été fait de passer par le centre ville. Déjà, le relief du terrain choisi avait entraîné la réalisation de plusieurs ouvrages d’art, depuis le tunnel de l’Alouette, le tunnel quartier château, le viaduc du chemin des vignes, sans oublier un pont enjambant la route royale numéro 20, pont de pierre à deux arches pour permettre le passage de quatre voies de chemin de fer.
Et la gare est inaugurée en ce mois de juillet 1847. L’intersection que forme Vierzon entre Bourges, Orléans et Châteauroux fait de la ville un nœud ferroviaire qui prend de l’importance. Le nombre des convois est multiplié par dix dès la deuxième année d’existence de la gare ; par vingt dans les cinq ans. Le nombre de voies se révèle rapidement insuffisant. On a beau agrandir le pont avec deux voies et une arche supplémentaire, le résultat reste insatisfaisant. Rajoutez à cela la liaison avec Tours en 1871 et le PO se voit contraint d’agrandir le triage.
Une première fois en 1885 on agrandit le triage. Les voies se multiplient du côté de la rue de Fay. Mais c’est toute l’infrastructure qu’il faut agrandir. Et les premières réflexions s’imposent dès 1899 : Saint Pierre des Corps est saturé : il faut encore agrandir Vierzon. Pour cela on utilisera l’emprise foncière non utilisée du côté de la rue des ateliers. C’était là une réserve foncière de la Cie du PO qui devait permettre de construire des ateliers de réparations des locomotives. Si la rue existe toujours, les ateliers eux, n’ont jamais existé.
Un mal pour un bien : la réserve foncière va permettre l’agrandissement de la gare. Des plans sont actés. Ce sera le plus grand chantier que la gare ait connu depuis sa création. Les travaux commencent dès 1908 : il faut transporter plusieurs centaines de milliers de mètres cube de terre pour installer les voies nouvelles, entre les rues de Fay, Pentecôtes, Ateliers et Cavalier. Des machines spéciales équipées excavateurs fonctionnent vers Fay. En centre ville, ce sera la bonne vieille méthode de la pelle et la pioche. Le chantier demande une main d’œuvre impressionnante. On construira « le village en bois » du côté de Fay, pour abriter les ouvriers du chantier et leur famille. La tradition veut même que ces ouvriers aient participé à l’essor du rugby dans notre cité.
Si l’emprise foncière vers Pentecôtes et Ateliers est suffisante, ce n’est pas le cas du côté de la rue du Cavalier. Et là, deux obstacles sont majeurs : le pont de pierre et son débouché.
Le pont de pierre fait 25 mètres de long. Pour augmenter le nombre de voies et de quais à la gare, il faut en construire un plus grand. Mais il faut aussi raser le talus adjacent. Problème : il y a une usine dessus : la maison Brouhot, construction de matériels agricoles mais aussi d’automobiles.
Brouhot vend dès 1907 à la Cie du PO une partie de son usine, soit 8000 mètres carré selon la banque. Elle en reconstruit une autre sur la commune de Vierzon Villages, lieu-dit Crôt-à-foulon, d’une superficie de 7000 mètres carré, dite « usine nouvelle », nom qu’elle portera jusqu’à sa totale fermeture (aujourd’hui Paulstra).
Reste, pour la compagnie du PO la réalisation de l’ouvrage d’art qui doit remplacer le pont de pierre.
Ce sera Gustave Eiffel ou Armand Moisant ? La question se pose pour le PO dès1905.
Eiffel est le plus connu. Mais Moisant n’est pas un moins bon ingénieur. Tous les deux sortent de Centrale. Tous les deux ont fait leur apprentissage dans les chemins de fer, de l’Ouest pour Eiffel, du Nord pour Moisant. Tous les deux ont créé leur entreprise en 1866, à Levallois pour Eiffel, à Vaugirard pour Moisant. Eiffel a la tour du même nom ; Moisant, outre ses réalisations parisiennes, exportera la technique qui permettra d’ériger le premier gratte-ciel des USA, à Chicago.
La question sera tranchée et Moisant et Cie construiront le pont. Il sera en fer puddlé, rivé à chaud, tout comme la tour Eiffel. Si le pont de pierre avait 25 mètres de long, le pont de fer aura lui 97,60 mètres de long et 11 mètres de largeur. Beaucoup plus long, il comportera deux travées appuyées sur deux pylônes métalliques carrés de 1 mètre de côté. La Dépêche du Berry du 28 avril 1912 annonce que « la chaussée n’a pas moins de 8,50 mètres, et les trottoirs de 1,25 à 1,30 mètre. Le tablier est en ciment armé de 0,30 mètre d’épaisseur environ, recouvert de pavés de bois qui amortissent les chocs et les trépidations ».
Les travaux du pont seul ont duré près de 10 mois, à cheval sur 1911 et 1912. Le 2 avril, la Dépêche fait état de l’avancée des travaux : la Compagnie Moisant a effectué des essais de solidité : des camions chargés de 500 tonnes de remblai sont passés et repassés sur le pont, y ont stationné. Les ingénieurs étaient satisfaits : le fléchissement de la flèche n’était que de 11 millimètres.
Le mois d’avril 1912 sera réservé à la mise en peinture. Ce sera le gris souris du PO qui sera choisi.
Alors que les vierzonnais attendent « leur » pont, l’actualité est chargée en ce mois d’avril 1912. On reparle de la bande à Bonnot lors de son tragique démantèlement. Le 13 avril, Henri Brisson, poseur de la première pierre de l’ENP est mort. Et le 15 avril, c’est le Titanic qui sombre au large de Terre Neuve. Et la veille même de sa mise en circulation, ce sont 700 mètres de fils télégraphiques en cuivre qui sont volés sur le tunnel de l’Alouette...
Enfin le 28 avril, les vierzonnais peuvent s’accaparer le pont, pont de Toulouse. Mais l’histoire ne dit pas si sur le pont de Vierzon on y a dansé...
Pour le PO, les travaux vont continuer. Les talus de l’ancienne usine Brouhot ne sont pas encore disparus, la pose de voies ferrées est encore impossible de ce côté. Il restera encore un an de travaux avant que la rue du Cavalier soit définitivement réalisée et livrée à la circulation.
Le site de Vierzon, confluence du Cher et de l’Yèvre est très anciennement occupé. L’archéologie a montré que l’homme préhistorique y a séjourné depuis plus de cent mille ans, utilisant notamment un atelier de pierres taillées sur le site de Bellon, se déplaçant le long de la rivière Cher, véritable voie commerciale, sur une route allant de l’Angleterre à l’Italie du Nord.
L’invention de l’agriculture il y a quelque huit mille ans pour l’Europe, a sédentarisé les êtres humains. Les populations locales se sont alors accaparé l’endroit le plus élevé du Vierzon d’aujourd’hui : la butte de Sion dans le Vieux Vierzon. Ils savaient y être à l’abri car ayant une large vision périphérique de leur entourage.
Il faudra attendre une époque très postérieure pour voir les premiers éléments religieux émerger du sous-sol vierzonnais. Nous sommes loin de l’agropastoralisme des premiers cultivateurs. Nous sommes face à des éléments du polythéisme antique. Entre-temps plusieurs millénaires sont passés.
C’est sur cette même butte de Sion qu’apparaît, selon la tradition locale, un premier édifice dédié à un culte gaulois. En effet, sous la butte s’écoule une source d’eau pétrifiante qui, après avoir traversé l’actuelle rue Armand Brunet, se jette dans la rivière d’Yèvre en contrebas. Nos ancêtres gaulois avaient une véritable déférence envers les éléments naturels (ciel, pluie, orage, etc.), et c’est ainsi que ce premier lieu de culte était dédié au dieu de la source, très certainement Nemessos. Religion polythéiste, la statuette d’une déesse de la fertilité fut trouvée au Tunnel lors de la construction des HLM. Et un fragment de statuette attribué à Mercure fut également trouvé dans le périmètre de la rue Joffre.
Le christianisme, religion monothéiste du Salut, va se développer, lui, à compter du 1er siècle de notre ère. Défini par saint Paul, parti d’Égypte, il va se propager dans toute l’Europe jusqu’à Lyon où la première mention d’une communauté est attestée en 177. Après la conversion de Constantin, le pape se place au côté de l’empereur qui perd ses attributs divins. C’est avec les communautés de moines que le christianisme va se propager et atteindre les contrées reculées. Si les grands centres urbains sont acquis à la parole du Christ, ce n’est pas le cas des paysans (paganus = païen) des lointaines campagnes. Il faut citer là le rôle important de saint Martin de Tours dans l’évangélisation de notre province. Autre acte fondamental : la conversion de Clovis, en 496. Entre temps l’Empire Romain a vécu. Et la loi franque implique la conversion de tous les Francs…
La diffusion du christianisme se fera en douceur : L’Église va tout simplement christianiser les lieux de culte préexistant. C’est ainsi que le temple païen de la butte va devenir Sion et va devenir lieu de culte chrétien, et la source pétrifiante devenir source Saint Roch. Une statuette polychrome existe toujours dans un jardin de la rue Armand Brunet, non loin du jaillissement de cette source.
Un communauté de moines bénédictins s’installe à Saint Georges sur la Prée en 843, puis déménage à Vierzon en 903. C’est le début développement de la cité de Vierzon.
L’église abbatiale étant interdite aux fidèles, les moines bâtissent une église en pierres pour les paroissiens, dédiée à « la bonne dame ». La tradition veut qu’ils l’installent sur l’emplacement d’une première église en bois. Une première église romane aux fenêtre étroites apparaît au XIe siècle, à l’époque un simple rectangle de pierre, excluant le clocher et le chœur.
La poussée démographique a imposé un agrandissement de l’église au XIIIe siècle. Aujourd’hui Notre Dame est un modèle de réemploi : des bas-côtés et un chœur ont été rajoutés ; les murs de l’église primitive sont devenus les piliers de l’actuelle bâtisse gothique. Cette nouvelle architecture a permis de faire entrer la lumière dans l’édifice par l’intermédiaire des nombreuses baies.
Le dernier élément a avoir été construit est le clocher-porche, au XIVe siècle. Au départ ouvert sur trois côtés, il faut rapidement combler les côtés nord et sud par peur d’un éboulement dû au vent. Ce clocher porche était surmonté d’une flèche qui a été abattue à la Révolution pour permettre de sortir les cloches qui seront fondues à La Charité. Les cloches actuelles datent donc du XIXe siècle et ont en partie été financées par les industriels locaux.
L’église paroissiale va être un lieu de sociabilité par excellence. Les processions à la patronne de Vierzon en sont un exemple. Lorsque les moines s’installent à Vierzon, ils arrivent avec le reliquaire de saint Perpétue qui leur a été donné par le pape. Sainte patronne des moines, elle devient sainte patronne de tous les vierzonnais. Martyrisée à Carthage en 903, ce martyre est commémorée tous ans par une procession, le 7 mars. L’église rassemble alors toutes les classes sociales de la cité. Les religieux de l’abbaye, mais aussi le seigneur de Vierzon qui n’est autre que l’immédiat voisin de l’église. Viennent ensuite les bourgeois de Vierzon, cette classe qui apparaît au XIe siècle et qui va s’enrichir tout au long de l’Ancien Régime. Arrivent enfin les paysans. L’église, au-delà du lieu de culte, est l’endroit où l’on se passe les informations, aussi diverses que la mort du seigneur ou que de la date de la bannie des vendanges, par exemple...
Encore aujourd’hui, décrypter le bâtiment c’est décrypter une partie des us et coutumes des revisionnais des siècles passés…
1995 - 2024. Cela va faire trente ans que la CASE a disparu. Les plus jeunes des vierzonnais aujourd’hui n’imaginent pas les bakoes fraîchement peints sortir de la rue Pierre Sémard, emprunter la rue Debournou pour tourner à droite sur la rue du bas de grange pour être stockés près du canal. Ils n’imaginent plus non plus que le restaurant « la maison de Célestin » ait pu être les bureaux d’une usine qui fit travailler plus de 1500 personnes à son maximum, au début des années 1950.
Mais avant cela, ce fut la « maison du patron » ; celle que se fit construire le fondateur de l’industrie du machinisme agricole dans notre ville : Célestin Gérard. Nous sommes en1856 si l’on en croit le recensement de population qui atteste alors de sa présence à cet endroit. L’archive du vendredi a déjà relaté un épisode de sa vie lié à la concurrence industrielle. Il est temps aujourd’hui de revenir sur son aventure vierzonnaise.
Pourtant, Célestin n’est pas d’ici. C’est le hasard qui lui fait rencontrer notre ville.
C’est un vosgien, né à Monthureux-le-sec le 13 février 1821. Célestin n’est que son deuxième prénom. Il se prénomme en fait Alexandre. Il quittera jeune la ferme de son père pour devenir menuisier, Compagnon du Tour de France. De retour dans la propriété familiale, il fabrique pour son père une petite batteuse à bras. Leur voisin la remarque et veut la même. Gérard lui construira alors son modèle.
Ce voisin en question deviendra plus tard régisseur d’un château en Loir et Cher. Il fait à nouveau appel aux services de Célestin pour lui construire des batteuses. Ces matériels sont vus par d’autres propriétaires qui demandent à Gérard de leur construire les mêmes. C’est comme cela qu’il s’installera à Vierzon, non loin de ses nouveaux clients de Sologne ou de Champagne berrichonne.
En octobre 1848, il ouvre en face de la gare (inaugurée un an plus tôt) un atelier de fabrication de machines agricoles, batteuses à bras, tarares, coupe-racines. Il a alors tout juste 27 ans et met toutes ses économies dans ce projet qu’il démarre avec trois ouvriers puis huit…
Pour se faire connaître, Gérard invente une nouvelle manière de faire de la publicité : il présente lui-même ses matériels dans les fermes qu’il visite les unes après les autres. Il se propose même de battre les grains à ses frais. Le succès est présent, il est temps de faire payer ses prestations : il devient alors le premier entrepreneur de battage : ses ouvriers vont battre de ferme en ferme moyennant rémunération.
Une personne sera importante pour lui : son épouse, qui deviendra la numéro deux de son entreprise : « ateliers Célestin Gérard ». Il retourne dans les Vosges en 1852 pour épouser Madelaine Lauter. Elle devient rapidement comptable de l’entreprise. Par acte notarié de 1857, Gérard lui donne procuration pour prendre toutes les décisions à sa place. Elle peut comparaître et ester en justice, signer tous les actes de toutes natures en lieu et place de son époux.
Entre temps il participe à diverses expositions agricoles qui lui permettent de remporter de nombreux prix.
Et surtout, en 1866 il invente la première batteuse mobile. Présentée à l’Exposition Universelle de 1867, elle lui permettra de se voir décernée la Légion d’Honneur des mains mêmes de Napoléon III.
Un deuxième personnage arrive également au sein de l’entreprise familiale : Louis Merlin. En 1863, Gérard part à Orléans le débaucher de son ancien travail et lui demande d’assurer la tâche de contremaître pour diriger les travaux d’ajustage des tours et forges et la construction des machines à vapeur (invention 1862) et à battre.
Quinze ans plus tard, au moment où Gérard va revendre son entreprise, Merlin lui enverra une lettre pour le remercier de sa confiance tout en laissant entendre son importance : « l’entreprise que nous avons créée... ». La lettre de se terminer par « quant à moi, j’attends les événements qui me guideront sur ce qui me reste à faire... » En fait, Merlin démissionnera pour ouvrir à quelques encablures de là, rue de la République, sa propre entreprise de construction de matériels agricoles.
Durant ses trente ans à la tête de son entreprise vierzonnaise, Gérard aura accumulé plus de 300 médailles dans diverses expositions, locales, nationales et même internationales.
Il vend alors une entreprise florissante de 500 ouvriers à Lucien Arbel, alors sénateur de la Loire, mais surtout propriétaire des forges de Rives de Gier et de Couzon, fabriquant de matériels roulant pour le chemin de fer. Auguste Barthe, directeur de la tuilerie de Vierzon mais aussi administrateur des forges de Gier, lui avait soufflé la bonne affaire.
Gérard restera administrateur de la nouvelle entreprise créée : la Société Française de Matériels Agricoles, que tout le monde appelle dorénavant « la Française ». Plusieurs fois au bord de la faillite, elle se diversifie et lance un nouveau matériel en 1934 : le tracteur à boule chaude. Malheureusement la concurrence américaine du plan Marshall va mettre l’entreprise en difficulté. Les banques vont alors faire rentrer CASE au capital de la Française en 1958. Le géant américain va rapidement devenir majoritaire. Et va transformer l’usine vierzonnaise en simple lieu d’assemblage des bakoes, tracteurs de travaux publics…
Quant à Gérard, ayant revendu son entreprise, il déménage de sa maison face à la gare pour le château de Fay. C’est là qu’il décède en 1885 à tout juste 64 ans.
Dans différentes chroniques passées, l’archive du vendredi a relaté divers faits d’armes des seigneurs de Vierzon. Ils apparaissent notamment dans le cartulaire de Vierzon, recueil des chartes des moines de l’abbaye Saint Pierre de Vierzon. En filigrane on peut suivre leurs activités principales (selon le cartulaire) : faire la guerre et donner des libéralités en vue du repos de leur âme (souvent au bénéfices de l’abbaye).
Le cartulaire, daté de 843 à 1150 environ ne donne qu’un court – mais indispensable – aperçu de la famille des seigneurs de Vierzon qui se sont succédés au château de Vierzon. Il faut aller voir d’autres textes, archives de Blois, de Lyon, archives épiscopales voire papales ou archives nationales pour compléter nos connaissances et ainsi aboutir à une vision quasi complète de la généalogie des seigneurs vierzonnais. Et le chercheur du XXIe siècle a un avantage incroyable : internet. Beaucoup de textes sont disponibles en ligne. Si ce n’est le cas, un scan de bonne qualité peut être rapidement transmis. Cela pallie un peu le manque de documents dû à la période étudiée (Haut Moyen-Âge) et a considérablement avancé la recherche sur le Berry en général et sur Vierzon en particulier...
Selon le cartulaire, le premier seigneur de Vierzon est un certain Ambran (Ambrannus), qui donne aux moines des terres à Vierzon (virsio), Neuvy, Vouzeron et Lury lors de la fondation du monastère, en 843. Mais Ambran a-t-il jamais existé ? En effet les historiographes ont montré la fausseté des chartes de fondation. Pourtant dans ces mêmes chartes, on voit apparaître un autre personnage Centulphe (Centulf) qui donne des terres aux moines de Vierzon en terre agenaise. Cette donation et ce nom de Centulphe n’apparaissent qu’une seule fois dans le cartulaire.
Si l’existence même d’Ambran peut être sujet à caution, quel intérêt avaient les moines de faire intervenir Centulphe, alors qu’ils n’auront jamais de velléités de faire respecter leur lointaine possession ? L’onomastique montre que nous avons à faire à un personnage d’origine wisigothe. Ce peuple a été poussé vers l’Aquitaine et l’Espagne lors de l’invasion franque. Il est donc très plausible que Centulphe ait bien existé comme seigneur agenais. Les historiens locaux du XIXe siècle ont imaginé une affabulation des moines. Il est néanmoins envisageable que, se trouvant côtoyant les donateurs locaux, un seigneur agenais ait participé à doter l’abbaye naissante de Dèvres-Vierzon. C’est là une théorie apparue avec Guy Devailly, en 1963.
Exit Ambran donc. Il faut chercher ailleurs le nom du premier possesseur de la terre de Vierzon.
Là encore ce sont les moines qui vont avoir la réponse.
Une charte de 990 et signée de André abbé de Saint Pierre de Vierzon raconte une bien curieuse histoire : un chevalier (ce terme désigne alors un homme libre, combattant, suffisamment riche pour posséder un cheval ; il n’y a pas encore de connotation de noblesse) dénommé Humbaud dit le tortu (rusé) s’est mis à la disposition des moines pour combattre leurs ennemis. En récompense les moines lui ont donné un terrain contigu à l’église Notre Dame pour qu’il bâtisse une « habitation fortifiée ». Les moines donnent également une partie de leurs vignoble qui deviendra le clos du seigneur (aujourd’hui le Clos du Roi). Ils donnent enfin une portion de la rivière d’Yèvre et le bois qui en dépend (le bois d’Yèvre).
La charte suivante est datée de 991 et le nouvel abbé de Saint Pierre est Syon. Il confirme la donation à Humbaud de la terre contiguë à l’église. Et c’est le nom d’abbé Syon qui serait à l’origine du nom de la butte de Sion, emplacement du premier château (en bois) des seigneurs de Vierzon.
Comme ces textes sont à la grandeur des moines, Humbaud leur rendit foi et hommage et leur prêta serment de fidélité et souhaita que sa conduite fût imitée par ses successeurs.
Là encore, ce texte outrepasse la réalité et sert les intérêts des moines. Ce texte de 991 montre comment Humbaud, grand ancêtre du lignage de Vierzon détient son fief des moines, ce qui rend ces derniers supérieurs à la famille d’Humbaud.
Une nouvelle fois dans une charte d’Arnould arrière petit-fils de Humbaud, en 1090, la même histoire est racontée. Humbaud est alors qualifié de seigneur de Vierzon et il est rappelé l’origine de propriété du fief : les moines de Saint Pierre.
La réalité est toute autre.
Humbaud le tortu tient Vierzon du comte de Blois Chartres et Chambord, Eudes. Ce sont des liens de féodalité naissante qui se créent entre Humbaud et son suzerain Eudes vers 990. La terre de Vierzon, qu’on ne pouvait pas encore appeler fief, était rattachée à celle de Blois dont Eudes était le propriétaire.
En recherchant dans la généalogie des comtes de Blois, on ne trouve aucune mention d’un Ambran. Le grand ancêtre était Thibault le Vieux, possesseur de la vicomté de Tours dans les années 860. C’est à cette époque que les vikings combattent dans le nord de la France. Et le royaume se voit réduit par la combativité des Normands d’un côté et celle des Bretons de l’autre qui avancent jusqu’aux portes d’Angers et du Mans. Le vicomte de Tours est alors le dernier rempart avant le centre de la France.
Son fils Thibault le Tricheur (vers 920) aura des velléités d’indépendance pour reformer l’ancien royaume de Neustrie. Il n’ira néanmoins jamais jusqu’au bout de ses idées, restant fidèle aux robertiens (Robert, grand-père de Hugues Capet). On parle régulièrement du Tricheur comme du premier seigneur de Vierzon. Rien n’est moins sûr. Il est au contraire fort probable que se soit son fils Eudes qui érige Vierzon en fief. Cherchant un protecteur pour ses moines de Vierzon, il envoie Humbaud de Bélesme à Vierzon et lui octroie la seigneurie de Vierzon qui englobe à l’époque Mennetou sur Cher, Lury et Selles sur Cher. Vierzon n’est qu’une simple place forte, le château principal d’Humbaud étant situé commune de La Ferté Imbaud, au plus près de son seigneur Eudes.
Mais malgré tout les libéralités des moines de Saint Pierre vont faire de Vierzon une terre financièrement intéressante (le fils de Humbaud le Tortu est surnommé « le riche »). Les successeurs vont alors s’y installer à demeure, augurant la généalogie des seigneurs de Vierzon.
Mais cela est une autre histoire prochainement contée…
Pour essayer de mettre un terme à la banqueroute qui s’annonce, Louis XVI convoque le 24 janvier 1789, les États Généraux pour le 27 avril.
Chaque circonscription de bailliage (tribunal) doit élire ses députés et rédiger ses cahiers de doléances.
Et chaque ville de la province eut cette même aspiration : « que les élections fussent libres, que le nombre' de député de chaque bailliage fut déterminé d'après l'étendue, la population et la richesse du territoire, que le tiers état, comme le plus nombreux, le plus instruit, le plus riche des trois ordres du royaume, eut à lui seul autant de députés que les deux autres… et choisis uniquement dans son sein... » Par ces quelques lignes, on comprend déjà que c'est le monde des bourgeois, roturiers ou de robe qui vont chercher à mener les débats. Surtout si,on ajoute un autre cheval de bataille du tiers : le vote par tête dans la future assemblée, et non le vote par classe. Nous ne sommes pas loin de la déclaration que la nation vaut le prince. Et cela a tendance à irriter le duc de Charost, gouverneur de province, qui taxe l' agitation des villes de « délire de l'effervescence ».
Le tiers état se réunit, pour Vierzon Ville le 27 février 1789 et les 44 corporations se réunissent sous la présidence de Simon du Peron faisant fonction de Maire (le maire est en fait le Comte d’Artois, apanagiste).
Vierzon Ville rédige dans la foulée ses cahiers de doléance. Le secrétaire de séance est BAZIN, instituteur public, qui aura d’autres rôles pendant la période révolutionnaire.
De son côté l’assemblée des Villages de Vierzon se réunit au bailliage sous la présidence du lieutenant général et rédige également ses cahiers.
Enfin Méry se réunit dans son coin et procède de même.
Le 3 mars, l’assemblée du Tiers Etat se réunit au siège du bailliage et fait la synthèse des 3 registres de doléances (texte ci-dessous).
François Furet parlait de « révolution bourgeoise » pour qualifier le mouvement de 1789. Les cahiers de doléances vierzonnais sont en ce sens typiques de ceux émis à l’échelle du pays. Il n’ya qu’à étudier le vocabulaire employé pour s’en convaincre...
On élit alors 4 députés qui porteront à Bourges les cahiers de Vierzon. Le 16 mars à Bourges a lieu la réunion des Trois Ordres.
Il en sort 4 députés qui iront à Paris (aucun vierzonnais).
La suite on la connaît.
Le 20 juin, le serment du jeu de paume. L’assemblée se proclame assemblée Nationale et jure de ne séparer qu’après avoir donné à la France une Constitution. C’est le régime de la Constituante jusqu’en septembre 1791, date de la première constitution où la France devient monarchie Constitutionnelle...
Cahiers de Vierzon
Article 1 :
Que la gabelle soit entièrement supprimée, ou s’il n’est pas possible, que le sel qui est de première nécessité pour les hommes, très utile à la santé des animaux et qui coûte à Vierzon 13 sous 9 deniers soit fixé à un prix modique et uniforme dans tout le royaume.
Article 2 :
Que les aides, droits réservés, don gratuits et octroi soient supprimés, ainsi que les droits pérennes sur les cuirs.
Article 3 :
Que les droits d’entrée établis d’abord pour six ans et continués jusqu’à ce jour sur les bois, vin, foin et bestiaux entrant et même passant par cette ville soient supprimés comme indûment prorogés et ruineux pour les habitants par les exactions qui accompagnent sa perception..
Article 4 :
Que la banalité des fours et moulins soit supprimée en indemnisant les propriétaires.
Article 5 :
Que les poids et mesures et aunages soient les mêmes par tout les royaume.
Article 6 :
Que le droit de mouture que les meuniers de Vierzon perçoivent au douzième soit réduit au seizième, comme dans la majeure partie de la province.
Article 7 :
Que le millier de bois de mairin qui se compte de 18;23;36 et 69 cent, ce qui induit en erreur les vendeurs, ne soit partout compté que de dix fois cent.
Article 8 :
Que la corvée aujourd’hui convertie en argent pour la confection et entretien des grandes routes et chemins vicinaux soit supportée par les trois ordres de l’état et les privilégiés.
Article 9 :
Que l’adjudication en soit faite d’après le devis de l’ingénieur du département par les officiers municipaux et syndic dans les mains desquels les fonds destinés seront versés pour payer directement les entrepreneurs.
Article 10 :
Que les douanes seront récoltées aux frontières du royaume et les péages, droits forains et des marchés ordinaires soient supprimés dans l’intérieur du royaume pour la facilité du commerce.
Article 11 :
Qu’il soit permis à tout propriétaire de vigne de vendanger quand bon lui semblera, en payant la dîme.
Article 12 :
Que le contrôle des actes, quant aux droits de finances soit supprimé, et rappelé pour la sûreté publique, à son premier régime.
Article 13 :
Que la franc fief impôt ruineux par les contestations qu’il fait naître entre les services des domaines et les redevables, qui avilit le tiers état par l’origine de son institution, et dont le motif de l’établissement ne subsiste plus, soit pareillement supprimé.
Article 14 :
Que les droits et offices de jurés priseurs dont le privilège exclusif est gênant et onéreux, soient supprimés.
Article 15 :
Qu’il soit permis de rembourser le droit de terrage, et les rentes seigneuriales et ecclésiastiques tant en grains qu’en argent.
Article 16 :
Que Sa Majesté permette l’aliénation de ses domaines dont les frais de l’administration diminuent considérablement le produit, et leur prix employé à payer une partie de la dette nationale.
Article 17 :
Que les apanages des princes actuellement engagés soient remplacés par une rente annuelle payée par le trésor royal.
Article 18 :
Que l’ordonnance militaire qui exclut les roturiers du service comme officiers soit abrogée, comme décourageante et avilissante pour cette classe de citoyens qui dans tout les temps s’est distinguée par la noblesse de ses sentiments et sa bravoure.
Article 19 :
Que pour remplacer la Milice contraire à notre Liberté, et qui enlève des hommes précieux aux arts et à l’agriculture, la Commune soit autorisée à fournir à ses frais des hommes de bonne volonté.
Article 20 :
Que les ordonnances civile et criminelle soient réformées, que les bailliages aient la faculté de juger en dernier ressort jusqu’à 4000 livres, et les présidiaux jusqu’à 10 000 livres auxquels il sera attribué le pouvoir de juger définitivement les criminels.
Article 21 :
Qu’il soit fait un nouvel arrondissement des provinces et des bailliages, l’un pour la facilité de l’administration, et de payement des impôts, l’autre pour éviter au peuple des transports ruineux et lui procurer une prompte justice.
Article 22 :
La ville de Vierzon en faveur de sa population et de son commerce, et de sa situation qui la rend susceptible d’un accroissement considérable, demande que son bailliage composé seulement d’une partie de la paroisse et de celle de Méry en entier, s’étende au moins à quatre lieues de circonférence, et que les privilèges étant entièrement abolis, il n’y a plus d’inconvénients qu’il soit ordonné qu’un seul individu ne puisse posséder plusieurs charges.
Article 23 :
Que la taille, ainsi que les accessoires et les vingtièmes soient supprimés, qu’on y substitua la subvention territoriale en nature ou argent sur toutes les terres et autres objets de produit, soit qu’ils appartiennent au Roy, aux princes apanagistes, au clergé, à la noblesse ou à qui que ce soit des trois ordres ; et que le fermier de cet impôt ne pourra l’être que d’une paroisse. La noblesse ne défendant plus comme autrefois l’état à ses frais mais étant payée sur les taxes imposées au tiers état, tout privilège et exemption en fait d’impôt ne doivent plus subsister.
Article 24 :
Que les négociants, marchands, capitalistes, rentiers et artistes soient assujettis à un impôt proportionnel autant qu’il sera possible à la subvention territoriale, ainsi qu’il sera jugé par la commune dans une assemblée générale qui se tiendra tous les ans et pour assujettir les marchands forains à cet impôt, ils seront obligés d’avoir un domicile connu.
Article 25 :
Qu’il soit fait un nouvel aménagement des forêts du royaume, la disette des bois s’y faisant déjà sentir, même dans la province de Berry jadis couverte de vastes forêts qui fournissaient des bois de tous espèces.
Qu’il soit ordonné de nouvelles plantations dans les landes immenses qui entourent les forêts languissantes qui restent et qu’on oblige aussi les gens de Mainmorte à replanter les bois qui ont été détruits, et qu’ils détruisent journellement avec tant d’avidité, sous prétexte de réparations qu’ils ne font pas.
Article 26 :
Que l’aménagement demandé par l’article précédent devient d’autant plus nécessaire aux villes de Bourges, Mehun, Vierzon et paroisses circonvoisines qu’en 1776 il a été établi une forge près de cette dernière ville pour l’affinage de laquelle il se coupe annuellement dans la forêt qui l’avoisine 400 arpents de bois, ce qui, es épuisant cette forêt, privera totalement les habitants de ces villes de cette denrée de première nécessité, les forcera à les abandonner, n’y ayant presque point de bois (?), ni ,de mines de charbon connus dans la province.
Le prix des bois étant à la discrétion d'un seul fermier a triplé depuis 1776, et on est menacé d'une plus grande augmentation si le prix n'en est fixé.
Article 27 :
Qu'il ne soit accordé des grâces et des pensions qu'au mérite, et aux services rendus à la Patrie et à l'humanité.
Article 28 :
Que les députés du tiers état auront aux états généraux voix délibérative par tête et non par ordre.
Article 29 :
Que le Berry sera érigé en Pays d'état sous le même régime que le Dauphiné.
Article 30 :
Que les officiers municipaux soient supprimés et remboursés et les officiers élus par la commune à la pluralité des voix de trois ans en trois ans.
Quoique ledit du mois de septembre 1771 développe tous les avantages des offices municipaux en charge, et les abus qui résultent de la voie d'élection, cependant s'il en doit résulter un meilleur ordre et le bien de la Patrie, les officiers municipaux de Vierzon demandent eux-mêmes le remboursement de leur charge.
Article 31 :
Que les états provinciaux seront autorisés à répartir et faire lever l'impôt dont ils feront passer le produit directement au trésor royal.
Article 32 :
Qu'il soit permis, comme dans les pays de droit écrit, de prêter sur obligation remboursable à terme.
Article 33 :
Que le cahier des doléances, plaintes et remontrances tel qu'il sera arrêté dans l'assemblée générale de la Province, sera rendu public par la voye de l'impression.
Article 34 :
Que le compte des recettes et dépenses de l'état soit rendu public à chaque terme des états généraux par la voye de l'impression.
Fait et arrêté en l'hôtel de ville de Vierzon, le mardi trois mars mil sept cent quatre vingt neuf.
Il a une rue à son nom à Vierzon. Pourtant certainement peu nombreux sont ceux qui connaissent encore l’étendue des activités de ce vierzonais d’adoption, décédé il y a mainteant plus de 80 ans.
Il est né dans le Pas de Calais en 1872. Ses études, il les fera à Paris, élève chimiste. C’est durant ses années étudiantes qu’il adhère au socialisme. Tout d’abord en créant un groupe au sein de son école puis en adhérant au CRC comité révolutionnaire central. Il devient alors journaliste-imprimeur-publiciste et imprime nombre de journaux socialistes. Il devient proche de Jean Jaurès, Albert Thomas ou Aristide Briand. Parallèlement il prend part à des actions et manifestations anticléricales, antigouvernementales, l’affaire Dreyfus bat alors son plein...
Mais aujourd’hui l’archive du vendredi va s’intéresser au scientifique qu’était Jules Louis Breton.
Tout d’abord par son rôle en temps que député à l’Assemblée Nationale. Il est élu dans le Cher en 1898, reprenant le siège d’Eugène Baudin.
Ingénieur chimiste, une des premières lois qu’il fait adopter, est l’interdiction des peintures au zinc et au plomb, qui sont très toxiques pour les peintres en bâtiments. Réélu sans cesse jusqu’en 1914, il est député touche-à-tout, traitant tous les thèmes de la prévoyance, depuis les habitations à bon marché, jusqu’au repos des femmes enceintes. Sans oublier sa loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, dont une grande partie lui a été soufflée par un autre vierzonnais : le porcelainier Marc Larchevêque.
Lorsque la guerre éclate, il devient en 1915 sous-secrétaire d’État des « inventions intéressant la défense nationale », alors sous la responsabilité du ministère de l’Instruction publique. C’est à ce titre qu’il fera lui-même du lobbying pour que l’armée française adopte le char d’assault et passe des commandes massives à Renault et Schneider.
Après guerre le développement des inventions est divisé en deux branches, civile et militaire. Breton rejoint alors la branche civile qui se crée en 1919 : « la direction des recherches scientifiques et industrielles », toujours au sein du ministère de l’Instruction publique. Cette direfction devient « Office national des recherches scientifiques et industriels et des inventions, ONRSII » en décembre 1922, avec toujours Breton à sa tête. Enfin elle changera définitivement de nom en 1939 pour devenir « Centre national de la recherche scientifique, CNRS » en 1939.
Entre-temps il aura été appelé en 1920 par Alexandre Millerand à prendre le ministère de l’hygiène, assistance et prévoyance.
A la tête de l’ORNSII, il a l’idée de promouvoir les inventeurs en leur permettant de faire connaître leur travail. Mais dans l’esprit de Jules-Louis Breton ce salon doit être tout sauf un concours Lépine bis. Il s’agira de concourrir au progrès social, de prendre en compte l’hygiène et le confort, l’habitat, tout le travail de son ministère...
Il invente alors l’expression d’« arts ménagers », c’est-à-dire l’art d’organiser la vie domestique dans tous ses aspects. C’est ainsi qu’une « exposition d’arts ménagers » ouvre ses portes en octobre 1923 au Champ de Mars, dans un hangar récupéré de la foire de Paris. Cette exposition prète à sourire. L’Intellegensia parle du « salon de la poêle à frire ». C’est néanmoins une expérience très concluante : plus de cent milles visiteurs ont parcouru les allées ; quatre cent milles la deuxième année ; le cap du million de visiteurs est franchi en 1950.
Breton s’est aperçu que les appareils ménagers français brilaient par leur absence. Inventeur lui-même, il fonde la « Société anonyme de construction d’appareils ménagers SACAM » qui diffusera notamment sa première invention pésentée dès l’année suivante au salon de 1924 : le motolaveur, véritable machine à laver la vaisselle, déclinable pour particuliers comme pour collectivités. Par la même occasion Breton invente la publicité moderne : la SACAM fait appel a des cinéastes et modèles (dont sa fille) pour présenter les matériels sensés faire rêver celle que l’on ne nomme pas encore la ménagère de moins de 50 ans.
En 1925 l’exposition des arts ménagers devient « salon des arts ménagers » et se retrouve au Grand Palais.
Sa passion pour l’invention lui prend énormément de temps et Breton laisse la direction du Salon des arts ménagers à ses deux fils : Andre Jules-Louis et Paul. André Jules-Louis s’essaye à la politique, succédant à son père comme député socialiste du Cher de 1928 à 1936. Paul prend alors seul les rènes du Salon à partir de 1929. Il aura une longévité exceptionnelle puisqu’il dirigera le Salon jusqu’en 1977, mettant peu à peu l’accent sur le design.
Jules-Louis Breton, la maladie s’accentuant, lâche la politique en 1928, n’apparaissant plus en public. Il se consacre à ses propres travaux qui lui permettront de soulager la paralysie qui l’emprisonne. Il invente les outils qu’il peut actionner avec la bouche seule et peut ainsi communiquer et continuer son travail de scientifique. Il est décédé en 1940.
Quant au Salon qu’il a créé, il n’a pas longtemps survécu au départ de son fils Paul. Dans les années 1960 l’ingénieur est remplacé par le commercial ; les grandes enseignes ont remplacé les marques elles-mêmes. Apparaissent de nouveaux magasins (darty, conforama…) qui produisent leurs propres « objets ménagers ». Paul Breton Jette l’éponge en 1977, alors que les Trentes glorieuses sombrent dans la crise pétrolière. Le dernier salon a lieu en 1983...
L’archive du vendredi a déjà à de nombreuses reprises évoqué l’abbaye Saint Pierre de Vierzon et ses moines bénédictins, communauté à l’origine de l’expansion de notre cité à partir du 10e siècle.
Mais les moines de Saint Pierre sont loin de former la seule communauté religieuse de Vierzon. Il existait également les sœurs de la charité que nous avons évoquées dans l’archive du vendredi consacré à l’Hôtel-Dieu. Il existait encore le couvent des chanoinesses du Saint Sépulcre dans le Vieux Vierzon. Il existait enfin le couvent des Capucins, objet de notre chronique de ce jour.
L’ordre capucin est officiellement né en 1528 et les frères mineurs franciscains doivent leur nom à la « capuche » qu’ils portent, contrairement aux moines des autres ordres. La Réforme luthérienne avait montré les abus et la décadence de la pratique religieuse des catholiques. La Contre Réforme tendait à redonner une pratique vertueuse aux réguliers comme aux séculiers. C’est dans ce contexte que le pape autorise ce nouvel ordre des Capucins. Par leur exemplarité, ils doivent participer à raviver la foi catholique des fidèles.
Franciscains, ils ont fait vœu de pauvreté. A ce titre, la population peut subvenir à leurs besoins. Dans les archives, on remarque que la municipalité s'occupe également de leurs subsides. Lors des marchés, les produits exposés sont toujours contrôlés par les garde-jurés : on fait attention au poids et au prix des denrées, notamment sur le pain. En 1696, sur plainte des habitants, les boulangers ont été contrôlés. Le pain n’est « pas en quantité suffisante ni du poids légal » : il est saisi et sera distribué à part égale entre les pauvres de l’Hôtel-Dieu et les capucins.
De même l’année suivante, lors de la foire aux laines de Vierzon, les étoffes et laines à vendre ont été contrôlées. « Quatre petites toisons ont été confisquées au profit desdits capucins ».
Les Capucins se sont installés à Vierzon en 1612. Béchereau explique que ce sont les habitants de Vierzon qui ont offert l'emplacement de leur futur couvent qui va de la Croix Blanche jusqu’à l’Yèvre. En fait les terres utilisées étaient en haut (square Péraudin) un vieux cimetière abandonné et la partie basse appartenait à l'abbaye Saint Pierre qui s'est fait un plaisir de revendre sa portion à la ville. Le montant de la transaction est aujourd'hui inconnu, mais en 1685, soixante dix ans après leur installation, la ville paye toujours une rente aux moines de Saint Pierre pour cette terre. Et c'est Claude de la Châtre, baron de Maisonfort (Genouilly), qui fait bâtir à ses frais leur couvent et église. D’ailleurs l’église est sous le vocable de Saint Claude. En 1612, la Châtre était maréchal de France, gouverneur du Berry depuis 1594. Il fut très catholique durant les guerres de religion, un temps Ligueur, ce qui peut expliquer cette fondation destinée à relancer la ferveur catholique.
Le couvent des capucins a donc été construit sur un vaste ilôt entre les actuelles rues de la Gaucherie, Péraudin et Debournou. Si la rue de la Gaucherie, se termine aujourd’hui à angle droit, c’est qu’il a fallu la détourner pour laisser l’emplacement au couvent. En 1612, l’avenue de la République n’existe pas encore. Hormis la rue de la Gaucherie, on accède au couvent par l’actuelle rue Victor Hugo. C’est à ce moment-là qu’elle prend le nom de rue des capucins.
Le carrefour prend également le nom de « carrefour de la Croix Blanche » à cette époque. Là, les avis divergent. Certains pensent que c’est à cause d’une croix qui était à l’entrée du vieux cimetière. D’autres pensent qu’il s’agissait de la croix apposée pour matérialiser l’entrée du couvent. Quoi qu’il en est, la Révolution a détruit cette croix mais le nom est resté.
La création des routes royales 20 et 76 ne date que de 1740. On construit alors l’actuelle avenue de la République. Elle prend logiquement le nom de « rue neuve des capucins », autrement dit la nouvelle rue qui mène au couvent.
De la vie même des capucins, on ne sait rien. Il n’existe pas d’archive sur leur passage à Vierzon qui aura pourtant duré près de 200 ans. Quelques allusions uniquement. Et des bâtiments… Tout comme l’abbaye saint Pierre, le couvent des capucins fut vendu comme Bien National à la Révolution. Par contre, Lemaître nous apprend que le dernier supérieur capucin fut enfermé en 1797 puis déporté sur l’île de Ré en septembre 1798, où il mourut un mois plus tard à l’âge de 64 ans. Tout comme Saint Pierre, les bâtiments changèrent de mains à de nombreuses reprises.
L’église, quant à elle, a connu une élection : En effet le général des habitants s’y était réuni pour l’élection de son maire : Claude Barré, élu le 30 août 1789.
La propriété fut morcelée à de nombreuses reprises. Ajasson de Grandsagne y installe une entreprise de porcelaine qui sera agrandie par ses successeurs : Alexis puis Marc Larchevêque. Le haut de la propriété va devenir plus tard la clinique Champion, après démolition de l’église.
Le bâtiment conventuel, lui, était encore visible en 1968. Il a très longtemps été utilisé par l’association des consommateurs « la Ruche » comme entrepôt, rasé après que la Ruche a été relogée aux forges. Enfin, l’actuelle place Péraudin, ancien cimetière, fut aménagée en jardin public en 1905, date à laquelle elle prend le nom de place de la République. Cela rappelait 1848, date à laquelle on y plantait l’arbre de la Liberté…
Format un peu particulier que cette archive du vendredi. Il s’agit de se remémorer l’ancienne librairie de la rue Voltaire, en essayant de montrer l’importance qu’elle a eue dans l’histoire et pour l’image de la ville.
Aujourd’hui magasin de lunettes, la librairie avait deux entrées : une au 16 rue Voltaire et une place du petit mail Aristide Briand.
C’est une des plus anciennes librairies de Vierzon. Elle existait déjà du temps de la Terreur, en 1793. Auparavant un marchand de papier était répertorié dans l’actuelle avenue de la République. Quant aux parchemins, sous l’Ancien Régime, on pouvait en trouver dans la grand-rue rue Maréchal Joffre.
Cette librairie prend le nom de Poivert en 1901, du nom de son nouveau propriétaire. Et deux générations vont s’y succéder.
Gustave Poivert, en plus de la traditionnelle vente des livres, encres et plumes, va plonger sur un nouveau support qui fait alors fureur depuis sa création en 1900 : la carte postale. De 1900 à 1903, le recto était divisé en deux : partie image et partie correspondance ; le dos était réservé à l’adresse du destinataire.
En 1903 on divise le dos en deux : à gauche la correspondance, à droite l’adresse du destinataire. Le recto est alors tout entier dédié à une photographie représentative.
A ce jour, on ne répertorie pas moins de 13 éditeurs de cartes postales, tous styles confondus, anciennes comme modernes. Nombreux sont les clichés qui sont identiques d’un éditeur à un autre. Mais la maison Poivert est certainement la maison qui a le plus de modèles différents. Et surtout, Poivert inaugure : il ne se contente pas de faire photographier tel ou tel monument comme l’église ou le beffroi. Il va faire photographier les événements importants dans la ville : les fêtes publiques, les communions, les photos de classe... La vente de cartes postales est une grand succès pour la librairie… Et permet aujourd’hui de connaître et montrer le Vierzon de l’époque !
A partir de 1925 environ, c’est la deuxième génération de Poivert qui entre en scène. Après Gustave, voici Paul. Il agrandira le magasin et créera une activité d’imprimerie en plus de la librairie. De sa presse d’imprimerie sortiront les prospectus des magasins locaux, les nouveautés des modistes, les productions des marchands de meubles, le catalogue de Noël des jouets de tel autre magasin, les faire-part de mariages... Il imprimera également les lettres à en-tête de tous ces magasins ou entreprises. Aujourd’hui encore, ces documents sont tout autant collectionnés que les cartes postales elles-mêmes.
Et Paul Poivert jouera un rôle politique – à son corps défendant – dans les années 1927 1936. En effet, nous sommes dans la période où les quatre Vierzon jouent la farce de la Réunification. Un pas en avant, deux en arrière… Poivert et un complice qui n’est autre que Dehaullon, propriétaire des Nouvelles Galeries voisines vont fonder un journal satyrique local : le Cocorico vierzonnais. Il s’agit d’une sorte de Canard enchaîné local. Seul le nom du volatile change. Tous deux écrivent sous des pseudos. S’il est de notoriété publique que le journal est imprimé chez Poivert, personne ne connaît le nom des gratte-papier. 6000 exemplaires sont produits par mois. Pour une population vierzonnaise de 24000 habitants, c’est un vierzonnais sur quatre qui est abonné. Le journal ne fait pas de politique en soit. Sa ligne éditoriale, c’est la Fusion. Les articles sont tous tournés en ce sens. Avec cette idée directrice : une seule mairie réduirait les coûts pour les contribuables, quelle que soit la couleur politique du maire. Œuvrant sans relâche pour la Fusion, le journal se sabordera en 1936, un an avant la Fusion des quatre Vierzon le 8 avril 1937.
Enfin, dernière histoire retraçant la librairie, l’activité clandestine de Poivert durant la deuxième guerre mondiale. Comme imprimeur, il fut mis à contribution par l’occupant allemand dès juillet 1940. Il fallait alors imprimer des papiers administratifs dans les deux langes, français et allemand. Notamment les premières autorisations de passer la Ligne de Démarcation. Le travail débute toujours avec l’impression d’imprimés « test ». En l’occurrence Poivert imprimait beaucoup de pages test… qui se retrouvaient entre les mains des résistants, passeurs, qui ainsi faisaient de vrais faux laisser-passer. Cela valut à Poivert une enquête administrative en 1941. Les Allemands n’ont rien pu lui reprocher…
Au tournant des années 1950, C’est un autre personnage emblématique de Vierzon qui va reprendre la librairie du 16 rue Voltaire : Monsieur Paul Carré, que de nombreux vierzonnais auront connu avec son éternelle blouse grise.
Avant d’être libraire place Briand, Paul Carré fut horloger place Foch. Et il a pris sa retraite à l’âge vénérable de 88 ans, en 1998, baissant définitivement le rideau de la librairie imprimerie qui existait là depuis plus de deux siècles…
Les archives préservées du Vierzon médiéval débutent en 1422 et sont consultables aux archives départementales. Nous sommes en pleine Guerre de Cent Ans et le roi Charles VI a définitivement sombré dans la folie. Charles VII roi de Bourges lui succédera l'année suivante.
La folie de Charles VI avait entraîné une guerre civile parmi les nobles pour diriger la régence, entre Bourguignons (qui vont s'allier à l'Angleterre) et Armagnacs (restés alliés à Charles VII).
Le roi anglais Henri V profite de cette lutte fratricide franco-française pour avancer ses pions et reprendre l'avantage par les armes : Ce sera la désastreuse défaite d'Azincourt en 1415.
C'est dans ce contexte funeste pour le parti français que naît Jehanne en 1412 ou à-peu-près, à Domrémy, place forte fidèle au dauphin Charles, dans un territoire dominé par le duc de Bourgogne. Lorsqu'elle entend ses premières voix, elle a 13 ans, soit vers 1425. Elles se feront plus insistantes en 1429 et c'est à cette époque qu'elle prend le chemin de Bourges puis Chinon pour rencontrer Charles qui n'est pas encore roi.
A Vierzon, les effets de la Guerre de Cent Ans se font toujours sentir. Après la prise de la ville par le Prince Noir en 1356 et sa reprise par du Guesclin au nom du roi de France en 1370, Vierzon connaît sa période communale. Chassés, les seigneurs de Vierzon laissent le pouvoir au seigneur apanagiste (le duc Jean de Berry vers 1400). Quant au quotidien des vierzonnais, il sera géré par un échevin et deux adjoints, élus par l’assemblée des bourgeois de Vierzon.
Les archives financières de l’époque montrent des dépenses sécuritaires tous azimuts après 1422.
En effet les troupes anglaises font toujours des incursions sur le sol de la seigneurie. Notamment Lury est pillée et les habitants mettront plus de trente ans à réintégrer leur cité, qui entre-temps va être occupée par les troupes fidèles au dauphin de France. Ces troupes françaises ne sont guère moins belliqueuses. Elles sont essentiellement basées à Mennetou, et Vierzon est obligée d'envoyer une députation au maréchal de Culan demandant que la troupe ne les « rançonne point ni ne les moleste » comme ils avaient coutume de le faire, en toute impunité.
Ces dépenses sécuritaires sont d'abord l'achat et carroyage de pierres pour rebâtir les murailles nord que le Prince Noir avait écroulées. Ensuite on établit une canonnière et une archère à la Porte du pont (rue Voltaire) ; et on en profite en refaire la barrière et une porte neuve munie d'une nouvelle clé. On refait à neuf la chaîne au pont-levis de la Porte au bœuf. Idem, on refait à neuf la barrière volante de la Porte de la rivière (rue Armand Brunet). C’est que le danger devenait menaçant. Ce n’était plus les troupes d’avant garde qui s’approchaient mais bien le gros de l’armée anglaise qui atteignait la Loire. Vierzon redevenue fidèle au dauphin se devait de préparer sa défense...
Les événements se précipitent à l’automne 1428 lorsque les Anglais mettent le siège devant Orléans. C’est le verrou ultime qui empêche les troupes anglaises et bourguignonnes de déferler au sud de la Loire. Si Orléans est prise, c’en est fini du royaume de France.
C’est dans ce contexte que Jeanne d’Arc quitte Vaucouleurs en janvier 1429 pour atteindre Chinon en février de la même année. La rumeur-légende la précédait qui annonçait qu’une jeune « puérile » de Lorraine allait sauver le royaume de France. Le chemin de Vaucouleurs à Chinon est passé par Mehun et Vierzon avant de se diriger vers l’ouest. La tradition veut que Jeanne et ses compagnons aient séjourné à Vierzon. Si ce n’est avéré, c’est du moins très plausible. Elle aurait séjourné une nuit dans l’auberge de la Madelaine, située juste à l’entrée de Vierzon, contiguë à la Porte de la rivière. Comble de malchance pour la postérité des lieux ayant accueilli la sainte, les érudits et historiens se sont trompés en positionnant cette auberge sur le plan de ville ! Ils ont confondu la maison des vicaires avec l’auberge, deux maisons plus loin… Autre rumeur tenace, Jehanne serait arrivée à Vierzon depuis Mehun sur Yèvre par un souterrain. Cette partie de son épopée est là par contre fort peu plausible même si cette idée est toujours tenace dans les esprits...
Arrivée à Chinons et après s’être fait présentée au dauphin, elle le conjure de lui donner une armée et d’aller délivrer Orléans (février 1429).
Les Orléanais ont faim, il faut couper le blocus de la ville. Ce que va faire Jeanne depuis Blois en longeant la Loire. Et Vierzon va être mise à contribution. Dès janvier 1429 le dauphin avait ordonné aux villes sous son obéissance de se rendre à Bourges pour pourvoir aux fournitures de blé destinées à Orléans. Le principe était la réquisition d’un boisseau par setier de grain, quelques soient les exploitants. L’abbaye de Vierzon s’est elle-même vue réquisitionnée de deux muids de farine (600 kg environ).
Vierzon, comme base arrière de l’approvisionnement d’Orléans, il faut l’organiser. Dans un large rayon autour de la ville toutes les récoltes étaient controlées et évaluées. Les détenteurs étaient sommés de fournir leur quote-part « rendus conduits à Vierzon. »
En ville il fallait organiser l’entreposage. Les échevins ont dressé une liste des maisons aux greniers suffisamment solides pour accueillir ces grains. Cette liste, toujours dans les archives, est de fait le premier plan-annuaire de la ville de Vierzon, avec les noms des propriétaires, rue par rue. On y retrouve la rue « des forges » (Gallerand), la rue « du pavez Hervelin » (de la monnaie), la « rue des eschanges », la rue « Notre Dame » (Galilée pour partie), la « grand rue » (Maréchal Joffre), « dans le chateau » (basse cour du château = Tunnel Château) et enfin « les maisons es environs du palais » (bas de la place du marché au blé). Au total se sont 488 réquisitionnés dont les noms apparaissent.
Les grains ne sont pas tout. Vierzon verra passer également, escorté par le capitaine Roullet, un convoi de viande sur pattes « destiné pour l’armée du roy qui est à Orléans dans le temps que les anglois l’assiegeoient ».
Repartie de Chinon, Jeanne va atteindre Blois par Selles sur Cher. Les vivres stockées à Vierzon arrivèrent à Blois via Romorantin. C’est semble-t-il dans cette place que le convoi a été rattrapé par Jeanne et les troupes royales. La suite de l’histoire est connue. Elle apporte le ravitaillement à Orléans le 29 avril. Une fois la ville ravitaillée et des troupes complémentaires arrivées, ce sont trois fortins anglais qui sont assaillis et pris, sur le sud de la Loire. Dès lors, les troupes anglaises ne sont plus en capacité de franchir la Loire et d’envahir le sud du pays. Le 7 mai, le reste des armées anglaises met fin au siège d’Orléans.
Pour faire sacrer Charles à Reims, il faut que les troupes françaises combattent loin en territoire ennemi. Galvanisée par Jeanne, la troupe remporte victoire sur victoire au mois de juin 1429. La marche sur Reims peut avoir lieu et Charles est finalement couronné Charles VII le 17 juillet 1429.
Après avoir été base arrière d’approvisionnement, Vierzon n’en a pas pour autant fini avec Jeanne. Les troupes anglaises défaites, il en reste des lambaux disséminées sur les terres de Sologne, de Berry et de la Loire. Plutôt qu’assiéger ces troupes, on préférait payer une rançon pour qu’elles partent. C’est ainsi que, réunis à Bourges, les états de la Province (dont Colas Roussel, bourgeois de Vierzon et lieutenant du capitaine au nom de la ville de Vierzon) avaient provisionné une somme de 15000 écus d’or pour le rachat de villes comme Mennetou, Cosne… Ce fut encore Colas Roussel qui transporta à Bourges la quote part de la ville, à savoir 200 écus d’or.
Revenue dans le Berry, Jeanne s’occupa à la reconquête de la ville de la Charité sur Loire en novembre 1429. Là encore Colas Roussel sera de la partie. Jeanne, accompagnée d’Albret connétable de France, passe par Bourges chercher des renforts pour ses armées. Roussel, comme commandant les hommes envoyés par la ville de Vierzon, les y rejoindra et prendra part au siège de la Charité. C’est un échec et Jeanne regagne Jargeau tandis que Colas Roussel regagne Vierzon. De ce passage, il reste dans les archives le mandement de payement et l’on apprend que pour sa chevauchée, Roussel fut gagé par la ville à hauteur de 20 sols par jour (équivaleent à un smic hebdomadaire aujourd’hui).
Dans les archives, c’en est fini des relations entre Jeanne et Vierzon. Mais suite à l’échec du siège, la province dut à nouveau payer le départ des anglais de la Charité. L’histoire ne mentionne pas les sommes demandées ni si Colas Roussel a encore joué un rôle.
Quant à Jeanne, après un hiver 1429 1430 passé à Jargeau et Sully sur Loire, elle prend la route de Compiègne en mai 1430. Tombée de cheval dans une bataille, elle est faite prisonnière par les Bourguignons. Elle est alors vendue aux Anglais qui la rappatrient à Rouen, leur quartier général. Elle est alors mise en les mains de l’évêque de Beauvais Cauchon et le procès va commencer…
Le quartier Vaugirard à Paris, est activement reconnu en cette fin de 19e siècle, pour son importante production de céramiques et porcelaines. En l’espace de trois rues, on y retrouve les Haviland, Bracquemond et Chapelet entre autres, mais aussi l'influent Théodore Deck.
On y retrouve également Ernest, frère cadet de Eugène Baudin, dont la présence est avérée quartier Vaugirard, au 24 rue de la Quintinie, en 1883, et propriétaire renommé d’un atelier en 1886.
Eugène, né à Vierzon en 1853, est également céramiste de métier. Les deux frères sont tombés dedans étant petits : leur père était lui-même ouvrier porcelainier chez Armand Bazille avant de rejoindre « la grande boîte » qu’était la manufacture Hache. C’est également chez Hache que Eugène et Ernest feront leur premières armes. Ensuite, Ernest poursuivra le métier jusqu’à Paris, et deviendra même directeur de production à la manufacture de Sèvres de 1892 à 1930.
Eugène, lui, aura un parcours plus atypique : il verse dans la politique. Connaissait-il Armand Bazille, relais vierzonnais des idées dites « avancées » de son beau-frère Félix Pyat ? Certainement. En tout cas, le dictionnaire des parlementaires français le dit partisan de Blanqui.
A seize ans, Eugène Baudin mène son premier combat politique : aux législatives de 1869, il combat le candidat officiel du régime. Cela lui vaut une première condamnation à la prison par le tribunal de Bourges pour avoir « porté outrage » à Napoléon III.
Sorti de prison, aucun patron porcelainier ne veut plus l’embaucher. Il part alors à Paris où l’Histoire le rattrape : il participe en temps que membre de l’Internationale à la journée du 4 septembre : celle de la chute de l’Empereur. Puis il prend les armes pour défendre Paris contre les Prussiens. Il ne les lâchera jamais : Après l’armistice de février 1871, il participe activement à la Commune de Paris, à tout juste 18 ans. A l’issue de la semaine sanglante Eugène fuit la France. Il rejoint Édouard Vaillant en exil en Angleterre. Il reprend dans ce pays son activité de céramiste, connaissant un véritable succès. Il ne reviendra qu’en 1881. À cette époque, son frère Ernest est déjà parisien.
Eugène rentre à Vierzon. Aucun ouvrage ne mentionne son activité entre 1881 et 1884, année où il devient conseiller municipal, dans des élections pour la première fois ouvertes au suffrage universel. L’année suivante, 1885, il devient le premier homme politique socialiste à conquérir un siège au Conseil général du Cher. Fort de ce succès, il se présente aux législatives la même année mais échoue de peu.
C’est alors qu’éclate la grande grève à la Société Française. Prenant part aux manifestations, il est arrêté par les forces de l’ordre et condamné à nouveau à la prison – deux mois – par le tribunal de Bourges, ainsi qu’à la privation de ses droits civiques pour cinq ans. Il ne sera libéré qu’au bout de trois mois. Il rentre alors à Vierzon et reprend le chemin du Conseil général du Cher. Mais, privé de ses droits civiques, il ne peut plus y siéger et c’est encadré par la police qu’il en ressort.
Il est amnistié en 1889, année des nouvelles législatives où il se trouve propulsé député du Cher. Il sera réélu en 1893. Il siège dans les rangs socialistes, au côté de Vaillant et de Millerand.
Durant ses deux mandats, Eugène Baudin se rapprochera du milieu syndical. Pour les bûcherons il créera leur syndicat et déposera une proposition de loi pour l’amélioration des conditions de travail dans les fabriques d’allumettes. Il se rapprochera également des mineurs pour que les conditions au fond des puits soient améliorés, notamment la détection du grisou.
Et surtout Eugène ne cessera de fustiger les forces de l’ordre qui utilisent des agents provocateurs dans les manifestatrions pour les faire dégénérer, et contre les violences policières dans ces mêmes manifestations.
Fatigué, peut-être déjà malade, Baudin ne se représente pas à la députation en 1898. Il laisse sa place à un jeune candidat vierzonnais également, qui sera élu : Jules Louis Breton.
Passé sa carrière politique, Eugène Baudin va reprendre son activté de céramiste, activité qu’il n’a pas cessé d’exercer, même durant ses mandats de parlementaire. Elu en 1889, son adresse parisienne n’est autre que l’atelier de son frère, rue de la Quintinie, adresse qu’il ne quittera définitivement qu’en 1898, après sa carrière de député.
En 1898, Eugène s’installe dans la commune bretonne de Saint Briac sur Mer. Ses productions céramiques sont alors identiques à celles qui sortaient des ateliers de la rue Quintinie. Dès lors, il est très difficile de répertorier les œuvres qui peuvent lui être attribuées lorsque’il était parlementaire / céramiste dans l’atelier de son frère. Il est difficile de différencier la signature E Baudin Ernest à celle de E Baudin Eugène. A Saint Briac Eugène poursuit sa production de style art nouveau dont il enverra certaines pièces à l’exposition universelle de 1900, aidé en cela par son frère à Sèvres.
Enfin dernière partie de la carrière de céramiste d’Eugène, son déménagement à Monaco. Il s’installe à Cap d’ail et reprend les « Poteries artistiques de Monaco », atelier qui avait été fondé en 1873. Il bénéficie des privilèges du prince Albert 1er de Monaco.
Malade, Eugène Baudin décède en 1918. Son fils Paul reprend alors la poterie de Monaco jusqu’en 1925, lui qui avait déjà repris l’atelier de Saint Briac en 1906…
C’est par ces mots, plus sanglotés que prononcés, qu’Hubert Clément prend ses pairs à témoins. Et d’écraser une larme devant les caméras de TF1 et devant la France du patronat (émue), réunie pour l’occasion à Villepinte. Car Hubert Clément n’est pas n’importe qui, lui, le vice-président du CNPF, numéro deux des patrons après Yvon Gattaz. Et quand il parle, le patronat l’écoute. « Jamais je n’aurais imaginé perdre mon entreprise dans de telles conditions. Chers collègues, je voudrais que mon expérience malheureuse soit utile à d’autres. »
Et pourtant il n’aura fallu que neuf mois d’un conflit emblématique pour que la LBM change de mains… et de nom.
Longeron, Baud et Montifret
En 1946, la LBM, ce sont trois associés qui ont donné leurs initiales à leur entreprise. On sort de la guerre. Il faut reconstruire. Et Montifret, ancien des Arts et Métiers, ouvre un atelier de machines-outils avec deux copains, à Choisy-le-Roi. Avec lui : six ouvriers et trois ingénieurs. C’est le succès. LBM doit s’agrandir et s’installe en 1950 à Alfortville, dans une ancienne mûrisserie de bananes. Les premières presses mécaniques, dont les brevets sortent des ateliers mêmes, sont vendues. Leur petite taille permet de conquérir un marché français en quête de ce type de machine maniable et facilement déplaçable.
En 1958, Montifret fait le grand saut. Il achète une entreprise désaffectée de porcelaine au Bas-de-Grange. Le passé ouvrier de Vierzon et la proximité de l’école professionnelle voisine sont pour beaucoup dans ce choix. Désormais, c’est à Vierzon que les presses sont fabriquées de A à Z. Les années 1960 et 1970 constituent la période faste de l’entreprise. Le plastique n’en est qu’à ses balbutiements et l’électroménager a encore besoin de presses pour plier le métal. C’est l’époque où apparaît Hubert Clément le gendre de « beau papa Montifret ».
De 700 mètres carrés, le site de Vierzon passe à 3000 mètres au tournant des années 1970. De six ouvriers à Choisy, on est passé à 130 en 1974, à Vierzon. 70% des presses fabriquées en France le sont à… Vierzon. L’image LBM est bonne, Clément clame même en 1971 « qu’il n’y a pas eu une seule journée de grève au sein de l’entreprise ».
1974, la crise économique
Le choc pétrolier se fait sentir partout en France. Les clients naturels de LBM (électroménager, automobile, armement) ne renouvellent pas leur parc de presses. En trois ans, la vie de l'usine va vite évoluer. D’abord un nouveau directeur est délégué, accusé de « vouloir casser du syndicat ». Clément ne le démentira jamais. « C’est le directeur qui s’occupait de cela, moi je n’y suis pour rien. » Les tensions s’accumulent, le travail diminue. Mauvais résultats après mauvais résultats, la situation financière de l’entreprise est catastrophique au tournant de l’année 1981.
Les ouvriers travaillent au ralenti, vingt heures par semaine payées trente-deux. Novembre 1981, Clément demande le licenciement de trente personnes. Refus du comité d’entreprise. C’est le début d’un bras de fer qui va durer neuf mois.
De LBM à… LBM
En février 1982, LBM dépose le bilan. Le syndic veut soixante-huit licenciements. Le comité d’entreprise refuse et décide d’occuper l’usine. Des pourparlers semblent encore possibles. Pas pour longtemps. La fermeture est annoncée en mars.
Tout aurait pu s’arrêter là si une cinquantaine d’ouvriers n’avaient pas pensé reprendre l’usine à leur compte en créant une SCOP, société coopérative ouvrière de production, avec à sa tête Pierre Millet, syndicaliste, ancien fraiseur de l’entreprise. LBM devient La Berrichonne de Mécanique, les clients ne seront pas dépaysés par un quelconque changement de logo.
L’Etat « Mitterrandien » promet une subvention de 800 000 francs. En septembre, les statuts de la SCOP sont déposés. C’est dans ce contexte que Clément parle de spoliation devant ses confrères. Les cinquante-deux repreneurs, qui ont tous versé 25 000 francs pour former le nouveau capital, savent bien qu’ils l’ont achetée, leur usine.
Mais l’heure n’est plus aux palabres. Il faut faire tourner l’usine et renouer avec les clients, les rassurer. L’usine reprend sa production, au grand dam de Clément qui avait prédit que l’entreprise ne survivrait pas à son départ.
Nouvelle SCOP
Les années 1990 sont celles de la recomposition industrielle française, avec l’arrivée de nouvelles technologies. L’ordinateur est roi et le bureau d’études de LBM travaille encore à la règle et au crayon. Après la reprise des années 1980 et 1990, les nuages s’amoncellent à nouveau au dessus de l’entreprise du Bas-de-Grange.
« On sentait la déliquescence poindre à l’horizon. Une drôle d’ambiance. Le problème pour LBM, était de trouver de la trésorerie pour pouvoir subvenir jusqu’au lendemain. Et puis à force… Un jour on a vu arriver les liquidateurs. Laurent Coutel, futur directeur, parlait déjà à mi-mots de recréer une nouvelle SCOP. »
Malgré tout, la liquidation est prononcée en mai 2000. Trois projets de reprise sont entendus par le tribunal de commerce. Finalement, c’est celui de Laurent Coutel qui sera retenu pour maintenir l’activité des presses hydrauliques à Vierzon et, surtout, conserver vingt et un emplois.
« Une fois que Laurent Coutel a créé cette nouvelle liste d’une vingtaine de noms, les choses ne se sont pas bien passées pour autant. Les scopeurs ont été obligés de se battre pour que les ASSEDIC acceptent que leurs indemnités de licenciement deviennent le capital de cette SCOP deuxième génération.
En attendant, les scopeurs n'ont plus le droit de rentrer dans l’usine, c’est l’ADP (Agence de Développement et de Promotion du pays de Vierzon) qui faisait office de bureau. Jean-Pierre Lecoq, entre autres, président du comité d’administration, maintenait le contact avec les clients, les assurant d'une rapide reprise. »
Cette reprise eut lieu en août. Vingt et un sociétaires ont investi dans « leur » usine. Et ça marche. Aujourd’hui ce sont plus de 1200 presses LBM qui sont installées sur les chaînes de montage des cinq continents.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, en ce mois de juillet 1914, Vierzon compte 24000 habitants, disséminés sur les quatre communes de Vierzon Ville, Villages, Bourgneuf et Forges. Les Vierzonnais sont plus intéressés par les moissons que par l'assassinat de l'archiduc d'Autriche- Hongrie. Tout cela semble loin. Et pourtant si proche...
Lors de la mobilisation générale, ce sont les maris, pères, frères... qui rejoignent le 95e Régiment d'Infanterie de Bourges toucher leur paquetage, avant de partir sur le front pour une durée que chacun espère courte.
L'activité économique locale est totalement désorganisée. L'industrie locale, le bâtiment, l'artisanat, les services publics tout est à plat. La métallurgie, la porcelaine, voient leurs effectifs divisés par 15 ou 20 du jour au lendemain. La seule solution pour les patrons : faire le dos rond, mettre les ateliers au chômage en attendant des jours meilleurs. Ceux qui le peuvent continueront de faire tourner leur usine au gré des commandes restant à livrer, rappelant les « vieux travailleurs » de 70 ans et plus. Mais les marchés sont également désorganisés. La clientèle, nationale, coloniale ou internationale n'existe plus.
Durant, quatre années ce seront les maires qui seront à la manœuvre, gestionnaires de la pénurie et des approvisionnements chaotiques.
Mais dans l'immédiat, il s'agit de nourrir une population précaire qui n'avait que le salaire de l'absent pour vivre. Le maire de Forges résume bien la situation (conseil municipal du 4 août 1914) : « la mobilisation des chefs de famille a entraîné la fermeture de presque toutes les usines de la région et la misère s'est installée dans beaucoup de maisons. Il importe de soulager les familles malheureuses au plus vite ».
Un commission est crée à Forges, imitée par les trois autres communes, qui distribue du pain aux indigents : 750 gramme / jour / adulte, 500 grammes pour les enfants de 3 à 13 ans, 250 grammes pour les enfants en dessous de 3 ans. De son côté, la distribution de pain aux indigents aura coûté la somme de 12000 francs entre les mois d'août et octobre 1914, somme prélevée sur le budget du bureau de bienfaisance (CCAS aujourd'hui).
Le maire de Ville justement, Émile Péraudin aura été particulièrement actif durant ces quatre années de guerre. Il a une idée simple qu'il va s'acharner à faire appliquer : Si l'État est à l'origine de la désorganisation de la vie municipale, c'est l'État qui devra pallier à cette situation en positionnant Vierzon à la pointe de l'économie de guerre. Pour ce faire, Péraudin fait appel à son ami ministre de la guerre Alexandre Millerand (socialistes et maçons tous les deux). Ce dernier va soutenir Vierzon dans trois directions : le cantonnement de troupes, la création d'une entrepôt d'effets d'habillement et enfin la commande massive d'armement.
Pour faciliter l'effort de guerre dans les usines métallurgiques, les ouvriers spécialisés seront mobilisés... au sein de leur usine. D'autres ingénieurs, contremaîtres, ouvriers très spécialisés seront mobilisés dans ces mêmes usines vierzonnaises de matériels agricoles, chargés de transformer les productions traditionnelles en munitions. La Française fabriquera dorénavant des cartouches, Merlin et Brouhot des obus. La pointerie continuera sa production de clous et barbelés dont les armées sont très consommatrices.
A Vierzon, il n'y a pas de « munitionnettes ». Ce qui est valable ailleurs ne l'est pas dans notre ville. La main d’œuvre féminine sera employée dans la confection. Cela donnera un revenu aux femmes et filles de soldats. L'armée, toujours grâce à Millerand, fait de Vierzon un des dix entrepôt français d'habillement. Elle passe commandes d'effets militaires qui seront confectionnés par les petites mains vierzonnaises, en atelier ou à domicile. Celles-ci seront rémunérées après contrôle de conformité.
Enfin, point essentiel sur lequel Péraudin a fort insisté auprès de Millerand : le cantonnement à Vierzon de nombreuses troupes. Là encore le ministre accède à la demande du maire : deux régiments stationneront à Vierzon, le 5e régiment du génie et le 62e territorial, surnommés les « pépères » (car plus âgés). Le but de Péraudin était simple : le cantonnement des troupes à Vierzon allait permettre au commerçants d'éviter la faillite, chaque soldat pouvant dépenser sa solde dans les commerces locaux.
En mars 1915, il rapporte au conseil municipal que « le séjour à Vierzon pendant cinq mois du 5e Régiment du Génie a amené l'aisance, le commerce a fait des affaires et les malheureux n'ont pas été oubliés. D'après des calculs basés sur les effectifs des troupes qui ont cantonné à Vierzon, c'est une somme de sept millions dont a bénéficié la région vierzonnaise... ».
Dès septembre 1914 ce sont plus de 7000 hommes du génie et près de 3000 territoriaux qu'il a fallu loger. Nombreux sont ceux à avoir logé dans les usines, 1000 à Merlin, 400 à la Française, 200 chez Larchevêque, 300 à la verrerie... Certains du 5e génie étaient ouvriers dans le civil, ingénieurs... Ils deviendront soldats ouvriers dans les usines de munitions, le temps de leur passage à Vierzon. Ces troupes devaient repartir sur Versailles en novembre avant le départ sur le front. Péraudin obtient leur maintien à Vierzon jusqu'en mars 1915. Le 5e génie part alors directement sur le front, sans passage par la case Versailles. Quant au 62e territorial, spécialisé dans l'intendance et sur les lignes arrières, ils repartiront de Vierzon courant septembre 1915. Les pétitions des commerçants pour leur maintien à Vierzon n'aura pas d'effet.
C'est ainsi que Vierzon est entrée dans la logique d'une économie de guerre. La situation s'est rapidement détériorée. Le chômage ne s'est pas résorbé dans la porcelaine dont les productions n'étaient « pas nécessaires » à l'effort de guerre national. Des pénuries sont apparues dans le charbon, l'inflation a fait une apparition remarquée et durable. Le blé est de mauvaise qualité et la farine fort chère... Le rationnement a vu le jour en 1916, au grand dam des maires qui ne voulaient pas mettre en place les tickets de rationnement. Une chance pour Vierzon : sa position géographique et la gare ont fait que l'entrepôt d'effets d'habillements est devenu le plus important de France, permettant, avec des hauts et des bas selon les budgets militaires, de faire vivre une nombreuse main d’œuvre féminine estimée à 6000 femmes dans l'agglomération...
Une archive précédente du vendredi 14 janvier 2022 revenait sur l'histoire des armoiries de la ville de Vierzon. Le texte expliquait comment deux blasons s'étaient succédés dans l'histoire de notre cité.
Tout d'abord, au tournant du XIe siècle, c'est l'écu de la famille de Vierzon qui s'est imposé : un écu vert et rouge divisé en quatre : le vert comme symbole de fidélité (à son suzerain) et le rouge comme symbole de vaillance.
Cet écu seigneurial sera fièrement porté jusqu'à la Guerre de Cent Ans. Le dernier seigneur de Vierzon, également duc de Brabant, a le mauvais goût de choisir le mauvais camp : celui de la perfide Albion. Mal lui en prend, le roi de France lui confisque sa seigneurie. C'en est fini du vieil écu à damier. La seigneurie deviendra simple apanage.
Les vierzonnais vont alors connaître leur « époque communale ». Ce seront trois échevins, élus par les bourgeois de la ville qui œuvreront au bien commun. Et ils vont se choisir un nouveau blason : ce sera une tour et elle sera penchée. Ce nouvel emblème de la cité apparaît au tournant du XVe siècle. Notre vieil historien Béchereau écrit en 1750 qu'il est visible au puits des bans (angle rue Porte au bœuf : rue Joffre). C'est là l'endroit où se réunissait les bourgeois pour procéder à l'élection de leurs représentants.
Ces armoiries ont été confirmées et figées dans l'armorial d'Hozier, ordonné par Louis XIV en 1664.
L'emblème de la ville est alors un écu « à tour chancelante à dextre, maçonnée et crénelée de trois pièces d'argent, à la porte ouverte de sable ». Une tour penchée sur fond bleu.
Pourtant, au tournant du XXe siècle, on a tendance à vouloir redresser la tour. Dans l'archive du 22 janvier 2023, il était écrit texto :
« Le XIXe siècle est celui pour Vierzon de son industrialisation. La ville vit son époque triomphante et on en profite pour redresser la tour.
Il est probable que les redresseurs de tour aient oublié sa signification originelle et voient en elle le beffroi, seule tour médiévale visible par tous. En quoi aurait-il été penché ? Bonne question à laquelle aucune réponse historique n'avait pu être donnée. Une tour dressée était sans doute plus conforme à l'idée que l'on pouvait se faire d'une ville qui connaissait alors une forte croissance démographique. »
En fait, il n'en est rien. On a trop voulu faire confiance à un érudit local qui « savait ». Et cet érudit n'est autre que Toulgoët Tréanna, écrivain de la première sérieuse histoire de Vierzon.
De temps en temps le hasard et internet font bien les choses, qui permettent de trouver des documents inédits. En l’occurrence un collègue (merci à lui !) a trouvé trace dans « Candide, grand hebdomadaire parisien et littéraire » l'explication du redressement de la tour. L'article paru dans le numéro du 16 avril 1925 est reproduit ci dessous in extenso :
« La tour penchée de Vierzon
Une tour penchée, semblable à celle de Pise, figurait dans les armes de Vierzon. L'an dernier, Monsieur Péraudin, maire socialiste de cette ville, redressa la tour, selon les inspirations du comte de Toulgoët-Tréanna, auteur de l' « Histoire de Vierzon et de l'Abbaye de Saint-Pierre » et de « Noblesse, Blason et Ordres de Chevalerie ».
Cet érudit avait fait construire à Vierzon l'immeuble du Crédit Lyonnais. Au-dessus de la porte d'entrée, il avait gravé les armes de Lyon et celles de Vierzon. Pour ces dernières il n'avait pas admis la tour penchée ; le premier, il fit la tour droite, ainsi qu'elle figure sur les canons et le timbre de l'horloge datant du XVIe siècle.
Mais la municipalité avait gardé dans son blason la tour penchée. Monsieur Péraudin, qui a la réputation d'un Mussolini berrichon, déclare enfin : « Elle sera droite ! »
Le Comte de Toulgoët-Tréanna est mort il y a quelques jours, en son château de Rozay, à l'âge de quatre-vingt-douze ans. C'était un solide vieillard. Ses familiers lui disaient parfois : « Vous êtes droit comme un chêne ! »
« Comme ma tour ! » répondait-il fièrement.
Deux remarques à cet article. Toulgoët ne tient pas compte de l'armorial d'Hozier, préférant se rapporter à deux gravures : une cloche et un canon. Mais ce sont là les deux seules exemples où la tour est droite, certainement le fruit d'une erreur de la part de leur graveur respectif.
Et Péraudin, dont l'autoritarisme se confirme avec le surnom que le journal lui attribue, fait manu militari confiance à Toulgoët pour redresser la tour municipale. C'est ainsi qu'une tour droite apparaît dans les lettres et enveloppes de la mairie de Vierzon Ville. Reste aujourd'hui à connaître le lien entre Toulgoët et le Crédit lyonnais...
La conclusion de archive de janvier 2023 reste d'actualité. Seul un conseil municipal à le pouvoir de changer les armoiries d'une ville. Aucune réunion depuis celle des échevins durant le Guerre de Cent Ans n'a modifié ces armoiries. La tour vierzonnaise est donc bel et bien une tour penchée depuis maintenant plus de six cents ans...
L’archive du vendredi profite de la proximité de Halloween pour relater, en guise de récréation, une histoire qui se racontait dans un triangle Vierzon – Bourges – Saint Florent au XVIIIe siècle.
Le premier à s’y référer est Jaubert, sans toutefois en dévoiler la teneur. Celui qui en parle le plus reste le comte de Barral, ancien préfet du Cher sous Napoléon Ier qui relate des anecdotes sur le département dont il eut à s’occuper. Ses histoires ont été compilées, enrichies et publiées par son petit-fils.
Comme toute histoire qui se transmet à la veillée, celle-ci a une morale. Chrétienne bien-sûr. Ce n’est pas pour rien si c’est un ancien curé de Levroux qui la raconte à Barral. Ce curé est né à Paris vers 1756 et était même fier d’avoir rencontré Mirabeau pendant la Révolution. C’est une histoire qui se passe dans un village « peu importe lequel ». Barral se souvient de la trame de l’histoire même s’il en a oublié le texte originel. Seuls quelques vers lui sont encore en mémoire.
Découvrons donc cette histoire à pâlir la nuit :
Le souper de la Mort.
Dans un village, il y avait un garnement, adolescent indiscipliné et turbulent, qui vivait avec sa mère qui n’en pouvait plus de lui. Elle l’avait trop gâté et s’en repentait, mais c’était trop tard. Aucune remontrance ne pouvait faire changer le fils toujours à l’affût d’un mauvais coup à faire avec ses copains de son âge, « aussi fous que lui ». Une année, le jeune garçon et ses amis firent un jeudi gras particulièrement bruyant. Après une journée entière de libation et de beuvrie, voilà notre groupe d’amis à divaguer dans le village, et de s’arrêter devant la porte du cimetière.
Notre jeune homme ne trouva rien de mieux que de profaner une tombe, de s’emparer de la tête d’un squelette et de jouer avec. Il s’en affubla, revêtu d’un drap blanc et parcourut tout le village, faisant peur aux enfants et scandalisant les passants. « Tout le monde était indigné de cette funèbre exhibition et l’on disait que le ciel ne laisserait pas impunie pareille profanation ».
Une fois dégrisé, le jeune garçon repassa par le cimetière et jeta la tête par dessus le mur en lui criant : Va, et je t’attends à diner ce soir !
Rentré chez lui, il trouva sa mère en larmes d’avoir appris le comportement de son rejeton. Aucune remontrance n’y fit. Aucune forme de regret chez le jeune garçon.
On se mit à table, le fils face à la mère et la domestique d’apporter la soupière. C’est à ce moment qu’on frappe à la porte. On est surpris dans la maison : on n’attend personne. Un coup frappé plus fort fait se relever le jeune homme qui va ouvrir la porte. Il a un mouvement de recul, frappé d’épouvante : sur le seuil se tient debout un squelette drapé dans son suaire, celui-là même dont il avait promené la tête quelques heures plus tôt.
La mère et la domestique sont tombées évanouies. Le squelette décharné, le regard vide et pourtant enflammé referme violemment la porte derrière lui.
« Cette carcasse effroyable
Faisant craquer tous ses os
Prit la parole aussitôt
Et lui dit : marchons à table.
Je viens avec toi souper
Comme tu m’as invité... »
Et de s’asseoir à la place de la mère. D’un geste impérieux de son doigt de squelette, il intime l’ordre au jeune homme de reprendre sa place à table. Les jambes du jeune garçon ne le portent plus. Lorsqu’il arrive à faire un pas c’est pour fuir l’apparition et se réfugier dans son lit, loin sous les couvertures. Mais l’invité le suit et s’assied à ses côtés.
Le jeune garçon devient fou, croyant sa dernière heure arrivée. Alors il se repent, demande pardon à Dieu de ses offenses et lui demande d’avoir pitié de lui.
Nuit interminable pour le jeune homme veillé par la Mort.
Et au petit matin la Mort de repartir, faisant craquer sa carcasse. Au moment d’ouvrir la porte, il se retourna vers le jeune homme et lui lança son invitation : « Et dans huit jours, je t’attends à souper pareillement... »
Mais le jeune homme n’habitait plus sa tête. Il garda le lit, il délirait jour et nuit. Dans ses courtes phases d’apaisement il demandait pardon à Dieu de ses mauvaises actions et du scandale qu’il avait occasionné. La mère et la domestique ne savaient plus que faire pour le soulager.
Bientôt on alla quérir le médecin. Malgré ses soins, l’état du malade allait s’aggravant. On alla quérir le prêtre qui prépara le jeune homme à la Mort.
Il est mort le jour des Cendres,
Justement dans le huitième jour
Que le Mort, en son discours
Lui avait bien fait comprendre…
Voilà donc résumée la complainte que l’on racontait aux environs de 1750 dans notre Haut Berry. La morale – chrétienne – est sauve et l’allégorie peut servir d’avertissement. Il ne faut pas se moquer de la Mort.
Barral termine son récit en espérant que quelques uns de ses lecteurs les plus jeunes partent à la recherche de l’entièreté de la complainte, soit en prose soit en vers. Peut-être en profiteront-ils alors pour exhumer d’autres contes et légendes oubliées.
Il existe (au moins) une variante à cette histoire, retrouvée en pays de Gascogne. Le début reste identique : la profanation d’un mort dans un cimetière. « Si tu ne m’en tiens pas rancune, viens diner avec moi ce soir ». Stupeur lorsque le squelette répond à l’invitation. Là, les deux convives font bombance et au moment de partir le squelette retourne l’invitation, il attendra son hôte le lendemain soir. Mais là, le garçon ne perd pas ses esprits et demande conseil à son curé. Ce dernier lui dit de se rendre à l’invitation mais de ne surtout rien manger ni boire de ce qui sera présenté. Et le garçon d’aller chez la Mort. Il lui est servi des vins et plats succulents mais le jeune homme fait semblant. A la fin du repas, la Mort lui dit qu’il a bien fait de ne rien avaler, chaque bouchée était un pas vers Elle. Elle le laisse repartir en lui demandant de faire dire cent messes et de ne plus profaner les cimetières…
Lorsque la communauté des habitants de Vierzon achète pour la première fois son horloge, elle achète bien « un aulouge ». Le genre – féminin – et l’orthographe du mot horloge ne seront fixés qu’au 18e siècle. On retrouve dans les archives communales, des 15e au 18e siècles différentes orthographes tel « aulouge », « relouge », « reloge », « auloige », « auloge », « oreloge » ou « osloge ».
Tout au long du premier Moyen-Âge, le temps est un temps religieux, scandé par les cloches des églises qui appellent à la prière, Mâtines, Prime, Vêpres, etc.
Mais à partir du moment où se met en place un système communal (vers 1400 pour Vierzon), les villes ont également besoin d’avoir des cloches pour caler la vie sociale des habitants et leur vie municipale. Les cloches vont servir au rassemblement des habitants, à prévenir de l’ouverture ou la fermeture des portes de ville, annoncer les jugements, ou encore annoncer le début du marché. La cloche devient laïque et symbole du pouvoir communal.
De la cloche à l’horloge, il n’y a qu’un pas, franchi courant 13e siècle grâce aux avancées techniques. Tout d’abord pour réveiller le sonneur...
Les vierzonnais prennent ainsi l’habitude d’entendre marquer les heures et savent s’y référer : telle corporation doit commencer le travail à telle heure, le marché aux menues denrées se termine à telle autre heure, etc.
Travailler sur le premier « aulouge » de Vierzon, c’est travailler sur des archives du 15e siècle. Malheureusement, ces archives sont très lacunaires, ce qui rend l’existant parfois contradictoire. De plus, difficulté supplémentaire, le mot « horloge » se rapporte aussi bien à la pendule même, qu’au bâtiment dans lequel elle est entreposée…
En attendant, la première trace « d’un aulouge » à Vierzon remonte à l’année 1436. Et ce sont les archives financières de la ville qui nous en parlent. Un mandat de paiement a été délivré le 31 janvier à « Jean de Molins, prêtre, héritier de feu Jacquemain, horloger à Bourges », pour la somme de 10 livres « restant dues pour l’achat des mouvemans du aulouge ».
Et deux mois plus tard, le 29 février 1436, une quittance de 60 sous est remise par Jean Huault, échevin de Vierzon qui a fait, « par eau », le voyage de Bourges entrepris pour « recouvrer les mouvemens du relouge ».
Déjà cette première date est en contradiction avec la tradition qui veut que Vierzon ait eu son horloge dès 1428. C’est du moins ce qu’en disait notre vieil historien Béchereau en 1750. Et s’il avait raison ?
Le mandat parle bien d’une somme « restant due ». Le prix moyen d’un aulouge est de 100 livres (20 000 euros d’aujourd’hui), somme extraordinaire au vue du budget municipal (180 livres). On peut imaginer que l’achat date de 1428, payable en plusieurs fois, l’acquisition étant effective après paiement du global. On voit même qu’entre l’achat et la livraison l’horloger Jacquemain est mort ; la dernière échéance est payée à son héritier.
Béchereau donne un détail supplémentaire qui n’apparaît pas dans les archives : « Il en coûta pour faire fondre la cloche 3 livres 17 sous. »
Autre remarque liminaire : Vierzon fait partie des premières cités à posséder son horloge. Sans doute faut-il y voir la proximité de Bourges, ville de Charles VII. Si Rouen possède son « gros horloge » depuis 1389, l’horloge astronomique de la cathédrale de Bourges ne date que de 1424, créée à l’occasion du grand baptême du dauphin, futur Louis XI. Autre indice: dans l’archive de 1436 Jacquemain est dit horloger. C’est pourtant une profession qui ne sera reconnue que par Louis XI ; quant à la corporation des « orelogiers », c’est François Ier qui l’autorise.
Une fois les « mouvemans du relouge » débarqués à Vierzon, où l’installer ?
Là encore, c’est un mandat de paiement du 2 octobre 1436 qui nous renseigne : 60 livres sur un marché total de 90 livres (!) sont payés à Jehan Delabrousse dit Montargis, charpentier. Il doit exécuter « la charpente de la tour de la porte du bœuf (angle rue porte au bœuf / place du tunnel) et au dessus « faire le bastiment pour mectre les movemens du reloge de la ville ». Et on apprendra en 1443 qu’on accédait au « bastiment du reloge » par une échelle interne.
On peut donc estimer que les vierzonnais ont entendu s’égrener les heures à compter de cet automne 1436.
Les archives suivantes mentionnent fréquemment des réparations à faire à l’horloge. Difficile de démêler entre les réparations à la pendule même ou au bâtiment supportant l’horloge. De plus ce terme de réparation ou plus fréquemment utilisé celui d’« habillement » désigne aussi la mise à l’heure de la pendule. On sait qu’une chambre va y être accolée et qu’elle sera assainie avec de la chaux. Concernant la pendule même, trois réparations sont avérées : en 1441, Etienne Boutet serrurier obtient la somme de 4 sous et 2 deniers pour une réparation (minime vue la somme). Et la ville de Vierzon va acheter en 1443 pour 7 sous de cordes destinées « aux contrepoids de l’horloge ». Enfin, en 1468 on « adoube le reloge » (adouber = forger) : en fait on remplace l'aiguille qui avait été volée.
Les autres archives de ce milieu du 15e siècle sont tout aussi intéressantes : il s’agit des salaires des préposés à l’entretien des horloges « gouverneur du aulouge de la ville ». 1443 : on mandate 10 livres à Colin Moriche, clerc, « pour sa paine et salaire d’avoir gouverné l’auloige ceste présente année. » C'est là une somme non négligeable qui grève en partie le budget de la ville.
Les gouverneurs suivants seront beaucoup moins bien payés. Tout au long du siècle suivant leur gages vont s’amenuisant, les recettes municipales ne sont pas extensibles. En 1445 toujours Colin Moriche, est appointé à 18 livres /an mais occupe des fonctions supplémentaires à celui de gouverneur du aulouge. 1450 : Perrinet Desainctes reçoit 9 livres. 1477 : Thomas Sallot ne reçoit plus que 100 sous (5 livres). 1481, Martin Desainctes reçoit 60 sous. 1503 : Jehan Segault ne reçoit plus que 25s (1 livre 5 sous) pour avoir « pendant deux ans habillé et entretenu l’horloge de la ville ».
Mais il a existé deux autres horloges.
Dès 1502, les archives mentionnent la présence d'une horloge dans l'église Notre Dame, sans autre renseignement sur son prix, sa provenance… Et en 1508 on nomme Gilles Perrinet comme « gouverneur » de cette horloge.
Quant à la troisième horloge, elle va remplacer celle de 1436. Etait elle de mauvaise qualité ? Ou plutôt peu précise ? En 1507, la ville achète 20 livres à Jean Jarnault serrurier, les mouvements d’une horloge, cloche non comprise. Le mois suivant un mandat de paiement est donné pour installation des « mouvemens nouvellement installés à la porte au boeuf ». Reste à savoir ce que l'on a fait de l'ancienne. Rien dans les archives ne peut laisser supposer qu'elle ait été installée sur une autre tour (aucun travaux, aucun « habillement » supplémentaire)... Au contraire, la fonction de gouverneur est bien précisée en 1534 et 1535 : Guillaume Connault et Guillaume Mothon se succèdent en temps que gouverneurs « des gros et petis osloges de la ville de Vierzon. C'est ainsi qu'on peut imaginer le gros osloge sur la porte au bœuf et le peti oslog dans l'église, petit et non visible des paroissiens.
Après cette date de 1535, les documents sont inexistants jusqu'en 1649 : On retrouve alors un gouverneur « de l'horloge », et non pas des horloges...
Dernière affaire concernant l’horloge de l’église : son supposé vol par les moines de l’abbaye Saint Pierre. 1712 : les habitants sont tenus de payer une dette vieille de 20 ans de 60 livres aux moines de l’abbaye. Les habitants persistent à refuser de rembourser « attendu que les religieux ont reçu un horloge avec son timbre que la ville avoit et entretenoit en l’église parochiale de cette ville, moyennant décharge du principal et des arrérages de la susdite rente ». Autrement dit les vierzonnais ont payé leur dette en donnant l’horloge aux moines. A la Révolution, 1790, on retrouve cette horloge dans l’église des moines. L’explication de sa présence à cet endroit est toute autre : Les moines (qui ne sont plus présents à Vierzon et ne peuvent donc se défendre) sont accusés de s’être purement et simplement approprié l’horloge de Notre Dame « au siècle dernier ou à peu près », sans que les habitants n’aient rien pu empêcher…
Au 19e siècle, les remparts n'ont plus lieu d'être, la cité déborde de ses murs, les pierres servent aux constructions nouvelles. Avant démolition de la porte au bœuf, on déplace l'horloge jusqu'au beffroi que l'on verra alors quelques fois dénommé tour de l'horloge.
Une note manuscrite anonyme (mais dont l'écriture ressemble fortement à celle du maire Dupré de Saint Maur, 1823-1826), signale que c'est son prédécesseur Balan de la grange (maire de 1816 à 1823) qui a fait transférer l'horloge au beffroi. Et en 1824 on crée une cage d'escalier destinée à monter à l'horloge.
En 1863, l'horloge, trop vétuste, est remplacée par une horloge moderne, à deux aiguilles, marquant également les minutes. Elle sera changée en 1985 par une horloge automatisée qui s'y trouve encore…
Parmi les prérogatives d’une municipalité, il ya l’urbanisme. Et c’est là un domaine où les réalisations peuvent encore se voir des décennies plus tard…
Si l’avenue de la République existe depuis 1740 entre la Croix Blanche et le carrefour Brunet / Voltaire, c’est parce que l’ancien chemin – rue Victor Hugo – était trop étroit et biscornu.
Aux 18e et 19e siècles, c’est la poussée démographique qui rend les maires urbanistes. La ville déborde de ses remparts et de nouveaux quartiers se créent, à commencer par celui de la gaucherie, puis les forges, quartier gare… De nouvelles rues prennent vie. Et là, pas question de faire dans le médiévisme. On construira large pour permettre aux « émanations » de se disperser ; les hygiénistes du siècle des Lumières sont passés par là.
Dans le vieux Vierzon on essaiera autant que faire se peut d’élargir les rues existantes pour y faire entrer l’air et la lumière. Le « plan d’embellissement de Vierzon » de 1844 s’efforcera de supprimer les encorbellements des maisons et on détruira celles qui sont frappées d’alignement. Ce qui ne va pas sans heurts avec les propriétaires riverains.
Pourtant, coup de pouce du destin, de temps en temps les municipalités seront aidées par ces mêmes propriétaires riverains qui favoriseront l’aération de la cité séculaire. Et cela se passe dans la rue Gallerand et la rue de l’Etape sa voisine.
Rue de l’étape. Son nom d’origine est un peu plus long : rue de l’étape au vin. Sous l’Ancien Régime, le commerce n’était pas disséminé dans les quartiers comme aujourd’hui ; chaque corporation était regroupée autour d’un même lieu, ce qui rendait le contrôle et la perception des impôts plus aisée. Ainsi le commerce de la viande de bœuf se faisait autour de l’actuelle place du marché au blés ; le commerce de luxe rue Joffre. Et le commerce du vin (en gros) se faisait rue de l’étape. Ce nom d’étape au vin est justement le nom de l’impôt qui frappait la dive boisson. Dans son livre « le vieux Vierzon, son histoire, ses rues, ses monuments », Alain Rives rappelle son fonctionnement : Les étrangers à la cité devaient s’acquitter d’un droit pour vendre leurs vins à Vierzon. Cette étape au vin consistait en une « redevance de deux sols par poinçon de vin vendu à l‘étape de la ville et des droits de jaugeage et de courtage s’élevant à six sols par poinçon de vin vendu tant à l’étape qu’ailleurs et perçus uniquement sur les étrangers à la ville ».
La rue a donc une passé mercantile avéré lorsque le maire du Péron, à la veille de la Révolution, décide d’y transférer le marché qui était alors rue Joffre : le marché aux menues denrées, volailles et légumes.
Entre temps, l’histoire se passe à l’emplacement de l’actuelle place de l’Etape. Sur son emplacement se dressait la maison du fondateur de la famille Brunet, famille bien connue à Vierzon (voir archive du vendredi 8 avril 2022). Bon mariage, marchand, la famille reste deux siècles dans cette maison. Elle est revendue en 1819 à un dénommé Richer qui ne l'habitera jamais.
Mais voilà, la rumeur arrive en 1869 que le marché de la rue de l'Etape va être transféré dans un espace beaucoup plus grand : la place du Tunnel.
Branle-bas de combat : les riverains de la rue de l'Etape vont racheter au sieur Richer l'ancienne maison Brunet et vont la démolir avec ses dépendances pour offrir à la ville la place ainsi créée, à condition de garder leur marché. La ville accepte et utilise l'espace pour créer le nouveaux marché aux fruits… marché qui a disparu au tournant de la première guerre mondiale.
C'est ainsi que l'aération de la vieille rue s'est réalisée, grâce aux riverains mobilisés. C'est le cas également dans la rue voisine Gallerand, à une époque plus récente.
En lieu et place de la fontaine de la place Gallerand, se dressait un pâté de maisons jusqu'en 1930, triangulaire. Il délimitait ainsi trois rues (voir plan en image jointe) : la rue Gallerand, côté gauche en montant, rue que l’on retrouve quelques fois nommée « rue de la forge Gallerand » ; côté sud on retrouve le prolongement de la rue de l’étape ; enfin côté est on trouvait la « rue aux cuirs », dénommée ainsi par la présence de nombreux cordonniers.
Au 1 de la rue de l’étape se trouve depuis 1853 la quincaillerie Pilou que les plus anciens d’entre nous connaissent encore. Pilou est également propriétaire d’une des trois maisons de l’îlot Gallerand : une maison en mauvais état et qui avait abrité la bourse du travail depuis une trentaine d’années.
Dans une lettre adressée au maire Péraudin en 1928, Pilou explique qu’une maison de l’îlot Gallerand est à vendre : une charcuterie au doux nom de « à la renommée ». Si la mairie rachetait la charcuterie, Pilou donnerait l’ancienne bourse du travail « à la condition que l’ensemble des bâtiments soit abattu et transformé en place publique ».
C’est ainsi que les travaux eurent lieu en 1929. Alain Rives explique qu’un article de journal de l’époque regrette que les maisons démolies n’aient jamais fait l’objet d’une photo format carte postale, car elles dataient du 15e siècle. Ce même article mentionne que des caves plus anciennes encore que le 15e siècle existaient en sous-sol. Et que les gravats des maisons détruites ont tout bonnement servi à combler ces caves. Et l’année suivante, en 1930, on nivelait la nouvelle place tout en la pavant de frais, donnant plus de lisibilité à la quincaillerie Pilou...
1840. La ligne de Paris à Orléans n’est donc toujours pas encore construite que Casimir Lecomte s’installe à Vierzon et multiplie les réunions avec les futures communes traversées par le chemin de fer, Vierzon, Bourges, Issoudun, Châteauroux, Saint-Amand Montrond, Nevers...
Dès le quatre novembre 1840, le conseil municipal de Vierzon vote les 4 % de garantie d’emprunt demandée par le PO. Un mois plus tard, c’est au tour du conseil de Bourges de voter cette même résolution. Si le vote est unanime, certains de ses membres regrettent que Vierzon soit pressentie pour être la première ville du Cher à accueillir le chemin de fer, future gare de bifurcation qui plus est.
En février 1842, Ajasson de Grandsagne, capitaine d’artillerie en retraite, futur patron porcelainier et membre du conseil municipal part à Paris plaider la cause de Vierzon « au moment où les Chambres vont avoir incessamment à se prononcer sur les directions les plus avantageuses à donner aux diverses lignes de fer qui doivent sillonner la France... ».
Lorsque la loi de juin 1842 est promulguée, la gare d’Orléans n’est pas encore inaugurée. Le tracé jusqu’à Vierzon est pourtant déjà dans les cartons des ingénieurs, au grand dam du conseil général du Cher qui prend fait et cause pour Bourges. Dans sa séance de septembre 1842, l’assemblée départementale émet le vœu que cette ligne soit détournée pour que la ville de Bourges soit atteinte la première. Si tel n’était le cas, « il y aurait là violation flagrante de la loi... ». Lecomte doit à nouveau reprendre la route et organiser des réunions à Bourges. Il lui faudra tout son sang froid dans ces réunions interminables ; sang froid qu’il perdra en annonçant que les travaux sont de toutes façons d’ores et déjà prévus et financés pour le tracé de Vierzon et « qu’il n’y a pas lieu d’y revenir » dixit le Journal du Cher.
Travaux d’ampleur
Un an plus tard, alors que la ligne Paris – Orléans est ouverte au trafic ferroviaire, les ingénieurs en terminent avec le tracé dans la ville de Vierzon. Une enquête commodo-incommodo est lancée qui recueille une voix discordante, celle du vicomte de Romanet, gros propriétaire terrien – non résident. Si l’on avait suivi ses réclamations, la gare se serait aujourd’hui retrouvée quelque part dans le quartier de Bourgneuf. À cette voix discordante, les habitants ont répondu par une contre pétition maintenant l’embarcadère en centre ville.
Le lieu choisi fait en tout cas le bonheur des journalistes : « Le projet de messieurs Floucaud et Richomme ne laisse rien à désirer, pas même la part de la vue qui plongera sur le magnifique vallon du Cher et de l’Arnon ; quatre routes royales, celles de Paris, de Tours, de Bourges et de Châteauroux ; deux routes départementales, celles de Sancerre et d’Issoudun ; le bassin qui bientôt desservira le Cher et le canal, tout à proximité de cette gare. ».
Les travaux vont « bon train » et le département du Cher est en vue à l’hiver 1844-1845. Mais avant d’arriver à Vierzon il faut réaliser un ouvrage non prévu : le tunnel de l’Alouette sur une longueur de 1235 mètres pour la modique somme de 1,2 million de francs. Certains ont dit que la voie avait été recouverte pour permettre au propriétaire riverain de chasser sans les inconvénients d’un obstacle infranchissable. Rumeur tenace… mais infondée : le tunnel de l’Alouette a bien été réalisé pour empêcher les terres glaises de s’ébouler sur les rails.
Que la gare de Vierzon ne soit pas encore inaugurée ni même construite, cela n’empêche pas les voyageurs de faire le trajet Orléans – tunnel de l’Alouette ; le reste du chemin se faisant à pied ou en voiture attelée. Le journal du Cher parle alors d’un trafic de 119 000 voyageurs, de 63 000 tonnes de marchandises et de 457 000 têtes de bétail.
Un autre tunnel va être réalisé à Vierzon : « le petit tunnel de la porte aux bœufs », toujours issus des calculs de l’ingénieur Richomme. Il va rapidement donner son nom au quartier « Tunnel-Château ». Il faut aller vite, les terres déblayées resteront sur place. Elles sont en bordure de la ligne de chemin de fer : aujourd’hui sous le parking des acacias et l’impasse du Clos du Roy.
Pendant ce temps-là, à Bourges, on tergiverse sur l’emplacement de la future gare. Le journal du Cher ayant dévoilé son emplacement prévu, deux oppositions émergent, chacune parlant bien sûr au nom de l’intérêt général. À tel point que quand le chemin de fer arrivera, deux ans plus tard, l’emplacement de la gare ne sera toujours pas entériné…
Parallèlement à la ligne de Bourges, les travaux avancent également vers Châteauroux dont l’ingénieur pense que la cité pourrait être atteinte vers fin 1847. D’abord, il faut enjamber le Cher. Un pont est prévu à Chaillot pour ce faire. Il aura coûté la somme de 550 000 francs.
Les travaux commencent en mai 1845, au moment même où les forges de Vierzon annoncent avoir la capacité suffisante « pour la fabrication des rails pour les chemins de fer de Vierzon et de Bordeaux ». Entre Vierzon et Bourges, entre Vierzon et Châteauroux, entre Tours et Bordeaux, les kilomètres de rails sont sortis de la forge de Vierzon.
Le duc de Nemours, venu spécialement à Vierzon pour rendre visite au maître de forges passe le viaduc (au débouché de la rue Etienne Nivet, limite rue Pasteur / rue Etienne Marcel) et est stupéfait d’apprendre qu’il a été « construit comme par enchantement » en moins de 10 jours.
En octobre 1845, l’embarcadère sort enfin de terre à Vierzon. La création du nouveau moyen de locomotion, quelque vingt cinq ans plus tôt n’avait pas été prévu par les linguistes. Le vocabulaire utilisé sera emprunté à la marine. On parle d’embarcadère plutôt que gare. On parle de quai, on parle d’escale...
Inaugurations
Le 18 août 1846, le premier convoi officiel parti d’Orléans s’arrête à la gare de Vierzon toujours en construction. À son bord, quelques membres du conseil d’administration du PO mais aussi et surtout les ingénieurs, contremaîtres et ouvriers qui ont oeuvré tout au long des 80 kilomètres entre Orléans et Vierzon. La foule s’était massée sur le passage pour saluer et acclamer les précurseurs. Le convoi ira jusque dans « le petit tunnel de la Porte aux bœufs » avant de faire demi-tour jusqu’à la gare.
Un mois après jour pour jour, le premier convoi partant d’Orléans s’arrêtait à… Saint Doulchard, future gare provisoire, en attendant le tracé définitif dans la ville de Bourges. Là aussi la foule s’était rendue sur place pour accueillir la locomotive et ses voitures.
Ces deux premiers convois, obligatoires avant la mise en service, auront permis de constater la solidité des ouvrages d’art sur la ligne.
On commence alors à penser à une inauguration officielle qui pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année 1846. Mais c’est sans compter sur la météo. Les crues de la Loire de janvier 1847 ont emporté deux arches du pont de Vierzon à Orléans. La compagnie ne veut pas établir de gare provisoire en aval du pont. Le trafic est pour un temps interrompu.
La compagnie a prévu une mise en service de la ligne Orléans-Vierzon-Bourges au premier juillet 1847, en toute discrétion, sans aucune fête officielle, au grand dam du Journal du Cher qui se réjouissait déjà des festivités à venir.
Le premier juillet arrive et rien ne se passe. On apprend seulement le 13 juillet qu’une inauguration officielle aura bien lieu le 19 juillet., une simple bénédiction du chemin de fer par l’archevêque de Bourges. Quant au trafic, il sera ouvert au public le lendemain 20 juillet 1847.
Le 19 juillet le convoi inaugural part de Paris à 7 heures pour arriver à Orléans à 10 heures. Le convoi repart, traverse La Ferté, Lamothe Beuvron, et Salbris. Il s’arrête sous le tunnel de l’Alouette pour permettre aux voyageurs d’admirer l’édifice. Ensuite il y a déjeuner à Vierzon avant le départ vers la presque-gare de Bourges. Là, à 14h, les attendait une foule immense. Le voyage, arrêt non compris, met dorénavant Bourges à cinq heures de Paris.
Dans la gare provisoire l’archevêque bénit quatre locomotives de la compagnie : l’Ours, la Gazelle, le Sanglier et le Cerf.
Après un détour par la cathédrale et le palais épiscopal, les invités venus de Paris sont remontés dans le train à 18h précises pour Vierzon où un excellent dîner les attendait. Ils sont enfin remontés dans les voitures qui leur faisait retrouver Paris à minuit.
La ligne de Châteauroux sera quant à elle ouverte au public quelques mois plus tard, en novembre 1847…
Célestin Gérard, vosgien d’origine, fondait ses ateliers de réparation de matériels agricoles en face la gare, en 1848. Il a alors 27 ans. Menuisier, compagnon du Tour de France, il inventait également des outils et matériels qui vont faire prospérer ses ateliers.
Il permet à Vierzon de vivre sa troisième révolution industrielle, celle du machinisme agricole, après celle de la métallurgie avec les forges du comte d’Artois en 1779, et après celle des arts du feu avec la porcelaine en 1816.
Très vite, ses inventions seront remarquées, tarares pour nettoyer les grains, et surtout la première locomobile à roue, en 1866, invention pour laquelle il recevra la Légion d’Honneur. À la vente des « ateliers Gérard et fils » en 1879, il aura produit plus de 500 brevets dont certains sont encore d’actualité.
L'accusation de Creusé des Roches
Mais Gérard est loin d’être le seul mécanicien constructeur de machines agricoles. Un conflit va l’opposer à un autre inventeur, René Creusé des Roches, en 1859. Il est fabricant mécanicien, basé à Ingrandes, arrondissement de Le Blanc. Ce dernier l’accuse d’avoir copié son brevet de manège locomobile.
Un jugement en date du 16 juin 1859 déclare surseoir sa décision en attendant une expertise que le tribunal va ordonner.
C’est ainsi qu’entrent en jeu Henri Édouard Tresca et Louis Moll, tous deux professeurs au conservatoire des arts et métiers de Paris. Entre également en jeu Victor Bois, ingénieur civil demeurant à Paris. Tous trois ont été nommés experts pour départager les deux parties ; Tresca sera en charge de rédiger le procès-verbal.
L'expertise des machines
L’expertise a lieu le 28 août 1859, à 9 heures du matin. Les trois experts, après avoir « prêté le serment de bien et fidèlement remplir la mission à eux confiée... » dans le bureau du président du palais de justice de Bourges, se sont transportés jusqu’à la gare de marchandise où les attendaient Creusé des Roches et son associé Opter (banquier) et leur avocat d’une part, et Célestin Gérard de l’autre, accompagné de son avocat.
Les attendaient également plusieurs machines dont les manèges locomobiles des deux constructeurs. Les trois experts ont observé les ressemblances et dissemblances des deux machines et écouté les explications données par les deux parties. Et pour étayer leurs dires, Creusé des Roches et Gérard ont exhibé leurs brevets respectifs. Et là, il s’avérait que celui de Creusé des Roches est antérieur à celui de Gérard. 1856 pour le premier, 1858 pour le second.
Mais Gérard n’était pas venu qu’avec sa propre machine. Il en avait fait venir deux autres : un manège locomobile Damey et un manège Bonnevie (Dun sur Auron). Et Gérard d’annoncer que ces deux manèges sont antérieurs à celui de Creusé des Roches. De là à l’accuser de plagiat…
De fait le brevet Damey date bien de 1848. Creusé des Roches proteste et crie haut et fort à la mauvaise foi de Gérard.
C’est sur cette protestation que s’achève le procès-verbal émis par les trois experts désignés, Tresca, Moll et Bois.
La conciliation
Malheureusement, quelques fois, les documents importants n'arrivent pas jusqu'aux archives. Soit que les propriétaires ont extrait le document, soit que le document n'existe pas.
En l'occurrence, on ne sait rien des tractations qui ont eu lieu entre Creusé des Roches et Gérard entre les mois d'août et octobre 1859. Tractation verbale ? Échange épistolaire ? Par avocat interposé ?
Toujours est-il que le 25 octobre 1859, un procès-verbal de conciliation a été rédigé par l'expert Tresca. Les protagonistes se sont réunis dans les locaux du Conservatoire des Arts et Métiers, 292 rue saint Martin à Paris. Sont présent Tresca, Moll, Bois et Faure, tous quatre professeurs et ingénieurs civils. Sont également présents : Creusé des Roches, son associé Opter et leurs avocats. Enfin Gérard est également présent avec son avocat. À noter également la présence de Armengaud, expert et arbitre auprès de l'office international des brevets d'invention.
Les affaires étant les affaires, une bonne conciliation vaut mieux qu'un long procès.
La conciliation est très courte et comporte trois articles : Dans l'article un, les deux parties reconnaissent qu'elles possèdent chacun un brevet différent qui lui est propre. Dans l'article deux, il sera possible à chacune des parties d'apporter des modifications à leur brevet « à la condition que ni l'un ni l'autre n'imitera les modifications de son concurrent et que la concurrence restera commerciale et loyale ».
Quant à l'article trois, il stipule que toute querelle entre les parties est éteinte et que « les frais judiciaires et frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties. » …
Le testament de Hervé II seigneur de Vierzon, après quelques péripéties géographiques, se retrouve aujourd’hui aux archives départementales du Rhône. C’est là un document important pour l’histoire de la seigneurie de Vierzon au 13e siècle.
Hervé II devient seigneur de Vierzon à la mort de son frère Guillaume en 1197. Après une période sans heurts de près de soixante ans, Guillaume eut fort à faire avec son encombrant voisin propriétaire d’Issoudun : Richard Plantagenêt, futur Cœur de lion. La ville fut pillée en 1196 et ce n’est qu’au roi de France que Guillaume put la récupérer. Pas pour longtemps, Guillaume mourait dans l’année, laissant la seigneurie à son successeur Hervé.
Le chrétien pauvre mortel
La vie de Hervé II sera celle d’un homme mystique, voulant se rapprocher de la religion. Derrière chaque grand noble sommeille un chrétien mortel qui se soucie de l’éternité de son âme. Le rachat passe très souvent par des libéralités octroyées aux églises, ce que fera abondamment Hervé, en faveur des chapelains de sa seigneurie mais aussi des moines de Saint Pierre de Vierzon par exemple. Le rachat peut aussi passer par des aumônes en faveur de ses paysans. Il en affranchit certains précisément nommés ; il peut aussi affranchir une terre entière, comprenant tous les paysans qui y vivent.
Enfin pour Hervé, le rachat va également être synonyme de pèlerinage et de croisade. Dès qu’il entre en possession de la seigneurie, il fait le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. En 1213, il part pour la première fois en croisade, contre les albigeois. Il est alors neuvième sur la liste des 59 barons du royaume qui prennent part à cette croisade.
Damiette
Enfin, Hervé répond présent à l’appel de la cinquième croisade en Terre Sainte. Devant la difficulté de reprendre Jérusalem, les croisés choisissent de faire le siège de Damiette, port d’Égypte sur le Nil pour à terme l’échanger contre la ville sainte. Les croisés sont devant Damiette en mai 1218 et ne réussiront à la prendre qu’à la fin novembre 1219.
De cette prise Hervé ne verra rien, il est mort à l’automne 1218.
En prudent homme (« je veux aussi et j’ordonne que si je péris en ce voyage... »), il avait fait un testament avant de partir à la croisade (texte aujourd’hui disparu) et il en fait un autre « au siège de Damiette l’an de grâce 1218 au mois de novembre, le mercredi avant la fête de Saint Clément ».
Le testament
Ce testament est un condensé d’informations sur la seigneurie de Vierzon qui est alors à son apogée.
Son territoire tout d’abord. La généalogie des seigneurs de Vierzon avait commencé avec Humbault le Tortu dès le Xe siècle, vassal du comte de Blois Chartres et Chambord. Il a donné son nom au château de La Ferté Imbault. Par mariages et achats, la seigneurie englobe un vaste territoire entre Sologne et Berry. De Mennetou sur Cher à Brinon sur Sauldre en passant par Loreux, Selles saint Denis, et Pierrefitte sur Sauldre ; de Brinon à Reuilly en passant par Neuvy, Mehun et Lury.
Par contre, il ne faut pas voir un territoire au contour bien défini. Il y a de nombreuses enclaves étrangères dans la seigneurie. De même il existe des bouts de seigneurie dans les territoires voisins. Par exemple, l’archevêque de Bourges possède la terre de Chaillot. On apprend par ce testament que Hervé vient d’acheter la terre de Massay et la tannerie de Charasse dans la même paroisse. Et la seigneurie de Vierzon est propriétaire de Nizerolle, à côté de Dun sur Auron. Plusieurs seigneurs peuvent se partager les droits sur un même revenu. Avec le seigneur d’Issoudun il partage des revenus à Reuilly ; avec le prieuré de Beaumont de Tours il partage des revenus à Mennetou.
Des libéralités, Hervé continue à en donner aux différentes communautés religieuses. À commencer par les Templiers à qui il donne une rente sur son cellier de Vierzon ainsi que les revenus du moulin de Reuilly. À l’abbé de Massay il rend le droit de mesure. Aux moines de Saint Pierre de Vierzon il confirme le droit qu’il leur avait donné de ramasser du bois mort dans la forêt du Bois d’Yèvre.. Il confirme également que l’abbé de Vierzon peut vendre son vin au ban de Vierzon (en même temps que lui). Enfin, il donne une rente de 50 livres à l’église de Sainte Croix d’Orléans pour les dommages qu’il a fait dans ses bois.
Toutes ces donations ont un point commun : réparer ses mauvaises actions terrestres. Selon sa propre formule « en compensation des dommages que j’ai causés... » ;
L’ost de Hervé
Enfin, autre élément et non des moindres, ce testament montre l’entourage chevaleresque d’Hervé. Le droit d’ost n‘était pas qu’une prérogative royale. Hervé, baron de royaume et seigneur de Vierzon a convoqué ses vassaux sous sa bannière pour partir en Égypte. Et dans les terres non nobles les habitants devaient fournir des hommes prêtes à combattre, équipés par le seigneur. Dans son testament, aucun n’est oublié. Certains sont « serviteur », d’autres sont « chevalier ». Un chevalier est étymologiquement un combattant à cheval, homme libre pas forcément noble. Il sera en première ligne dans les guerres féodales.
Hervé les nomme tous. Certains n’ont qu’un prénom, d’autres ont également un patronyme. Dans la liste, deux des patronymes peuvent faire penser à une fonction : Laurent Camérier ou Jean Balistaire. Les donations testamentaires sont toujours assises sur des revenus du temporel du seigneur de Vierzon. Selon leur localisation on peut savoir d’où vient le chevalier ou serviteur. On peut également deviner leur degré de noblesse et enfin deviner que certains de ces hommes sont déjà morts au moment où Hervé rédige ses volontés.
Evrard de Prinçy : 40 livres en dédommagements des dommages que je lui ai faits
Barthélémy Raimboeuf : le serf qu’il a juré à lui appartenir
Eudes Chareuil chevalier : échange d’un terrain en terre d’Issoudun contre l’hommage fait au seigneur de Vierzon
Archambault Bénier et ses trois vassaux : je donne la mestive que j’avais sur eux
Raoul Coraux : qu’il reste en possession des héritages qu’il possédait avant le différent qui existait entre nous.
Renaud de Tracy : une rente sur Port de Sort
Héritiers de Garnier Thouard : cinq sous de rente assise sur mon four de la Ferté Imbaud
À la fille de Laurent Camérier, deux places aux foires de Vierzon en remplacement de celles qu’il y possédait.
Jobert de Maçay : je dois rendre hommage pour la tannerie de Charasse que j’ai achetée
Raoul de Charost : six setiers de seigle (sans localisation)
Galerand mon serviteur : cent sols de rente sur mes fours de Vierzon
Geoffroy Breton : sept livres de rente sur la prévôté de la Ferté Imbault
Jean mon cuisinier : six mesures de seigle sur les foires de Sologne
Giraud Sauvage : deux mesures de blé sur les mêmes
Jean Balistaire : une mesure de blé à la mesure de La Ferté Gerbert
Girard Artaud : une mesure de seigle à Mennetou
Thomassin de Lanorville : soixante sols assis à Brinon
Guillaume et son frère Philippe : chacun cent sols sur la terre de la Ferté Imbault
Etienne Champion : une mesure de seigle à Vierzon
Giraud Franun : une mesure de seigle sur les foires de Sologne
Odon de Culan : dix livres de rente sur les foires de Vierzon et il me rendra hommage
Geoffroy Hury chevalier : cent sols de rente
Harlequebault : un setier de seigle mesure de Vierzon
Gaucher Teneuil chevalier : deux de ses fils seront instruits moines
De cette liste, on dénombre vingt huit personnages qui ont accompagné Hervé jusque sous les murs de Damiette, dont Jean son cuisinier et Galerand, le serviteur.
Concernant ce dernier, la tradition veut que ce soit lui qui a ramené le corps de son maître jusqu’à Vierzon. Et ce serait ce même qui aurait donné son nom à la rue éponyme dans le vieux Vierzon.
« Je veux et ordonne que les legs que j’ai faits à ceux de mes chevaliers et de mes vassaux qui sont venus avec moi en terre sainte soient exécutés tels qu’ils sont exprimés dans la présente charte, et que les legs à eux faits avant mon départ et qui figurent dans le testament que j’ai fait dans mon pays soient scrupuleusement respectés ».
Toutes les dispositions ont elles été respectées ? Un vidimus contresigné par le comte de Nevers en 1221 permet d’en douter. Certains légataires ont dû faire appel à la mémoire du comte (présent à Damiette) pour pouvoir rentrer dans leur rente…
La Révolution Française est loin, pour les vierzonnais, d’être un cri du cœur. Il serait plus judicieux de dire que ce sont plutôt les ventres qui crient famine.
Le point commun de toute la période, dès 1786, jusqu’à 1794 la fin de la Terreur, est une véritable disette de grains qui menace les vierzonnais à chaque époque de soudure, cette période qui couvre la fin du printemps, lorsque les greniers sont vides et que les récoltes ne sont pas encore engrangées.
5000 âmes environ
Vierzon en 1789, ce n’est déjà plus cette grosse bourgade coincée dans ses murs d’Ancien Régime. Depuis longtemps ces derniers menacent ruine ou sont tombés, servant de carrière à de nombreux propriétaires pour construire leur demeure « hors les murs » ou appuyés à ces derniers.
Depuis 1745 les routes royales 20 et 76 traversent Vierzon de part en part. Un nouveau quartier se construit alors, autour de la « rue neuve » qui aboutit à la croix blanche, celle du couvent des capucins (actuelle place Péraudin).
Le recensement des habitants de 1790 donne 3635 habitants en centre ville. Mais il ne faut pas oublier ceux des villages de Vierzon, dont le chiffre est inconnu. On peut parler de quelque 5000 habitants pour l’ensemble de l’agglomération.
Sur ces 5000 habitants, nombreux sont ceux sur lesquels repose la fiscalité : les dîmes, tailles, champart, vingtième, corvées et gabelle, cet impôt sur le sel dont tous les cahiers de doléance de France vont demander la suppression.
Le cahier de doléance de Méreau a montré qu’un paysan gagne 140 livres/an. Toutes taxes mises bout à bout, il paye 88 livres d’impôt. Reste pour vivre 52 livres, soit de quoi faire vivre une famille de quatre personnes pendant six mois uniquement.
Certains s’essayent à une nouvelle activité : ouvrier chez le comte d’Artois dont les forges apparaissent en 1779 mais qui ont déjà fait disparaître les tisserands qui étaient en aval de l’Yèvre. Ce n’est pas tout. La forge a aussi fait disparaître une bonne partie de la forêt dde Vierzon qui n’est plus que l’ombre d’elle-même, au grand dam de Gourdon de Givry, maître des forêts.
Vierzon enfin, ce sont tous ses commerçants, bourgeois enrichis qui achètent un office pour échapper à l’impôt. Office que le roi vend pour des fonctions plus ou moins réelles : le maître des forêts, par exemple, dispose de cinq aides, tous ont acheté leur office.
L’hôtel de ville se situe dans le quartier château et vient d’être reconstruit en 1770. Ce qui ne l’empêche pas de menacer ruine en 1789. Les Officiers municipaux, Maire et échevins ne s’occupent que du quotidien des vierzonnais. Le vrai « maître » de Vierzon reste bien son seigneur apanagiste, le comte d’Artois. « Le conseil municipal soumet humblement à Monseigneur le Comte d’Artois de bien vouloir l’autoriser à... » selon la formule consacrée.
Mais les moyens financiers de la cité sont limités. Le budget municipal de 1791 est de 270 livres, tout juste de quoi payer le fonctionnaire de mairie, le tambour et les bougies. Tout ce que la ville peut compter de revenus est mis en coupe franche par le comte d’Artois, détenteur des revenus y afférents. Les autres revenus arrivent dans l’escarcelle du seigneur abbé de l’abbaye Saint Pierre de Vierzon. On comprend mieux alors, lorsque les biens des religieux et les biens des émigrés (nobles ayant fui) seront vendus, que la ville fasse tout pour se faire successeur des droits.
L’octroi allait pour moitié à l’abbaye, pour moitié au Comte. Dorénavant il ira à la Commune. Les fermes des moulins seront payées à la commune.etc… La commune multiplie par 10 son budget entre 1790 et 1792. Elle le multiplie par 100 entre 1790 et 1794, par 500 en 1799.
Hausse du prix du pain
La disette arrive lentement à Vierzon depuis 1783. Le prix des grains augmente. Les meuniers et boulangers de Vierzon font de la spéculation autour de cette céréale et le prix du pain s’envole.
Les officiers municipaux (Maire et échevins) ainsi que les officiers du bailliage (tribunal), rappellent sans cesse qu’il est interdit de spéculer.
Obligation est données aux boulangers de se fournir en farine auprès des meuniers et au prix fixé par la municipalité.
Obligation également aux meuniers de se fournir en grain « sur le marché aux bléds et non aux producteurs, aux prix fixés par la municipalité ».
Rappel enfin du respect de l’heure d’ouverture du marché. Il est interdit aux meuniers d’acheter avant que le marché ne soit ouvert à tous.
Des tentatives d’approvisionnement ont lieu de la part des officiers municipaux : on missionne des fonctionnaires publics du bailliage de se rendre dans les municipalités circonvoisines : Bourges, Romorantin, Châteauroux, Saint Amand, Issoudun, Salbris. Chaque voyage est l’objet d’un compte-rendu dans les registres municipaux.
Au printemps 1789, alors que les États Généraux ont déjà été convoqués, le grondement monte à Vierzon. Les vierzonnais ont leurs officiers municipaux dans le collimateur, eux qui, par l’achat de leur office, ne payent plus la taille, et qui en plus, ne sont pas capables de faire baisser les prix, ou au moins de faire respecter les horaires du marché.
Ce sera Issoudun qui se portera au secours des vierzonnais au printemps 1789, leur permettant de passer la soudure. Mais à quel prix… !
Les officiers municipaux sont obligés (juin – août 1789), alors que la Révolution est en marche et que l’Assemblée Nationale est constituée d’en appeler à la troupe pour protéger le marché hebdomadaire.
Le peuple gronde toujours, une émeute de la faim a lieu le 16 août. Le lieutenant général du bailliage (NIZON) est obligé de s’enfuir jusqu’à Sancerre où il présente sa démission à son homologue local (« après 37 années de bons et loyaux services »… !) Décidément, il ne comprend plus le monde qui l’entoure.
Cette cherté du pain est de plus liée à un phénomène que les historiens ont pris depuis peu de temps en compte : un climat épouvantablement froid.
Le froid empêche les plantes de germer. On a observé des gelées à Lyon en juin 1789 ; ces mêmes gelées avaient également atteint Toulouse le même mois.. Certainement, Vierzon n’est pas à l’abri…
Il y a quelques années, dans son ouvrage sur la porcelaine en Berry, Michel Bloit exhumait des archives parisiennes inédites la preuve du passage à Vierzon de Marc Schoelcher, père de Victor. On apprenait ainsi qu’il avait acheté la manufacture de porcelaine de Bel Air, dite Perrot et Delvincourt. Elle sera plus connue après 1852 sous le nom de Hache, sise aujourd'hui rue de la Société Française.
On sait de Marc Shoelcher, alsacien d’origine, qu’il débarque à Paris en 1789 ; il a alors 23 ans. Il habite chez sa cousine, femme du porcelainier Jean-Baptiste Locré. C’est dans cette firme que Schoelcher découvre et apprend le métier de porcelainier. Son mariage (avec Victoire Jacob) lui ouvre les portes de la haute finance. Il rachète alors (1798) la plus grande fabrique de porcelaine de Paris : la manufacture dite du Comte d’Artois (lui-même fondateur de la forge de Vierzon en 1777).
Partisan de l’Empereur, Marc sait tourner avec le vent et devient vite partisan de la Restauration. Cela lui permet de poursuivre son activité dans la plus grande prospérité. En 1823 il achète la manufacture Perrot de Vierzon. Quid de son activité vierzonnaise ? Nulle archive, correspondance, livre de comptes… ne peut relater les six ans de l’époque Schoelcher à Bel Air. On sait juste que Pétry et Ronsse deviennent propriétaires du site en 1829.
Quand le jeune Victor arrive au monde, en 1804, son père est à la tête de la plus grosse porcelainerie de Paris. Victor fera de très courtes études au lycée Louis le Grand, apparemment au grand dam de son père. Son frère aîné embrasse la carrière militaire. Le plus jeune décidera de reprendre l’usine familiale. Il ne reste donc plus beaucoup de place à Victor pour s’affirmer au sein de la famille.
Son père en fait son associé en 1828 et l’envoie en Limousin et en Berry pour « apprendre la porcelaine », surtout pour en connaître tous les flux financiers.
C’est dans ce laps de temps de un an (1828-1829) que se pose la question de son passage à Vierzon. Et si oui pourquoi ? Comme observateur ? Comme directeur artistique (Victor écrit beaucoup dans la revue « artiste » de l’époque) ? Comme directeur général ? Pas si évident car Victor a laissé auprès des historiens (1) l’image d’un homme désœuvré que son père cherche à placer contre sa volonté. En 1831 Victor écrira même : « On peut être utile à la société en faisant autre chose que des bottes ou de la faïence », allusion aux métiers de sa mère et de son père.
Marc enverra tout de même son fils vers le Nouveau Monde comme commercial, trouver de nouveaux débouchés pour son usine parisienne.
La suite de l’histoire est connue. Parti au Mexique en 1830 trouver des clients, il y découvrira le monde de l’esclavage. Écrivain, militant, il mettra dix huit ans à convaincre ses contemporains de la barbarie indigne dont les esclaves sont traités.
Nommé sous-secrétaire d’État à la Marine et aux Colonies lors du gouvernement provisoire de 1848, Victor Schoelcher est le principal artisan du premier décret d’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848. Il permet ainsi à plus de 250 000 Noirs (selon sa propre estimation) de devenir citoyens français.
L’archive du vendredi a déjà abondamment utilisé une source essentielle : les registres du bailliage, tribunal existant à Vierzon depuis Louis XI et érigé en bailliage royal par François Ier. Conservés aux archives départementales du Cher, les registres ont ceci d’exceptionnels que c’est la vie quotidienne des Vierzonnais qui s’étale au grand jour pour les chercheurs que nous sommes. Affaires d’héritages, querelles de voisinage, toutes ces affaires privées que nos aïeux n’auraient pas aimé voir sorties du restreint de la famille. C’est le cas également pour les trois affaires qui suivent et qui sont retranscrites tel quel. Si ces affaires reflètent une réalité historique, c’est bien par le vocabulaire employé qu’elles peuvent, avec le recul, prêter à sourire.
Séduction de Michèle Barreau
« Ce jour (26 février 1647) est comparue Michèle Barreau, fille de Pierre Barreau maître écrivain et d’Isabelle Gouault, séduite par François Thébault, fils d’Etienne Thébault, cordonnier. La plaignante demande que le sieur Thébault soit tenu de l’épouser à peine d’être pendu et estranglé à une fourche patibulaire et exécuté par le maître des hautes œuvres de la justice et condamné aux dépens.
La séduction commune dans une chambre louée par Thébault père qui s’était retiré dans un petit bien qu’il exploite de ses mains et voisin de la demeure de Pierre Barreau. Là il se serait accosté de ladite Barreau et fait entendre qu’il la voulait rechercher en mariage. Et après avoir fréquenté icelle quelque temps, l’aurait, par ses paroles et ses promesses, suscité à condescendre et contrainte. En quoi elle ne voulait entendre sur la crainte qu’elle avait de l’offense à Dieu de perdre son honneur. Nonobstant ses défenses, elle n’aurait pas pu faire en sorte de se retirer des mains dudit Thbault qui l’aurait forcée et contrainte sous lesdites promesses. Qu’il l’avait connue charnellement plusieurs fois, tant dans la chambre où il descendait mais aussi dans celle de son père et s’y venait coucher avec elle dans son lit. L’avait encore promenée dans le lieu de son père nommé la Peaulderie et dans la grange dudit lieu prenant ses consentements avec elle. Et ne se cachait de dire devant tout le monde qu’il voulait coucher avec elle, en telle sorte qu’elle serait demeurée enceinte de ses œuvres et qui alors aurait fait la sourde oreille. »
Denise Thierry
« Ce jour (13 février 1688) est comparue Denise Thierry, fille de Jean, marchand cordonnier et de Jeanne Duverger, âgée de seize ans. Nous a dit être au service de Simon Rousseau notaire à Vierzon depuis un an la Saint-Jean passée. Ledit Rousseau s’étant trouvé seul dans la maison avec elle un jour de cette année, il y a peut-être cinq mois, il l’aurait trouvée en son lit et l’aurait portée dans le sien. En la tenant lui aurait fermé la bouche de peur qu’elle criât et enfin l’aurait connue charnellement. Et ensuite aurait causé plusieurs fois avec elle pendant que ladite femme Rousseau a été absente. En sorte qu’elle s’est trouvée grosse de son enfant presque les premières fois qu’il a eu à faire avec elle. Ledit sieur Rousseau pour couvrir ce fait qui est bas et honteux lui aurait conseillé de se laisser connaître à d’autres et promis qu’il la ferait épouser par ceux qui l’auraient connue. »
Catherine Parthon
26 mars 1685, « enquête qui a abusé d’elle charnellement. Elle dit que c’est du fait de maître Gervais Pastureau notaire à Vierzon avec lequel elle avait eu à faire il y a un an ou plus qu’elle avait servi au logis dudit Pastureau, n’ayant lors que quinze ou seize ans. Et que dès lors ledit Pastureau, un soir qu’il avait fait la débauche, lui ayant tiré ses bas la prit par un bras la voulant attirer à lui. Mais qu’elle cria qu’il allait lui rompre le bras. Il cessa et icelle descendit dans une petite cuisine. Et que la femme dudit Pastureau était allée ce jour-là à Vouzeron d’où elle n’était pas venue.
Sa sœur (la sœur de Catherine NDLA), femme de Jousselin, boucher, se doutant qu’elle était grosse, lui demanda si cela était. Que lui ayant avoué et que c’était du fait dudit Pastureau, sa sœur alla trouver ledit Pastureau dans le jardin. »
Rien n’est moins sûr quant aux amabilités qui se sont échangées. On a plutôt du y parler gros sous…
En 843, le roi de Francia Occidentalis Charles le Chauve, avec la bénédiction du pape Grégoire IV, fonde à Dèvres une abbaye bénédictine, future abbaye Saint Pierre de Vierzon, et la dote richement de terres qui, exploitées, feront vivre les moines. Depuis cet acte fondateur, tous les rois ont cherché à interférer dans les affaires de l'abbaye, que ce soit par décisions financières ou politiques, entraînant des changements dans la vie des moines.
Les finances
Clovis, premier roi Franc converti, prend exemple sur les empereurs romains chrétiens et poursuit la politique d’exemption d’impôt des hommes d’Église. La tradition était tellement ancrée sous la décadence carolingienne qu’avec l’arrivée des capétiens et de la féodalité ils se disaient dispensés d’impôt par Dieu lui-même.
La seule solution pour le roi d’obtenir des subsides de son clergé réside alors en des demandes exceptionnelles, qui se doivent d’être validées par le pape. Philippe Auguste usera et abusera de ces expédients lors des croisades qu’il mène, en Terre Sainte comme contre les Albigeois. Le clergé est prié d’apporter son écot à la guerre du roi.
La contribution exceptionnelle – décime – devient régulière avec la montée de l’absolutisme royal.
C’est sous Henri III que le « don gratuit » apparaît, autant sur les séculiers que les réguliers. Il y a même une possibilité d’abonnement annuel, ce qui permet d’éviter de trop lourds dons ponctuels. Lorsque le roi crée cet impôt qui ne dit pas son nom, le but est de faire contribuer le clergé à la lutte contre les huguenots et l’entretien des armées catholiques, ainsi il a la sensation de faire œuvre utile pour la propagation de la vraie foi réaffirmée par le concile de Trente. Les finances de l’abbaye nous apprennent que le roi a même obtenu du pape une contribution exceptionnelle en 1572 de plus de un million cinq cent milles livres sur tous les bénéfices ecclésiastiques. L’abbaye fut alors taxée à quatre cents livres.
Comme tout nouvel « impôt », ce don gratuit sera tout de même maintenu après les Guerres de Religion. On voit plusieurs fois l’abbé de Vierzon mander audience au roi et le supplier très humblement de supprimer cette taxe ou au moins l’ajourner (sans succès).
Les coûteuses guerres de Louis XIV contre la maison d’Espagne dans les années 1670 vont aussi être une façon de réduire le domaine foncier de l’abbaye. Là encore le roi va faire appel à la générosité de son clergé. En plus du don gratuit maintenant entré dans les mœurs, il taxe ponctuellement le clergé d’un lourd tribu. Et là, plus question de demander l’autorisation du pape. Faute de numéraire, l’abbaye va devoir vendre une partie de ses biens immobiliers dans les années 1670 – 1675. Ce sont les terres dans les paroisses les plus éloignées telles Salbris, ou encore Migny et La Chapelle. L’abbaye met également aux enchères quelques droits qu’elle possédait en terre de Massay et de Romorantin.
Le pouvoir passe des abbés aux prieurs
La plus grande intervention du roi dans les affaires de l’abbaye sera relative à l’élection du père abbé. Saint Pierre de Vierzon est une abbaye bénédictine, observant scrupuleusement la règle de saint Benoît qui veut que l’abbé soit élu tous les deux ans, choisi parmi les moines.
L’élection libre ne se fera plus à partir de 1516. Le concordat de Bologne permet alors à François Ier de nommer les abbés qu’il souhaite à la tête des abbayes par le système de la commende. Cela lui permet d’élargir ses libéralités, de remercier ceux qui l’ont bien servi.
Dorénavant les abbés nommés seront dénommés abbés commendataires, en opposition aux abbés élus. À Vierzon l’exemple parfait d’abbé commendataire est Charles Langlois, nommé à la tête de Saint Pierre en 1668 en récompense de ses bons services comme prêtre à Versailles. (Mais certainement aussi pour Louis XIV la possibilité d’éloigner cet homme trop puritain de la cour du roi).
Son successeur sera l’abbé Deplas, vers 1670. Il est celui qui qui introduit la réforme de la congrégation de Saint Maur au sein de l’abbaye. Il en chasse tous les moines pour les remplacer par des moines réformés. En fait la congrégation est née en réaction au système de la commende. En effet des abus sont fréquemment dénoncés : Le roi finit par nommer des non religieux à la tête des abbayes… Pour parer à cela, la congrégation de Saint Maur institue les prieurs comme chefs des abbayes. Jusque là numéro deux de l’abbaye, il devient le véritable chef spirituel et temporel, élu pour trois ans par ses pairs. Il est demandé aux abbés de ne plus se mêler des affaires de l’abbaye. Cela devient une fonction honorifique. Il se contente d’encaisser les revenus liés à sa charge.
Mais il se peut que ce revenu soit insuffisant pour le train de vie de l’abbé nommé. L’abbé Charan se plaint au roi Louis XV en 1757 que l’abbaye a de trop faibles moyens pour lui. Qu’à cela ne tienne, le roi ordonne que les moines règlent à l’abbé une redevance annuelle de 1000 livres en échange de la réunion des deux manses.
Le système financier d’une abbaye est très complexe jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Chaque moine dispose de revenus liés à sa charge ; le camérier, le barbier, le chantre, le prieur, etc.…
De plus, les revenus fonciers de l’abbaye sont divisés en deux parties appelées manses. Il y a la manse abbatiale qui sont les revenus du père abbé ; et il y a la manse conventuelle, partie des revenus qui sont dévolus à l’ensemble des autres moines.
Le texte de 1757 nous apprend que les revenus de l’abbaye sont de 1800 livres par an, dont 800 pour la manse de l’abbé Charan qui estime que cela est fort peu (revenu d’un journalier agricole : 60 livres/an). Le roi ordonne la réunification des deux manses au profit des moines, à charge pour eux de verser une rente de 1000 livres/an à l’abbé.
Les moines ont accepté bien volontiers cette transaction. Dorénavant ils sont les seuls maîtres de leurs revenus et des transactions à venir. De plus, devenus propriétaires de tous les bâtiments de l’abbaye, ils vont oeuvrer à une politique rationnelle de leur entretien, réalisant une substantielle économie par la démolition de nombreux établissements. Les moines n’hésitent alors pas à détruire ou revendre des bâtiments consacrés…
Après 1757, les prieurs de Saint Pierre sont devenus les personnages importants de l’abbaye, l’abbé se contentant de paraître. Le chapitre abbatial est à nouveau maître des décisions financières de l’abbaye. Il peut acter, transiger, ester en justice. De nombreux textes post 1757 montrent que les moines ont souhaité remettre de l’ordre dans leurs finances, cherchant à augmenter leur revenu, multipliant les procès contre les mauvais payeurs…
Jusqu’en février 1790 où tout s’arrête…
Vierzon, sous l’Ancien Régime, appartenait à la province et généralité du Berry, « la province où l’on s’ennuie », selon Louis XV. Comme dans les 33 généralités du royaume, elle était dirigée par un Intendant, depuis sa capitale Bourges. Lui même avait des subdélégués qui géraient les affaires de la province, y faisant appliquer les décisions royales. C’est ainsi que les villages de Vierzon, ensemble de hameaux dispersés autour de notre cité médiévale étaient gérés par deux subdélégués de l’Intendant.
Vierzon même est le siège de trois institutions. Chronologiquement est apparu en premier le Grenier à sel de Vierzon (angle rue des changes / marché aux blés) en même temps que l’impôt qui va avec : la gabelle.
Puis est apparu le Tribunal de bailliage en 1523 avec à sa tête un lieutenant général, en remplacement de la vieille justice seigneuriale. Le tribunal a eu la bougeotte et se situait dans l’enceinte du château à l’aube de la Révolution.
Enfin, dernière institution, celle de la Maîtrise des eaux et forêts, apparue sous Colbert, chargée de gérer durablement les forêts du royaume.
À l’issue de la convocation des États Généraux et du Serment du jeu de paume, l’Assemblée Nationale se déclare Constituante. Elle fait table rase de toutes les institutions d’Ancien Régime. Les généralités avec leur Intendant sont supprimées ; les tribunaux de bailliage également.
Côté clergé, les paroisses sont redessinées. Puisque Vierzon possède deux églises, l’ancienne paroisse de Vierzon qui comprend Vierzon, les Villages et Saint Hillaire de Court est coupée en deux : L’église Notre Dame est réservée à la paroisse des Villages et de Saint Hilaire. L’église Saint Pierre sera dévolue à la paroisse de Vierzon Ville lorsque les moines auront définitivement quitté leur couvent (mars 1790).
Il ne faut pas confondre paroisse ecclésiastique et paroisse fiscale. Pour le calcul et le recouvrement de l’impôt, la commune de Vierzon sera divisée en huit paroisses fiscales.
Enfin le diocèse est supprimé. Le primat d’Aquitaine devient « évêque métropolitain du centre ». Le premier à occuper cette fonction est l’évêque jacobin Torné qui deviendra rapidement député de la Législative avant de devenir président du Conseil général du Cher puis de quitter l’habit religieux.
La Constituante remplace toutes ces circonscriptions par une strate uniforme d’administrations.
Le 11 novembre 1789, elle crée les départements. La généralité de Berry est divisée en deux départements : le Haut Berry (Bourges) et le Bas Berry (Châteauroux). Ces deux noms sont abandonnés le 26 février 1790 pour devenir respectivement Cher et Indre. Cette création ne s’est pas faite sans heurt : Issoudun par exemple voulait être dans le Cher. L’assemblée départementale se réunit pour la première fois en décembre 1789.
À l’échelon inférieur on trouve dorénavant le district, sorte de sous-préfecture. Le Cher en comportait sept, dont celui de Vierzon. Ses décisions s’appliquent de Graçay à Mehun sur Yèvre en passant par La Chapelle d’Angilon. Le district comporte neuf membres, choisis dans les communes le composant. Parmi eux, un membre va prendre de l’importance : le procureur syndic qui devient relai de la Convention (1792-1794). En 1790 le président du district est un certain Sauger. Il va très vite céder sa place à un dénommé Ruellé, notaire de son état.
À ce district va être accolé un tribunal en 1791. C’était là une demande des communes qui avaient perdu leur bailliage. Le « tribunal du district », ancêtre de notre tribunal d’instance, avait la compétence sur la même aire géographique que le district et a été confié dans ses débuts à Delavarenne père et fils, anciens juges au bailliage de Mehun. Très souvent au district et au tribunal siégeront les mêmes personnages jusqu’à de que la Terreur chasse le personnel en place.
Sur un échelon intermédiaire, la Constituante crée également les cantons, réunion de plusieurs communes. Le Vierzon de 1790 comporte les mêmes deux cantons que le Vierzon de 2023.
Enfin les communes sont créées. Elles n’ont plus rien à voir avec le système communal médiéval. S’en est fini du conseil des trois échevins. Dorénavant les conseils municipaux seront le reflet du choix de l’ensemble du Tiers État. Les communes modernes serviront de base électorale. Février 1790 voit la création des communes de Vierzon Ville et de Vierzon les Villages. La Constituante considérait que l’étendue de Vierzon ne pouvait être gérée par un seul conseil municipal et réactivait alors l’ancien morcellement du territoire en deux entités distinctes, ce qui ne va pas aller sans créer de nouveaux problèmes pour Vierzon les Villages dont le point central se trouve à Vierzon Ville.
Ces trois niveaux d’administrations département – canton – commune furent dotées d’assemblées élues à deux niveaux. L’assemblée primaire élit, dans les cantons, les électeurs qui eux-mêmes éliront : les députés, les représentants au département, les administrateurs des districts.
Quant aux collectivités, elles sont (officiellement du moins) hiérarchisées : Les décision du Directoire s’imposent aux départements qui s’imposent eux-mêmes aux districts qui s’imposent à leur tour aux communes.
À cette hiérarchie administrative, il faut rajouter la présence de clubs jacobins : Une « société populaire » dans chaque département et chaque district, afin d’apporter la bonne parole révolutionnaire. À Vierzon, c’est Bazin (instituteur), qui en est le président. Accusée d’excès, elle changera de nom pour devenir « agence révolutionnaire », Bazin demeurant son président.
Cela ne suffisant pas, la Convention rajoute un « Comité de surveillance » en février 1793, notamment chargé de la loi sur les suspects.
Une double difficulté émerge aujourd’hui pour la compréhension des événements vierzonnais.: L’ensemble des administrations siégeait dans le même bâtiment : le bâtiment conventuel des moines (la mairie aujourd’hui). Le district, son tribunal, les municipalités de Ville et Villages siégeaient tous au rez-de-chaussée de l’ancienne abbaye. Elle avait été réquisitionnée dès le départ des moines. Bientôt la société populaire intégrait également ce même bâtiment.
De plus, bon nombre de personnels administratifs et élus pouvaient siéger dans les différentes structures. On retrouve par exemple Ruellé membre du district, du directoire du district, du tribunal du district et enfin membre de la commune de Vierzon Ville.
Du coup, on ne s’embête pas à changer de registre lorsque l’on passe d’une réunion à une autre. Les décisions des différentes administrations se succèdent dans le même registre. Quelques fois, seules les signatures des présents peuvent permettre de déterminer de quelle réunion il s’agissait. En fait seule la municipalité de Vierzon Ville avait son propre registre.
La hiérarchisation des décisions a vite entraîné un grippage dans les rouages administratifs. C’est pourquoi la Convention a inventé (juillet 1792) une nouvelle fonction : l’envoyé en mission de représentants avec tous pouvoirs.
À Vierzon cela se traduit par le passage de trois envoyés de la Convention dont Labouvrie qui a laissé le plus de traces. Il démet de leur fonction tous les fonctionnaires et élus des administrations locales pour y placer des hommes neufs, plus montagnards. Mais il est difficile de trouver des hommes compétents et la colère gronde.
La révolution thermidorienne (chute de Robespierre et fin de la Terreur) change la donne. Le district et son tribunal sont supprimés. Les communes également.
Il n’y a dès lors plus que deux niveaux de décision : le département et les « communes de cantons », vrai ancêtre de nos communautés de communes...
« Le Canard enchaîné local ». C’est l’expression la plus juste pour qualifier l’éphémère COCORICO. Mensuel d’informations né en 1927, il aura fait rire les vierzonnais neuf années durant aux dépends de ses têtes de turcs préférées : les élus des quatre Vierzon.
L’offre de presse dans les années 1930 est importante. Deux titres sortent du lot : La Dépêche du Berry, grand journal généraliste du département qui était né rue Joffre en 1893 ; et le Journal de Vierzon, tourné vers le commerce et l’agriculture, né lui en 1921.
Le Cocorico lui, est né en mai 1927, dans les locaux de son propriétaire, le libraire imprimeur Paul Poivert, place du Mail. Principal rédacteur, il s’associe à Dehaullon, deuxième plume du journal, qui possède le grand magasin voisin des Nouvelles Galeries.
Dans son ouvrage (1), Frédéric Morillon a bien montré comment les deux auteurs doivent se démarquer pour exister. Leur journal sera un mensuel satirique d’information, apolitique. Il traitera l’information locale sur un ton humoristique et ne s’interdira rien, sauf les coups en dessous de la ceinture.
Dès les premiers numéros, une rubrique devient incontournable : « en passant », véritable poil à gratter des politiques locaux. Les rédacteurs que sont Poivert et Dehaullon dévoilent sous forme de brèves des informations que l’on ne trouve pas ailleurs. Ils dissèquent les projets municipaux et leur financement, dénonçant des dépenses inutiles dans cette période des années 1930, celles de la crise économique. Très lue, la rubrique passe rapidement en première page.
Enfin et surtout, à partir de 1932, le Cocorico s’adjoint les services d’un dessinateur maison, caricaturiste de talent, qui croquera les personnalités locales, sous le pseudo de Regor, anagramme de son prénom.
On sait peu de choses sur lui. Son vrai nom ? Roger Rabot. Il fréquente le cabaret de la Croix blanche « les Arts », s’essayant un peu à la musique, et ayant fait quelques apparitions dans des pièces de théâtre. C’est bien le dessin qui l’aura fait connaître. Après l’aventure Cocorico, Regor poursuivra sa carrière de caricaturiste au Berry Républicain jusque dans les années 1960.
À partir de 1932, chaque numéro comprendra un article sur un événement local que Regor illustrera par une caricature que l’on retrouvera en bas de page. Le point d’orgue du journal aura été l’album « spécial œufs de Pâques », regroupant ses meilleures caricatures, publié à Pâques 1935.
Le sérieux des enquêtes et le ton sur lequel elles sont menées d’une part, la mouche du coche qu’est la rubrique « en passant », et enfin l’arrivée de Regor expliquent le succès grandissant du mensuel. D’où la comparaison avec le Canard enchaîné, né douze ans plus tôt. La différence entre les deux titres ne réside que dans le nom du volatile…
Il s’en vend 6000 exemplaires dans les années 1930. Et pourtant on ne le trouve pas en kiosque ; uniquement sur abonnement. Vierzon compte alors 25 000 habitants. C’est un vierzonnais sur quatre qui est abonné !
La question majeure pour l’agglomération vierzonnaise des années 1930 reste celle de la Fusion des Quatre Vierzon. Et ce sera là le principal cheval de bataille du journal : œuvrer en sa faveur.
Depuis la Révolution française, Vierzon n’avait pas cessée d’être divisée : Vierzon-Ville, Vierzon-Villages, puis Vierzon-Bourgneuf et enfin Vierzon-Forges.
La question redevient d’actualité avec l’élection de Georges Rousseau – PCF – à la mairie de Vierzon Villages en 1929. Il propose à ses homologues – socialistes – de Ville, Bourgneuf et Forges une première rencontrer autour de ce thème. L’enjeu pour le PCF est alors la victoire électorale dans un Vierzon réunifié.
Très vite le Cocorico s’invite dans la conversation et participe au débat. De deux manières. D’abord avec des articles choc : Toujours les mêmes histoires de pagaille créée par la division : pagaille à la poste par exemple : Quatre rues de la République, quatre rues Félix Pyat… ce qui veut dire des retards et des erreurs dans la distribution des courriers.
Mais aussi des pagaille dans les infrastructures : des rues partent de Vierzon Ville et qui se terminent en impasse devant le panneau Vierzon-Forges. Un tunnel à quatre voies qui part de Vierzon Ville pour se terminer par un chemin de brouette à Vierzon-Villages. Ou encore l’électrification qui oublie quelques maisons d’une rue puisque dans la commune voisine.
Le Cocorico ne se contente pas de multiplier les exemples à l’envie. A chaque article, il montre le coût induit et les économies possibles si Vierzon n’était plus qu’un. Et parler du porte-monnaie des contribuables est un argument de poids en sa faveur...
L’autre façon pour le Cocrico de s’inviter dans le débat, ce sont les caricatures. Très vite les têtes de turc du mensuel vont être les maires défavorables à la Fusion.
Autrement dit, les trois maires de Ville – Lucien Beaufrère, Bourgneuf – Félix chariot, et Forges – Antoine Rosay, vont être régulièrement brocardés. En cette période de crise des années 1930, Beaufrère et Rosay sont épinglés pour leurs dépenses somptueuses (le monumenr aux morts de Ville , l’école des filles de Forges)...
Mais la palme revient à Chariot, principale tête de turc du journal et anti fusioniste jusqu’au boutiste. Sa gestion de l’eau potable est calamiteuse. Il construit un château d’eau au Jonc alors que l’usine élévatoire du Saint Esprit pouvait apporter l’eau dans les foyers de Bourgtneuf. De plus il fait venir les tuyaux en acier de la Ruhr, dans une Allemagne récemment devenue hitlérienne…Enfin, la plus célèbre caricature de Regor, car prémonitoire reste celle où il croque Chariot en Hitler lui-même, rappelant que le Cher est un frontière naturelle, justifiant l’indépendance à tous prix de sa commune.
Sabordé en juin 1936 pour une raison inconnue et après 108 numéros, le Cocorico n’aura pas été le témoin de la reunification effective des Quatre Vierzon en ce 8 avril 1937, ni des élections générales qui s’en sont suivies avec la victoire de la liste de Georges Rousseau...
Il va aujourd'hui être question de glace et de glacière.
En effet, quoi de plus rafraîchissant que quelques glaçons dans un verre lorsque les températures extérieures dépassent les 30 degrés ? Notre réfrigérateur actuel, inventé dans les années 1860, produit industriellement à partir de 1920, ne s'est démocratisé en France que dans les années 1950. La consommation de glace est, elle, bien plus ancienne.
Les Romains déjà, avaient importé en Gaule l'usage de la glace dans les thermes. L'eau froide du frigidarium était ainsi maintenue à basse température.
Outre cet usage, les Grecs et Romains utilisaient la glace pour un usage thérapeutique : soulager les fièvres, stopper les hémorragies…
Dans les années 1970 est apparue une nouvelle théorie soutenue par les historiens : les fameuses oubliettes de nos châteaux-forts pourraient bien être en fait des fosses réservées à la conservation des blocs de glace. Car il était communément admis que nos ancêtres connaissaient parfaitement l’usage de la glace pour la conservation des aliments. Mais il y avait controverse entre historiens et archéologues. En effet, il n’y a pas de glacière type. Et rien ne ressemble plus à une glacière qu’une cave sommairement aménagée. Le seul indice fiable pour authentifier la présence d’une glacière dans un château est la présence d’un sas d’entrée et d’un caniveau d’évacuation des eaux de fonte. Seuls en France une dizaine de châteaux-forts ont avec certitude ces caractéristiques.
Dans le château de Vierzon, aucune preuve d’une telle construction. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’existait pas de glacière seigneuriale. Pourtant, là aussi, peu d’élément dans les archives municipales ; seul son emplacement est connu, pas sa date de création. Un procès-verbal de 1768 évoque l’échange d’un terrain municipal donné à un certain Lepouce en échange de sa masure : « … échange de la masure appartenant à Joseph Lepouce pour pratiquer une place publique devant la principale porte dudit édifice, d’autant plus que ladite masure se trouve située dans la place du château de cette ville, du côté des murs d’icelle et près de la glacière ».
Il faut donc imaginer une cave relativement profonde pour permettre que l’air froid reste au sol avec une double porte d’entrée, si possible en hauteur. Ce bâtiment a effectivement existé dans le Vieux Vierzon, mis à jour lors des travaux de construction des HLM du Tunnel-château. Ses restes se trouvent aujourd’hui quelque part sous le bâtiment de la sécurité sociale, place de la Résistance.
Quant à son fonctionnement il est relativement simple. On utilisait la glace qui se formait les mois d’hiver sur les méandres de l’Yèvre pour la transporter jusqu’à la glacière et avoir ainsi de la glace l’été, jusqu’en octobre si la cave était correctement tempérée. Une autre solution pouvait consister à récupérer la neige et à la compacter pour en faire des blocs.
Le simple fait que la glacière n’a laissé aucune trace dans les archives montre que son utilisation était restreinte. Et ne servait en tout cas pas pour la conservation des aliments ou à titre anecdotique. Nous sommes dans un pays de grande gabelle et le sel est l’aliment phare pour la préservation des aliments. L’administration du grenier à sel de Vierzon est bien connue. Pas celle de la glacière. Pourtant de même qu’il existait la gabelle, il existait également un droit de glace exercé par le seigneur (avec prérogative royale), avec ses officiers et son personnel.
Tout juste avons nous un procès verbal de réparations faites et à faire à la glacière (devenue municipale) dans les années 1685-1686. La glacière est remise en état. C’est l’époque où louis XIV s’est arrogé le monopole de la vente de glace…
Néanmoins, on peut peut-être imaginer que la glacière était utilisée pour l’Hôtel-Dieu (actuelle école Charot), pour faire baisser les fièvres, en temps de peste, choléra... Il n’y a en effet pas de trace non plus d’une glacière dépendant du premier hôpital vierzonnais. Son administration édite régulièrement la liste des possessions et droits de l’Hôtel-Dieu, aucune glacière n’apparaît.
Autre mystère, les moines de l’abbaye Saint Pierre. Les religieux sont au fait des diverses utilisations de la glace, nombreuses sont les abbayes en France possédant leur propre glacière. Les moines de Vierzon, qui ont laissé de nombreux écrits sur l’entretien de leurs bâtiments, ne mentionnent pas de glacière. Pourtant, la proximité immédiate de l’Yèvre leur aurait permis un stockage aisé de blocs.
Quant à la glacière municipale, 30 ans après les travaux de 1685, elle est à l’abandon. Un procès verbal de visite des biens comunaux donne cette information (16 janvier 1718) : « … visite… de la glacière, située à côté de la Porte aux bœufs, près des murs de la ville, démolie depuis huit ou dix ans... ».
Elle réapparaît néanmoins une dernière fois (outre l’échange Lepouce de 1768), en 1748. Les élus de la ville se plaignent au conseil d’État que le roi s’est accaparé un ancien droit de péage. Les revenus de la ville sont ainsi passés de 510 livres à 200 livres. Les dépenses ordinaires se montent à 250 livres et « … l’entretien de la glacière qui coûtait 70 livres a dû être [à nouveau, ndla] abandonné... ».
Depuis la Révolution, aucune délibération municipale ne mentionne l’existence de la glacière qui a purement et simplement été abandonnée. Des marchands, particuliers ont pu dès lors, pour leur propre compte, se tourner vers la fabrication et revente de glace…
La glacière municipale n’était pas la seule existant à Vierzon. Trois avérées existent encore aujourd’hui, dispersées sur la commune.
Une au sortir du rio du Verdin et qui a sans cesse été utilisée au moins jusqu’à la première guerre mondiale, composée d'un système électrique moderne de fabrication du froid.
Les deux autres sont attachées à de somptueuses propriétés privées : le château de Fay et le château de la Noue.
Les deux sites ont cet avantage de posséder un étang (bouché dans les années 1970 à la Noue) et qui permettait l’extraction de la glace. Ce sont des glacières créées au 19e siècle, lors de la modernisation des lieux. À Fay ce sont les Mac Nab, propriétaires qui aménagent leur cave. Et à la Noue, c’est Aubertot qui installera une glacière enterrée dans son parc. Recouverte de végétation elle forme une butte et fait le bonheur de tous les petits vierzonnais du centre aéré qui grimpent et dévalent la pente sans se douter de ce qu’elle renferme…
Vierzon aura donné au mouvement ouvrier bon nombre de militants. Parmi ceux-ci, Lucien Deslinières est certainement celui dont le parcours est le plus atypique. Républicain opportuniste, il commencera sa carrière de journaliste en combattant de toutes ses forces le socialisme de Guesde avant de rejoindre ses idées. Il la continuera commissaire du peuple en Union Soviétique avant de finir sa vie dans la peau d’un romancier parisien.
Les premières années de Lucien Deslinières sont les plus intéressantes de sa vie. Né du côté de la rue de la Gaucherie le 7 décembre 1857, son père est conducteur au Paris Orléans pendant que sa mère travaille la couture à façon, dans la maison familiale. Il a la chance d’aller à l’école – chez les Frères – jusqu’à 16 ans. Il embrasse alors la carrière de journaliste en collaborant à un journal républicain gouvernemental dont le siège est à Montluçon: « La Démocratie Bourbonnaise ». Il collabore à d’autres journaux locaux, tous opportunistes et porte haut le combat contre les idées socialistes qui se répandent dans le département de l’Allier. Il s’appuie alors sur l’imprimerie que son frère a créée à Montluçon pour diffuser de véritables brûlots contre Guesde et les socialistes.
Devenu rapidement patron de presse, son influence va jusqu’aux cercles maçonniques du Grand Orient, loge dans laquelle il rentre en 1879. Il transfert l’imprimerie de son frère à Moulins et en profite pour changer le nom de son journal. La Démocratie Bourbonnaise devient « La Démocratie du Centre » et quintuple son tirage, s’imposant jusqu’à Bourges. Organe politique d’influence, c’est également une entreprise rentable, l’invention de la publicité est un succès pour le porte monnaie des frères Deslinières.
Ses premières armes d’orateur, il aura l’occasion de les affûter face à son ennemi d’alors, Jules Guesde. Celui-ci vient dans deux réunions politiques en 1889, une à Montluçon puis l’autre à Commentry, deux bastions ouvriers. Nous sommes alors à un an des législatives et Deslinières est le candidat naturel des Républicains face à Thivrier, celui des socialistes. Il perd face à ce dernier et semble quitter la scène politique.
C’est pour mieux réapparaître, deux ans plus tard, membre du Parti Ouvrier, converti aux idées qu’il combattait depuis plus de dix ans.
C’est encore une fois avec sa plume qu’il fustige ses anciens amis. Mais il ne peut plus compter sur son journal dont les actionnaires l’ont remercié. Il fonde alors « Le Petit Montluçonnais » pour diffuser ses idées socialistes ouvrières. Journaliste alors ruiné, il se lance dans la vente des machines à coudre, entreprise douteuse qui le mènera en correctionnel.
Grillé dans l’Allier, Lucien part en Algérie s’essayer à la viticulture. Renfloué, c’est sur les terres de Guesde, le Nord, qu’il fait son grand retour en politique. Mais, géographiquement, les circonscriptions Pyrénéennes sont plus intéressantes : il peut garder un œil sur ses intérêts algériens. En 1902, il fonde un nouveau journal « Le Socialiste des Pyrénées Orientales ». Membre du parti socialiste SFIO, il tente jusqu’en 1919 de se faire élire dans plusieurs circonscriptions. À chaque fois il échoue sur la dernière marche. Il jette alors l’éponge et revient à ses premières amours : l’écriture.
Depuis 1912 en effet, il devient idéologue de son parti, quelque fois contre ses camarades. Il lutte contre le marxisme, l’opposant au « socialisme reconstructeur ».
Il imagine la société future idéale à l’instar d’un Rousseau ou Fourier. Son phalanstère à lui sera basé au Maroc, sur les terres colonisées récemment. Le personnel nécessaire au développement de cette colonie collective serait assuré par l’État qui avancerait également les moyens financiers nécessaires à la réalisation des infrastructures ferroviaires, routières, agricoles et industrielles. Véritable épine dans le pied du parti socialiste, Jaurès mettra deux ans pour que cette idée disparaisse du programme officiel du parti.
Affaibli jusqu’au sein de sa Fédération du parti des Pyrénées, il s’y maintint leader avec des moyens peu scrupuleux. C’est la goutte qui fait déborder le vase et il est exclu de la direction fédérale au sortir de la Première Guerre Mondiale, le 13 avril 1919.
Toujours persuadé de la justesse de sa société idéale, ce sont les événements de Russie qui vont être à l’origine de sa plus incroyable aventure. Observant la jeune Union Soviétique, il critique le parti bolchévik, parti qui ne sait pas organiser la société. Naïf qu’il est, il pense que Lénine peut adopter son plan. Après plusieurs tentatives, il arrive enfin à rencontrer le leader soviétique. Celui-ci envoie Deslinières en Ukraine, organiser la gestion agricole des terres nouvellement collectivisées mais mal exploitées. Il met sur pied un programme d’exploitation rationnelle des terres mais la guerre civile l’empêcha de mener ses vues à terme.
Lassé, il rentre en France en 1922, persuadé que sa société idéale ne peut pas réussir tant que le calme n’est pas établi en URSS. Mais arrive le temps de Staline et Deslinières comprend que le système soviétique est voué à l’échec.
De retour à Paris il se met à écrire, notamment un curieux ouvrage d’anticipation sociale. Il met en scène sa société idéale, avec héros et héroïne. Aldous Huxley n’est pas très loin…
Roger Delage, chef d’orchestre reconnu est né à Vierzon le 4 décembre 1922. Pour en savoir plus sur les premières années de sa vie, c’est vers son cousin qu’il faut se tourner. Il se souvient de Roger Delage à partir du moment où, cousins, ils sont devenus voisins.
« En 1930, son père avait hérité de l’ « huilerie vierzonnaise ». Elle se situait ruelle du Chevrier et moi j’habitais quelques dizaines de mètres plus loin, dans la rue Maréchal Joffre. C’est comme ça que nous ne nous sommes guère quittés de notre adolescence. Nous allions à l’école du château. Après, lui, a poursuivi sa scolarité jusqu’au brevet au cours complémentaire que donnait l’ENP (lycée Henri Brisson) ».
Quant à la musique, on peut dire qu’il baignait dedans depuis tout petit. Son grand-père et son père, qui avaient travaillé à la Pointerie, étaient membres de l’harmonie des Forges, créée en 1909, en même temps que l’émancipation du quartier.
« Il apprit très tôt le solfège avec Madame Nuret, que des générations de vierzonnais ont bien connue. Le solfège allait de paire avec le violon, instrument auquel Pierre Lapha l’a initié très jeune également. J’étais désolé de l’entendre, raconte son cousin, violoniste également. Déjà à cette époque, on savait qu’il avait un don. Il me fallait travailler des heures pour sortir quelque chose de mon violon. Chez lui, c’était naturel ; et avec un son autrement meilleur que le mien. »
Il joue alors avec les musiciens vierzonnais qu’étaient Albert Collet, Pierre Lapha, Bernard Dumont ou Jeanne Chevalier. « Ils accompagnaient Mademoiselle Garapin au chant dans des séances musicales souvent jouées chez Madame Closset, au parc de Bellevue. Ce sont les années formatrices, celles des quatuors, des sonates et de la musique de chambre. »
Roger a 20 ans en 1942. A cette époque, il prépare le concours d’entrée au Conservatoire National de Paris, dirigé depuis un an par Claude Delvincourt. Ce dernier a l’idée de créer l’orchestre des cadets du conservatoire. Cela a le double avantage de faire échapper les jeunes au STO (c’est le cas pour Roger) tout en gardant les futurs virtuoses à portée de main. Les Allemands ne sont pas dupes longtemps et obligent Delvincourt à s’éclipser en 1944 pour ne rentrer à Paris qu’en 1945.
« Je me souviens aussi de cette époque du conservatoire. On se voyait moins, bien sûr. Mais il a toujours pris soin de parfaire mon éducation musicale. Il me faisait parvenir des ouvrages de la bibliothèque du conservatoire que moi-même je n’aurais jamais connus. Je me souviens particulièrement d’un livre de Saint-Saëns, véritable décorticage de la tétralogie de Wagner. »
Sorti du conservatoire, Roger multiplie les petits boulots. Il est même violoniste remplaçant à l’opéra mais ne trouve pas d’emploi stable. « Il a pensé à rentrer à Vierzon pour prendre la succession de son père à l’huilerie familiale. Mais nous, on savait qu’il n’aurait pas réussi. Il n’était pas fait pour ça. Il n’y avait que la musique qui comptait. »
Jusqu’à ce jour de 1954 où il est recruté par l’Orchestre philarmonique de Strasbourg comme instrumentiste. Il ne quittera dès lors plus jamais cette ville.
L’histoire ne dit pas si c’est à Strasbourg qu’il se prend d’affection pour son compositeur fétiche, Emmanuel Chabrier, mais il publie plusieurs ouvrages sur le personnage. Parallèlement il est professeur d’alto à l’orchestre et fonde en 1959 le Collegium Musicum de Strasbourg, véritable ensemble instrumental de recherche en musicologie. L’ensemble est composé de deux formations bien distinctes, une d’instruments anciens, l’autre de musique de chambre. Il fera le tour du monde avec ses formations, faisant découvrir le plus large panel possible de musiques, Chabrier en tête.
Violoniste, musicologue et Chef d’orchestre reconnu, Roger Delage fera partie de l’aventure Fauré. Fauré n’a jamais donné son Requiem qu’une seule fois, en 1893. Depuis, la partition avait disparu. Il a fallu reconstituer l’œuvre entière à partir des éléments retrouvés. Tâche qui lui a été confiée dans les années 1980 et pour laquelle il sera remercié par le chef Philippe Herreweghe lorsque ce dernier rejouera la partition originelle en 1993, cent ans après son auteur.
Roger Delage repose aujourd’hui au cimetière de Selles sur Cher depuis février 2001. Auteur de nombreux ouvrages sur Chabrier dont une biographie incontournable en 1999, il a montré que, dans ce domaine aussi, il savait manier les mots comme les notes. Aujourd’hui Chabrier c’est Delage, Delage qui a recomposé de nombreux ouvrages fragmentaires du musicien du siècle dernier. Et dont tous les bons disquaires ont les CD…
Il est une version tenace à Vierzon qui veut que le rugby – car c'est bien de cet ovale-là que l'on parle – soit arrivé à Vierzon en même temps que les cheminots. Ceux qui ont participé à la construction de la ligne Vierzon – Tours, dans les années 1868-1870.
Mais le rugby ne se développe à Vierzon qu'au début du siècle suivant. Il faut donc chercher ailleurs. Et le ailleurs, ça se situe du côté de l'avenue Henri Brisson, dans les locaux du lycée. Les étudiants viennent d'un peu partout. Certains connaissent déjà le « football-rugby » dans leur région d'origine : Paris et sa banlieue ou le Sud-Ouest.
Terreau fertile que celui de l'École Nationale : les jeunes s'essayent aux essais, aux placages et aux transformations, certainement en 1904. Il faut dire que leur professeur de sport devient vite un passionné : Jim Agard, qui aura plus tard des fonctions au sein de la fédération.
Dans la foulée des premiers entraînements, l'ENP crée le « Vierz'art club » plus ancienne société rugbystique de Vierzon. Nous sommes en 1905 et le premier match officiel se prépare.
Il sera joué sur terrain extérieur : derrière le Venise, sur la route de Saint Hilaire de Court, sur un pré à vaches prêté pour l'occasion par un certain Monsieur Bouchère. On y plante des poteaux, on trace des lignes.
Pas encore de vestiaires, les jeunes iront se laver dans l'Arnon voisine à l'issue du match.
Ce jour de dimanche 10 décembre 1905, il fallait être courageux pour voir le match : soit y aller à pied, soit en vélo. Pourtant un arrêt du tacot est juste devant le Venise. Pas de chance, le service ne fonctionne pas le dimanche...
Ce jour-là, l'équipe de 3e année (maillot blanc cerclé de noir) rencontre l'équipe de 4e année (maillot noir). Et le score fut de 9 à 0 en faveur de la 3e année, trois essais non transformés. Les héros de la troisième année sont alors les trois aplatisseurs en en-but : Moreau, Chabassier et Ferrand.
Le lendemain, dans la Dépêche du Berry, on parlait plus de ce match de football-rugby que de la loi de Séparation des églises et de l'État promulguée la veille, 9 décembre.
On revient sur le match de la veille, analysant les forces en présence. Il manquait deux avants pour la quatrième année, « la défaite est donc excusable ». D'autant plus que « par suite de l'humidité le terrain était devenu glissant, ce qui gênait beaucoup les joueurs ». Mais le terrain est glissant pour les deux équipes…
Ce que l'article de la Dépêche ne dit pas mais que l'on peut facilement supposer, c'est le retour triomphal des 3e années au lycée. Ils ont sacrément dû chambrer leurs aînés de 4e année.
Dans son ouvrage sur le rugby vierzonnais (1), Fabrice Simoès, journaliste sportif, a bien montré comment la pratique du rugby avait sauté les murs du lycée pour envahir la cité.
Et il semble bien que le point de départ soit ce match du Venise. Il a donné des idées à un homme : le docteur Constant Duval (voir archive du vendredi 22 octobre 2021).
La Dépêche annonce « avec plaisir » dans son édition du 17 décembre, soit une semaine plus tard, « qu'une société sportive « Sporting-club vierzonnais, SCV, » vient de se fonder dans notre cité ».
Pour Fabrice Simoès le sporting est le « premier véritable club de rugby à Vierzon, celui qui possède en son sein tous les gènes de l'excitation ovaline ».
Le Vierzon de 1905 est encore celui de l’expansion industrielle, celle qui permet à des hommes jeunes et célibataires de venir chercher du travail dans les usines locales qui recrutent. C’est là une population qui sera facilement convertie au ballon ovale.
La Dépêche du 17 décembre espère que « les organisateurs voudront bien communiquer leur programme ». En attendant, on apprend que le siège social est établi place de la Croix Blanche.
Le docteur Duval n'est pas un inconnu dans le monde du rugby. C'est un ancien de l'équipe de l'US Tours (lieu de ses études?). Il fait appel à son ancienne équipe pour faire progresser le SCV. Et il y en a besoin : le premier match contre Tours, sur le terrain neutre de Selles sur Cher, sonne comme
une déculottée : 80 à … 0.
Non seulement le moral des vierzonnais n’est pas entamé mais en plus un deuxième club dédié au rugby voit le jour dans la cité : le Stade Vierzonnais qui fait son apprentissage face à la réserve des berruyers de l’USBerry, 3 à 9 pour les berruyers.
Toujours côté SCV, la défaite face à Tours est vite digérée. Et le terrain prêté du Venise sera le témoin des rapides progrès du club.
Dans le premier championnat du Berry 1906 / 1907, Le SCV bat tous ses concurrents : US Saint Florent, l’USB, le Stade Vierzonnais, l’US Issoudun et le CA Orléans.
Pour le premier match de la saison (25 novembre 1906), l’ambiance est tout autre au Venise que pour le premier match inter Vierz’art : Un service du tacot a été mis en place et ce sont plusieurs dizaines de spectateurs qui assistent au match contre les Orléanais, ce qui fait dire à la Dépêche : « Assurément, il y a peu de villes où le sport a fait de si grands pas en un an comme à Vierzon. C’est devant cette foule sympathique que nos vierzonnais ont fait match nul, 2 essais à 2 »...
La suite est l’histoire du réussite fulgurante des jeunes du SCV. Les saisons se suivent et se ressemblent, marquées par le derby Vierzon – Bourges.
Dès 1908 on crée le championnat du Bourbonnais pour lequel Duval va devenir arbitre. Cette même année, il fait l’acquisition d’un terrain,route de Paris qu’il fait aménager pour le SCV. En effet l’aventure du Venise est bel et bien finie, le pré a retrouvé sa vocation agricole...
Paris, 1er novembre 1912. Cela fait maintenant deux ans que le vieil hippodrome de la place Clichy s'est transformé en cinéma. La foule se masse maintenant devant le « Gaumont Palace », temple dédié aux images qui bougent. Le nouveau héros des lieux s'appelle Onésime. Chacune de ses apparitions crée l'émeute. De 1910 à 1922, il sera à l'affiche de soixante quatre films de la série. Sans oublier ses apparitions dans d'autres productions.
Lorsque le rideau se lève ce 1er novembre 1912, les spectateurs vont découvrir Onésime détraquant le temps à grand renfort d'acrobaties dans le Bureau Central des Horloges, afin d'hériter de la fortune de son oncle dans des délais plus… courts.
Hilarité dans la salle, la bonne humeur sur le plateau est percevable sur la pellicule.
Pour Onésime, de son vrai nom Ernest Bourbon, tout a commencé à Vierzon. Il est né en 1886 dans une modeste famille du faubourg des ponts. Son père est porcelainier, sa mère est sans emploi.
Francis Lacassin, chercheur et écrivain a pu reconstituer la carrière de la première vedette du cinéma français, dont la popularité égalait celle de Max Linder.
C'est ainsi que l'on retrouve Ernest Bourbon très tôt à Paris. Il fait plusieurs petits métiers, cordonnier, coupeur de chaussures. Il travaille même à la construction du métro parisien.
Parallèlement il fréquente assidûment une salle de gymnastique qui lui permet de rencontrer les artistes de music-hall et de cirque. C'est ainsi que vers 1906, il devient acrobate pour les Folies Bergères, cabaret voisin.
Le cinéma lui tombe dessus à la même époque. Il sera figurant pour les films comiques de Pathé, basés sur l'acrobatie, les poursuites et les chutes en tous genres.
Aucune exclusivité à l'époque. Il tourne également pour la Gaumont dans des courts métrages dont il ne se souvient même plus des noms. Pour lui, le cinéma est avant tout un travail alimentaire. Appelé sous les drapeaux en 1907, il se déclare acrobate.
Libéré en 1909, ses papiers d'identité le disent artiste.
C'est que pendant ce laps de temps, le cinéma a pris ses lettres de noblesse. D'artisanale, la production est devenue industrielle. De nouveaux réalisateurs émergent parmi lesquels Roméo Bosetti, Louis Feuillade ou Jean Durand. Des héros récurrents apparaissent qui fidélisent le public: Calino, Casimir, et bientôt… Onésime.
Léon Gaumont embauche Jean Durand comme réalisateur en 1910. Il est chargé de pallier le départ de Bosetti (débauché par Pathé). Sa créativité en fera un atout maître de la firme. Il s'adjoint les services d'une bande de joyeux drilles, les Pouittes, comédiens et acrobates. Les Pouittes sont aux années 1910 ce que les Branquignols étaient aux années 1950 ou le Splendid dans les années 1970.
Avec eux, il va atteindre les sommets du cinéma burlesque, celui auquel Mak Sennet rendra hommage, bien des années plus tard.
Les Pouittes passent leurs journées à recevoir des buffets sur la tête. Témoin cette interview de Bourbon: "En ce temps là pour être acteur de cinéma, il ne fallait pas avoir peur de faire un peu d'acrobatie et c'est plus d'une fois que j'ai failli me casser la figure au cours d'une prise de vue. Un jour, dans un film d'aventures, on m'avait distribué un rôle de bandit. Poursuivi par les policiers, je me réfugiais sur le toit d'un wagon attelé à un convoi qui filait un gentil petit soixante. Je me battais avec les détectives et puis, profitant du moment où le train passait sur un pont, je me jetais dans la Marne! Tout avait été minutieusement prévu… Seulement je calculai mal mon coup et mon atterrissage n'eut pas lieu sur la rivière mais sur le chemin de halage! Heureusement, il y a un bon Dieu pour les maladroits et je m'en suis tiré sans même une foulure."
Tous les Pouittes sont successivement vedettes et figurants. Ils sont payés au mois par la Gaumont pour jouer les acrobates dans ses productions, toutes ses productions. Le cinéma de Durand est un cinéma burlesque, un tantinet anarchisant. Son génie est de fidéliser le public en créant des héros récurrents.
C'est ainsi que le premier des "Onésime", sort au printemps 1912, propulsant Ernest Bourbon au firmament des stars, même si personne ne connaît son vrai nom..
"Il faut dire que j'étais devenu vedette presque malgré moi… et que ce titre ne devait pas m'enrichir. Je souris quand je lis dans les journaux que tel grand artiste a pris la décision de ne tourner qu'un film par an! Evidemment, il s'agit de long métrage… Mais tout de même, nous fournissions, nous, un autre travail.
Le personnage d'Onésime, je l'avais créé et façonné au music-hall avant de venir au cinéma. C'était un jeune premier comique, soucieux d'élégance - jaquette, melon clair, guêtres blanches et gants beurre frais - godiche un peu, mais à l'occasion plus malin que tout le monde…
Quant aux histoires, les réalisateurs étaient tous un peu scénaristes. Mais ce ne sont pas les scénaris d'aujourd'hui. A mon époque tout tenait sur une page dactylographiée. On tournait les intérieurs en studio. Nous partions tous en vélo dans la banlieue sans but précis pour les extérieurs."
Onésime fait le bonheur de Gaumont comme il fait le bonheur de Bourbon. Malgré les finances monumentales engouffrées dans ces courts métrages (les marchands de vaisselle et de meubles se frottent les mains), Léon Gaumont propose à Durand un sketch "en direct" le jour de Noël 1913.
Tout de suite Bourbon propose un sketch raccord avec un film. Sur l'écran, une course poursuite s'engage autour du Gaumont Palace entre Onésime et des Pouittes déguisés en policiers. Onésime se réfugie sur le toit du cinéma. Puis c'est Bourbon en personne qui descend en rappel par une lucarne jusque dans la salle, suivi des Pouittes qui tombent du plafond le long de cordes. S'ensuit une bagarre générale dans la salle. Le pompier de service s'en mêle, l'orchestre et le portier aussi. Onésime se défend à grands coups de grosse caisse… jusqu'à la réconciliation finale et sous les acclamations du public.
"Après une telle consécration, rien, absolument rien, ne pouvait contrarier l'irrésistible ascension de Bourbon. Rien sauf une guerre. Elle éclate le 2 août 1914".
C'est là résumé par Francis Lacassin, la cause de l'oubli de Bourbon par son public.
Incorporé à Toul, il en sera de Bourbon comme de tous les Pouittes: Aucun ne retrouvera son travail à la Gaumont, une fois la guerre terminée.
Blessé deux fois, Bourbon est renvoyé dans ses foyers en décembre 1917. Le médecin militaire le considère alors en "très mauvais état général".
Bourbon espère son retour sur le grand écran. Mais Onésime n'a plus la côte. Il faut dire que le cinéma, lui, n'a pas cessé pendant ces quatre ans de guerre. Les comiques français, sous les drapeaux, ont été rapidement remplacés. C'est ainsi que Charlot remplace Onésime, que Keaton remplace Max Linder.
Onésime tentera son grand retour grâce à une nouvelle maison de production la Cimiez films de Nice. Malheureusement, aujourd'hui, seul ce nom est resté dans les mémoires; plus aucune archive, seules deux bandes sur les sept films produits existent. Ces films sont tous réalisés par Bourbon. La Gaumont de Nice accepte de les diffuser.
Mais le public n'est plus là et les critiques n'en pensent pas moins. Les plus indulgents… n'en parlent pas. Les nouveaux esthètes du cinéma, intellectuels pour la plupart n'en peuvent plus de ce "cinéma d'ilotes" (Georges Duhamel). Les joyeuses clowneries des Pouittes restent reléguées à un rang secondaire et dédaignées; le temps est venu du long métrage.
Bourbon part alors aux Etats Unis, invité par le réalisateur Léonce Perret, ancien de la Gaumont. Nouveau départ, nouvel échec. Il apparaîtra dans quelques films, des péplums. Au bout de 18 mois, il tournera définitivement le dos au cinéma.
Il retourne alors à ses premières amours: l'acrobatie. Il mettra au point en 1921 un numéro de mano à mano avec son fils, Bill Bourbon. Ils se produiront jusqu'en 1926. Bill devient trop lourd pour ce numéro et vole de ses propres ailes. Ernest, lui, deviendra alors prof de sport dans une salle de gym de Paris. C'est dans cette ville qu'il s'éteint en 1954, emporté par une longue maladie, à deux pas du Gaumont Palace qui fut le témoin de sa gloire passée.
Aujourd'hui Onésime est tombé dans l'oubli.
De son vivant, rares sont ceux qui ont su son vrai nom: Ernest Bourbon; il n'apparaissait pas sur la pellicule. Il aura été un héros anonyme. Seuls quelques passionnés parmi lesquels Francis Lacassin lui ont consacré leur temps. Il aura arpenté le cinéma des années 1910 et 1920 pendant plus de quarante ans. Et le personnage de Bourbon ne lui aura pas livré tous ses secrets...
Au Moyen-Âge, pas de camion frigorifique. Qu’à cela ne tienne, la viande destinée au ventre de Paris voyagera par ses propres moyens : sur quatre pattes. C’est ainsi que Vierzon devient ville-étape pour les bœufs du Limousin en partance pour la capitale.
Le chemin des bœufs, vaches et veaux passe par l'actuelle place Foch, remonte le long de l'enceinte actuelle rue du docteur Roux pour poursuivre par la route de Paris, actuelle rue Marcel Perrin.
Au passage Vierzon prélève sur cette transhumance les bœufs nécessaires à nourrir sa population estimée à 4000 habitants pour le XVIIe siècle. Les bœufs rentraient alors en ville par la porte du même nom, empruntaient la rue Porte aux bœufs pour aboutir dans la « rue de la boucherie », une rue couverte façon halle sur l'actuelle partie gauche de la place en montant.
Le bœuf gras
Puissante corporation avec celle des boulangers, ces bouchers avaient leur fête : celle du bœuf viollet. Cette dénomination se retrouve exclusivement dans le Centre de la France : Berry, ouest Nivernais, et la première marche du Bourbonnais
Dans les archives vierzonnaises, on retrouve quelquefois les orthographes viollet, ou violet. On peut également croiser le terme de bœuf enguirlandé.
Il s'agit effectivement de la fête du bœuf gras et avait lieu tous les 28 février, à la veille de carême. C’était une fête importante pour tout Vierzon et surtout une des rares occasions annuelles de manger gras pour la population dont le quotidien se composait essentiellement de soupe de légumes et de pain.
Le déroulement du concours était immuable : Les bouchers présentaient leur plus beau bœuf gras à un jury désigné par l’assemblée municipale. Le bœuf vainqueur était ensuite fêté comme il se doit. On l’enguirlandait et une procession s’engageait dans toute la ville, suivie par la foule qui ne voyait sans doute là qu’un très gros steak sur pattes. Autour de la bête, des musiciens jouaient de la viole en son honneur, d’où ce nom qui s’est dénaturé avec le temps de bœuf viollet.
Cette fête fut l’occasion en 1694, d’un conflit entre le maire et le lieutenant général du bailliage. Ce dernier avait pris l'habitude de gérer les affaires de la municipalité en lieu et place des échevins pourtant élus à cet effet. L'office de maire est apparue en 1692 et le premier maire de Vierzon, François Rousseau de Belle Isle tient à faire respecter les attributs de sa fonction. Pour ce faire il n'hésite pas à aller au clash face au bailli (1).
Le maire fait son beurre
Lequel des deux doit cette année-là présider le concours ? « Moi », répondent-ils tous les deux de concert. Devant cet imbroglio protocolaire les bouchers décident de ne pas organiser le concours « tant que la question n’est pas tranchée ».
Ils s’empressent d’ajouter que de toutes façons, « il était d’usage dans la corporation que chacun eût le bœuf viollet à son tour et que c’était cette année au tour de Sylvain Couppé et de Daniel Montpéron. »
Opportunisme, habileté politique ? Toujours est-il que le maire François Rousseau déclare « d’office » les deux bouchers désignés vainqueurs. Le bailli est pris de court, le maire s’installe plus solidement dans sa fonction…
Dans les archives vaticanes, existent plusieurs arrêts des papes concernant l’abbaye de Vierzon. En effet les moines n’hésitaient pas à en appeler au droit canon et à la justice papale pour régler des conflits entre leur abbaye et ses agités voisins. Et son plus agité et proche voisin en cette année 1250 n’est autre que le fougueux seigneur de Vierzon.
En 1248, Guillaume II seigneur de Vierzon part pour la Croisade. Ce n’est pas le premier à faire le voyage. Son père Hervé est mort au siège de Damiette 30 ans plus tôt (voir archive du 24 février dernier). Avant de partir pour Jérusalem, Guillaume confirme les donations de son père à l’abbaye de Vierzon et à l’ermitage de Sainte Magdeleine (dans le bois d’Yèvre). Mais, chose curieuse, il part à Bourges mettre ses mains dans celles de l’abbé de Saint Sulpice, faisant de cet abbé son patronus. Pourquoi Saint Sulpice et pas Saint Pierre de Vierzon ? Renaud, à l’époque abbé de Vierzon, avait-il un différent avec Guillaume ? C’est une possibilité à ne pas écarter au vu des nombreux textes relatant des querelles financières entre les deux hommes, notamment sur des droits que chacun revendique : péages sur le Cher, cens sur certaines maisons de ville...
Guillaume, contrairement à son père, revient vivant de Jérusalem. On ne connaît quasiment rien de la fin de vie de Guillaume à Vierzon. Il semble que son fils Hervé ait rapidement pris la succession. Ce dernier apparaît en 1252 comme donateur d’un droit de passage sur ses terres de Chéry.
Pourtant le retour de Guillaume de la croisade aura une conséquence inattendue sur la vie des moines à cause d’un conflit de prééminence dont le roi de France et le pape vont se mêler.
Rentrant de Croisade, Guillaume a le torse bombé et le menton haut. Il se veut le personnage le plus important de la cité. Comme tout seigneur qui a le droit de rentrer à cheval dans l’église, il veut rentrer le premier dans l’église Notre Dame en ce jour de Pâques 1250.
Mais c’est sans compter sur l’abbé Renaud qui ne l’entend pas de cette oreille. C’est à lui et à lui seul d’entrer le premier dans l’église paroissiale. En effet – et la sentence papale le confirmera – les moines ont le statut d’abbés primitifs de Notre Dame. Lorsque les moines se sont enfuit de Saint Georges sur la Prée en 903, ils ont alors occupé leur nouveau monastère à Vierzon. C’est eux qui ont créé la paroisse Notre Dame et bâti l’église du même nom sur un lieu de culte préexistant. Les moines ont alors dit la messe aux vierzonnais plusieurs fois par jour, pendant près de deux siècles.
Le concile de Célestin III change la donne en 1195. Il est alors interdit aux membres du clergé régulier d’officier à la place du clergé séculier. À partir de cette date, les moines de Vierzon installent donc un membre du clergé séculier comme prêtre rémunéré à l’église Notre Dame.
En 1250, cela fait donc 65 ans que les moines ne font plus la messe quotidiennement à Notre Dame. Ils restent dans leur abbaye, autour de leur église Saint Pierre, comme leur fonction l’impose.
Nul doute alors que que Guillaume ait tenté d’affirmer son autorité au détriment de l’abbé. Le roi de France puis le pape confirment l’ordre de préséance pour entrer dans l’église : Non seulement le seigneur de Vierzon est relégué derrière l’abbé, mais en plus, il est relégué derrière l’ensemble des moines. L’ordre de préséance a même été couché sur le papier. Une copie du 16e siècle est arrivée jusqu’à nous.
Du fait de leur statut d’abbés primitifs de Notre Dame, les moines ont le droit de dire la messe quatre fois par ans à l’ensemble des paroissiens : Pâques, Pentecôte, fête Marie (assomption) et Noël. Pour ces dates, le rituel est précis. Un cortège part de l’abbaye Saint Pierre (mairie) et emprunte la rue des prêtres (rue Galilée) pour atteindre l’église. En tête se trouve l’abbé, crosse en avant. Il est suivi par son prieur et l’ensemble des moines. Arrivent ensuite le seigneur de Vierzon et sa famille. Ils sont suivis des nobles qui souvent ont acquis la noblesse par l’achat d’une fonction. On y trouve le bailli, le garde du sel… Les bourgeois suivent. Quant aux citadins et paysans, déjà sur place sur le parvis, ils n’entreront tous dans l’église que s’il reste de la place (il n’y avait pas de chaises dans les églises à l’époque).
Une nouvelle fois la prééminence de l’abbé au sein de l’église Notre Dame sera remise en question. Mais c’est du fait du prêtre séculier. Depuis 1195, un curé se trouve donc rémunéré à portion congrue par les moines pour dire la messe à Notre Dame. Mais c’est bien-sûr les moines qui encaissent le produit des revenus de l’église : les dîmes, les offices payants, les dons et héritages…
En 1674 le curé séculier réclame aux moines les bénéfices ecclésiastiques liés à sa fonction. Il refuse de rendre aux moines le montant des revenus de l’église.
Les moines intentent un procès contre leur salarié. Le tribunal de bailliage de Vierzon se déclare incompétent. Une fois n’est pas coutume, c’est le roi Louis 14 qui va trancher le différent. Les moines n’ont pas de difficulté pour prouver leur statut d’abbés primitifs de Notre Dame. Il montrent également la sentence de 1250 contre Guillaume de Vierzon. Le roi confirme donc que « ses bons moines » sont propriétaires des revenus du temporel de l’église paroissiale.
Il les incite tout de même à réévaluer la portion congrue de leur prêtre salarié…
Il est quelques fois bien difficile de relater un événement local dans son ensemble tant les sources sont parcellaires.
C’est le cas aujourd’hui alors que l’archive du vendredi s’attelle à retracer l’histoire d’une institution, celle de la Ruche Vierzonnaise.
Il existe très peu de documents sur cette entreprise d’un type nouveau à Vierzon. En faire l’historique devient chose ardue. Tout juste peut-on relater quelques faits marquants qui ont émaillé cette création.
Face à la vie chère, un nouveau type de magasins voit le jour à Vierzon en mars 1893 : le magasin coopératif. Les années 1890 sont des années de crise économique. Les ouvriers qui ont la chance de garder leur travail ne s’enrichissent pas pour autant. Le pouvoir d’achat va sans cesse en diminuant. La réponse des syndicats est la création d’un nouveau genre de magasins affiliés à la fédération des coopératives de consommation. Vierzon avait ses grands magasins : A la ville de Vierzon, la Belle Jardinière. Désormais, elle aura les « Ruches », dont le titre n’est pas sans rappeler que les abeilles sont les ouvriers et ouvrières vierzonnais.
Une institution locale
Dans les statuts de la Ruche, il est précisé qu’il s’agit de « procurer à tous les coopérants, aux meilleures conditions possibles, toutes les denrées de consommation :chauffage, éclairage, habillement, alimentation, etc., que ses ressources lui permettront de tenir à sa disposition. Et de créer toute œuvre de solidarité visant l’émancipation des travailleurs, à l’intérieur de la société comme au dehors, avec le concours d’autres organisations coopératives ». Le siège social se situe dans les locaux du 38 de la rue de la Gaucherie.
Et ce n’est n’importe quelle adresse. Il s’agit tout simplement de l’ancien bâtiment conventuel des moines capucins qui avaient leur couvent à la Croix Blanche depuis le début du 17e siècle.
Le magasin central est situé place Foch, à côté du café de l’Union. Et très vite une dizaine d’épiceries vont pousser dans les 4 Vierzon, puis dans les com0munes attenantes. On compte au total 25 magasins de Reuilly à Romorantin en passant par Salbris et Graçay, dont 12 à Vierzon. La Ruche devient une institution locale, les sociétaires sont légions.
C’est dans ce même esprit de coopération qu’est créée en 1909 la société de coopération ouvrière de constructions d’habitations à bon marché, l’« abri familial », ancêtre de France Loire.
En 1968, en plus des biens de consommation courante, la Ruche s’attaque à la culture et ouvre une librairie coopérative en bas de la rue Galilée. Elle est inaugurée en grande pompe par Léo Mérigot, maire depuis 1959..
Cette même année la ville va reloger les entrepôts de la Ruche. C’en est fini du 38 rue de la Gaucherie, place à un entrepôt tout neuf, dans la zone industrielle des Forges. Et les anciens locaux seront détruits, remplacés par l’actuelle résidence de la Gaucherie.
Pourtant en 1970, rien ne va plus. Le bulletin de l’association tire la sonnette d’alarme : les sociétaires sont moins nombreux ; le chiffre d’affaire est en baisse ; les habitudes de consommation ont changé. La concurrence « d’un nouveau type de magasins » va obliger la Ruche à entrer au sein de la Coopérative de Saintes en 1971. Les épiceries « Ruche Vierzonnaise » deviennent « COOP ». La Ruche est vide, les abeilles sont envolées. Quant à la première grande surface vierzonnaise, Rond-Point-Coop, c’est en 1973 qu’elle ouvre ses portes, route de Neuvy. Les timbres à coller, eux, ont été remplacés par des cartes de fidélité….
Cette semaine et la semaine prochaine, l’archive du vendredi revient sur les deux mois qui ont précédée l’arrivée des Allemands à Vierzon en 1940.
Ces deux mois de mai et juin 1940 retentissent comme le point d’orgue de ce conflit qui n’est plus une drôle de guerre. Les événements se sont accélérés depuis le 2 septembre 1939. Vierzon accueille des réfugiés dès septembre, perd son maire en octobre et se retrouve noyée le 5 mai. À cela va s’ajouter le flot des réfugiés et des soldats en déroute dont la seconde ville du Cher est le passage obligé.
Mais avant le flot des réfugiés, le mois de mai débute par le flot des eaux.
4 mai, 12heures : la mairie reçoit une dépêche préfectorale annonçant une crue pour le 6 mai à 2 heures du matin. On envoie une voiture crier la nouvelle dans les rues des quartiers inondables. Mais c’est avec 10 heures d’avance que l’étiage atteint son maximum : 4,70 mètres. La côte de la crue du siècle de 1910 de 4 mètres est loin derrière. Le Cher, L’Yèvre et le Canal de Berry ne font plus qu’un. Il y a 60 centimètres dans les rues avoisinantes, au Chambon comme à Bourgneuf. En ville la Banque de France a les pieds dans l’eau. Le monument aux morts baigne également. L’usine élévatoire des eaux (île Saint Esprit) est endommagée.
Il y a attroupement sur les ponts pour voir passer les flots mais aussi le bétail des fermes submergées. Le vacher du Verdeau passera deux jours dans un arbre, pris alors qu’il tentait de sauver ses bêtes.
Les autorités départementales et locales sont toutes présentes, du préfet au colonel de gendarmerie. Il faut organiser les secours d’urgence. Les dégâts sont considérables. Dès le 6 mai, la mairie annonce 20 millions de dégâts, à la fois pour la voirie et l’ensemble des propriétés communales. Les rues sont ravinées, des excavations sont formées qu’il faudra reboucher.
Les usines aussi sont touchées. Aux Forges le travail de production se transforme en travail de pompage pour les ouvriers. Pendant 5 jours on compte 60 centimètres d’eau route de Foëcy.
L’urgence est l’évacuation et le ravitaillement des sinistrés. Les secours traversent la ville en barque, proposant ravitaillement et service. À noter qu’une équipe du club nautique s’est portée volontaire pour ce travail. Ils passeront trois jours dans les rues de Vierzon. L’eau des puits est devenue imbuvable ; les maisons malsaines. L’armée va mettre des fontaines provisoires à la disposition des habitants dans différents quartiers de la ville à la Genette, à l’Abricot, aux Forges. La mairie fera distribuer gratuitement de la chaux pour assainir les maisons. Certains ont tout perdu : maison, mobilier, voiture, jardin. Les murs de clôture ne sont plus qu’un souvenir. Une maison s’est écroulée au Chambon, une autre a perdu son pignon à Bourgneuf.
Au matin du 6 mai, une section du 6e régiment du génie d’Angers débarque à Vierzon. Ils vont pomper pendant trois jours et trois nuits sans discontinuer. Ils vont protéger les fours et les installations électriques de la verrerie, pomper autour de l’usine élévatoire des eaux. Mais surtout, ils vont reconstruire la voie ferrée, aux Forges. Le ballast a disparu, les rails ont plié. Le pont du chemin de fer de Chaillot menace ruine. Les militaires vont rester plusieurs jours à Vierzon. Une noria de trains va déposer 13 000 tonnes de ballast pour reconstruire la voie. Le 6e génie va de plus s’occuper à consolider la première pilastre au pont sud du Cher (à côté de l’actuel café « Bergerac ») qui donne des signes de faiblesse. Cette même arche qu’ils feront exploser 6 semaines plus tard, à l’approche des troupes allemandes…
Mais c’est une toute autre polémique qui débute. Qui a fait sauter les barrages sur le Cher ?
Parce que c’est la rumeur qui enfle : la cinquième colonne allemande prépare l’arrivée des troupes de la Wermarcht en multipliant les sabotages.
Mais là, les autorités, relayées par la presse locale, clament l’événement climatique naturel ; de fait aucun barrage n’a sauté, pas de 5e colonne en vue. Ce sont bien les pluies torrentielles de Montluçon le 4 qui sont à l’origine de cette crue à Vierzon. Le Cher grossissant, les eaux de l’Yèvre ne se sont plus écoulées, entraînant cette crue du siècle. Les eaux avaient notamment fait tomber le pont du Cher à Montluçon et celui d’Epineuil le Fleuriel, entraînant le rapide Aurillac – Paris dans son sillage. Les secours relèveront 21 morts de cette catastrophe ferroviaire…
Au premier coup de pelle (celle d’un backhoe de la CASE voisine), la pointerie est éventrée, laissant dégueuler deux cents ans d’histoire ouvrière sur le site.
C’était le 17 novembre 1978 et les anciens de la pointerie regardaient, impuissants, les mâchoires manger leur outil de travail.
L’histoire avait pourtant bien commencé, elle augurait un riche développement industriel pour Vierzon. Nous sommes en 1776. Le futur Charles 10 devient apanagiste du domaine. Pour rentabiliser ses forêts de sa maîtrise de Vierzon, il lui est proposé l’ouverture d’une forge. Signés Belanger, les plans sont acceptés par le Comte d’Artois et la forge se construit. Les premiers ouvriers de la forge primitive sont les paysans des environs qui, les travaux des champs terminés, vont à l’usine chercher un complément de revenu.
Cette main d’œuvre instable n’est pas pour plaire au maître de forge, qui se voit contraint de bâtir des logements ouvriers, dans l’enceinte des murs tout d’abord. Cela doit permettre de fidéliser la main-d’œuvre, certes mais aussi de contrôler plus facilement cette jeunesse ouvrière qui a tendance à s’éparpiller.
C’est sous l’Empire que les constructions nouvelles vont déborder des murs primitifs, les maisons ouvrières vont s’agglomérer autour de l’usine et ainsi former un premier noyau urbain qui deviendra à terme une commune libre.
L’arrivée de la forge anglaise (à grand rendement) en 1839 et, 10 ans auparavant, l’ouverture du canal de Berry attirent de nouvelles usines au bord de la gare d’eau.
Quant au travail de la forge, la fonte sortie est de mauvaise qualité, essentiellement tournée vers la production agricole, socs de charrues, outils de tous ordres.
1792, bruits de bottes en Europe. Les monarchies européennes prennent peur d’une possible contagion révolutionnaire. La France déclare donc la guerre à l’Europe. La fonderie de La Charité fondra les cloches des églises (dont celles de Notre-Dame et de Saint-Pierre). La forge de Vierzon se tournera alors vers la production de balles et de lingots de fer qui seront transformés en fusils et canons dans l’arsenal de Bourges, pour les soldats conscrits tirés au sort.
C’est dans ce contexte que la forge connaîtra sa première grève moderne : les conditions de travail sont évoquées, les salaires aussi. L’usine est occupée. Réprimée, cette grève n’en restera pas moins un événement qui participera à la légende de Vierzon la rouge.
Sous l’Empire, l’usine est mal gérée, les propriétaires et les maîtres de forge se succèdent. Peu à peu les clients naturels de la forge se détournent de ce fournisseur. C’est le cas, par exemple, de Célestin Gérard, qui installe une fonderie au sein de son atelier dès 1848.
L’usine sera transformée en fabrique de pointes, clous et fil de fer en 1864, après son rachat par les Forges de Châtillon Commentry. C’est le début de « la pointerie », la grande usine à l’Est de Vierzon, qui fait le pendant de la Société Française. Les deux sirènes qui appellent les ouvriers au labeur se chevauchent. Tout Vierzon retentit de ces cloches prolétaires.
Monsieur Londeix, le dernier directeur, annonce, le 14 juin 1978, la fermeture du site pour la fin de l’année. Soixante quinze licenciements annoncés sur les cent trois ouvriers restants. Les vingt derniers seront chargés de démanteler leur outil de travail pour envoyer les machines à la maison mère, Châtillon. Jacques Després, fait partie de ceux-là.
Son père y aura travaillé plus de quarante ans, lui-même plus de trente. Le « Pé Jacques » comme on l’appelle a écrit ces paroles pour rendre hommage aux anciens de la pointerie :
A la r’voyure !
« J’veins t’die adieu ma vieuill’ point’rie
Tout m’sembel’ gris à l’horizon
Quanqu’on y laiss’ trente ans d’sa vie
On a ben l’drouet d’fé l’oraison.
Atfié là depis ben des lust’es
T’as rensarré dans tes vieux murs
Nos p’pas, nos m’mans, des houm’s illust’es
Des besogneux des foués des durs.
Des événements tragiques vont avoir lieu à Vierzon jusqu'à la toute fin de l'occupation allemande, le 4 septembre 1944. Le 16 août, ce sont quatre vierzonnais qui seront emmenés comme otages et dont on a jamais eu la moindre explication quant aux circonstances de leur disparition.
En ce mois d'août, il reste environ cent à cent cinquante soldats allemands stationnés à Vierzon toutes unités confondues, essentiellement des feldgendarmes contrôlant le chemin de fer.
Cette soirée du 15 août, deux soldats allemands âgés, cantonnés au château des Forges, viennent s'installer au café de l'église voisin. Deux maquisards les font prisonniers dans le double but de récupérer leurs armes et de leur faire faire « la popote » du maquis.
Ne les voyant pas revenir, un soldat est envoyé à leur recherche et passe par le café de l'église où la propriétaire madame veuve Rolland admet le passage des deux soldats.
Le lendemain matin 16 août à 9h00, les gestapo de Vierzon et Bourges encerclent le café de l'église. Tout le quartier est bouclé. Toutes les personnes, hommes, femmes et enfants sont parqués dans la cour, devant l'église des Forges, avec ordre de mettre les mains sur la tête et de ne pas bouger. Une mitrailleuse est placée à l'entrée de la place, dirigée vers le groupe qui grossit au fur et à mesure que la matinée passe. Ainsi à midi les ouvriers des usines voisines viennent grossir les rangs des otages.
La gestapo finit par obtenir un renseignement important : les maquisards qui ont procédé à l'enlèvement des soldats allemands auraient été vus au « café du chalet » voisin, préfabriqué au bord du canal de Berry, près du « pont jaune ».
Voulant retarder l'arrivée des allemands le 20 juin 1940, les troupes du génie avaient fait sauter ce pont, le souffle détruisant le café du chalet par la même occasion. À son emplacement, se dressait, depuis cette date, un préfabriqué permettant aux époux Caillat de poursuivre leur activité de débitant de boissons.
Dans ce café, les allemands surprennent le maquisard Charles Hémel, chauffeur pour les FFI, en compagnie de Girardot, sous-lieutenant FFI du groupe Vengeance et un troisième maquisard dont l'identité n'a jamais été totalement assurée.
Avant que les feldgendarmes aient pu procéder au contrôle des identités, Hémel sort son arme et tue un feldgendarme. Les trois maquisard s'enfuient en plongeant dans l'Yèvre. Hémel est abattu sur place. Son corps se balancera toute la journée aux branches d'un arbre. Ce ne sera que tardivement le soir qu'il sera sorti de l'eau par des voisins. Girardot réussit à se cacher dans les roseaux qui poussaient en abondance sur les rives du canal. Quant au troisième homme il a réussi à s'enfuir en passant sous le pont jaune rafistolé.
À l'intérieur du café, les autres consommateurs sont également raflés, envoyés dans la cour de l'église. Parmi eux se trouvait Madame Caillat, propriétaire des lieux. Elle n'a aucun papier sur elle et veut récupérer son sac à main dans son café. Cela implique de faire demi-tour et elle n'ose pas.
C'est un alsacien, interprète au sein de l'usine de la Vence (Timken Nadella) qui demande pour elle si elle peut retourner chercher son sac à main. Il lui est répondu que oui. À peine ressortie de son établissement, elle est alors interpellée et mise en état d'arrestation, du simple fait qu'elle est propriétaire du café où Hémel a tué un feldgendarme.
Les troupes allemandes vont alors détruire son baraquement provisoire à coups de grenades. Après contrôle d'identité, tous les otages retenus place de l'église sont libérés. Néanmoins, quatre personnes ont été désignées otages et arrêtées. Outre madame Alice Caillat (38 ans), propriétaire du café du chalet, il s'agit de Madame Marie-Louise Rolland (51 ans), mère du propriétaire du café de l'église (qui lui a eu le temps de s'échapper) ; Madame Madeleine Chantelat (24 ans), serveuse au café de l'église ; Monsieur Camille Lurat (23 ans), chauffeur du bus de la Vence.
Tous les quatre ont été vus monter dans une voiture et prendre la direction de Bourges par l'actuelle nationale 76. Depuis, plus rien...
Des recherches post reddition allemande ont été entreprises. Les archives du Cher ont été consultées. Aucune trace de ces quatre vierzonnais n'a été retrouvée. Ils n'ont pas été emmenés au Bordiot de Bourges. Quant à la gestapo de Bourges, il n'y a plus trace.
Dans les années 1966 on a même fait fouiller le jardin de l'ancienne Kommandantur de la rue Jules-Louis Breton où on pensait que leurs corps avaient pu être ensevelis. Les archives de Blois et de Metz ont également été consultées suite à des informations qui se sont avérées inexactes. Les archives de Grenoble enfin ont également été consultées dans les années 1999 – 2000. En effet quatre corps fusillés avaient été retrouvés dans un bois. Mais là encore ce n'était pas une bonne piste.
Aujourd'hui il ne reste que peu d'espoir de retrouver la trace de nos quatre concitoyens. Il est plausible que les allemands, en partance vers le nord-est de la France se soient débarrassé de leurs otages en chemin. Aujourd'hui leur mémoire reste vivante ; depuis 1947 les municipalités successives perpétuent leur souvenir lors d'une cérémonie annuelle…
Vierzon, dans l'après-midi du 5 septembre 1944. Léo Mérigot, chirurgien, monte les marches de la mairie pour accéder à la grande salle des mariages. Dans quelques instants, le capitaine Stag, chef régional des FFI va officiellement lui remettre le pouvoir communal.
Le futur maire de Vierzon est un homme que les vierzonnais connaissent depuis 1934. C'est l'année de son arrivée à Vierzon, comme assistant chirurgien du docteur Jacoulet à l'hôpital. Il était né en 1902 à Poulaines dans l'Indre. Après ses études de médecine à Paris, ce premier poste vierzonnais lui permettait ainsi de se rapprocher de ses racines berrichonnes.
Entré très tôt en Résistance, il est officiellement chargé du service de santé des maquis communistes comme gaullistes de la région. Soupçonné par les autorités allemandes, il est arrêté par la Gestapo en octobre 1943 et emprisonné au Bordiot à Bourges. Là, il rencontre le frère Alfred Stanke, le « franciscain de Bourges » avec qui la famille Mérigot continuera d'entretenir de bonnes relations après guerre.
Léo Mérigot échappera de peu à la déportation grâce à la mobilisation du personnel médical. Un chirurgien de Bourges refusait en effet d'opérer un colonel allemand mourant si Léo n'était pas immédiatement libéré.
C'est le gouvernement provisoire d'Alger qui propulse mai 1944 Léo Mérigot Président du Comité Local de Libération, faisant de lui le futur maire provisoire de Vierzon, dans l'attente d'élections libres.
En ce jour du 5 septembre 1944, une fois que Stag lui ait officiellement remis le pouvoir, Mérigot donnera une allocution qu'une foule immense pourra entendre en dehors des murs. La place devant la mairie avait été sonorisée, des hauts parleurs pendaient des fenêtres.
Le Berry Républicain, journal né de l'ancienne Dépêche du Berry, a retranscrit in-extenso son bref discours :
« Vierzon libéré remercie aujourd'hui ses libérateurs, les Forces Françaises de l'Intérieur, les vaillantes armées alliées, et tous ceux qui ont participé à la Résistance.
Désigné par le Gouvernement Provisoire de la République française pour administrer la cité, le Comité de Libération comprendra, avec d'anciens conseillers municipaux élus, des personnalités de notre ville dont le patriotisme est connu de tous et quelques uns des membres les plus actifs de la résistance vierzonnaise. Dans un prochain meeting, les représentants de nos différents mouvements de la résistance vous exposeront librement leur point de vue.
En attendant que la population de Vierzon puisse elle-même exprimer son opinion dans de prochaines élections, il est sûr de représenter les sentiments de cette population qui n'a pas cessé pendant quatre années d'occupation allemande de donner l'exemple de la dignité et du courage.
Nous avons l'intention d'assurer la continuité du fonctionnement municipal, d'apporter des solutions rapides aux difficultés nées des circonstances de guerre et d'entreprendre un programme de reconstructions de notre cité pour lui donner dans l'avenir le développement auquel elle a droit. Nous exigerons le châtiment des traîtres et des trafiquants.
Nous saluons en cette minute solennelle nos morts, nos martyrs, et toutes les victimes de la guerre et de la barbarie nazie. Nous saluons nos prisonniers et nos déportés, qui dans leurs camps ont aussi organisé la résistance. Leur sacrifice n'aura pas été inutile si nous puisons chaque jour dans leur exemple la force de travailler de toute notre âme à la résurrection de la France.
Vive la République !
Vive la France ! »
Mérigot l'humaniste avait une sainte horreur de la justice expéditive. À plusieurs reprises il a rappelé que le retour de l'ordre républicain passait par une justice indépendante.
Cela n'empêchera pas l'exécution de cinq vierzonnaises et vierzonnais dans les heures qui suivront la Libération, notamment Chevalier, directeur de la Société Française (pourtant prévenu de menaces contre sa personne par Mérigot lui-même).
Président du comité de Libération, Mérigot organise les élections municipales de mai 1945. Et c'est Georges Rousseau, premier maire du Grand Vierzon comme on l'appelait en 1937 qui est réélu. Ce dernier , déporté politique depuis juillet 1942 est un survivant d'Auschwicz. En attendant son retour, Mérigot assure l'intérim. Georges Rousseau ne rentre que fin mai 1945. Et retrouve son fauteuil de maire lors du conseil municipal de juin 1945…
Si l’ère industrielle de Vierzon a commencé en 1777, lorsque le Comte d’Artois, futur CharlesX installe une forge dans un quartier qui dorénavant portera ce nom, c’est bien l’aventure du machinisme agricole qui a donné à Vierzon une des plus belles pages de sa renommée nationale.
Le pionnier
La tradition industrielle est donc depuis longtemps ancrée à Vierzon lorsqu’un homme, Célestin Gérard, compagnon menuisier, effectue son tour de France et s’y arrête. Sa première batteuse, qu’il avait créée pour son père est remarquée par un riche propriétaire des environs. Très vite le bouche à oreille lui assure une clientèle locale importante qu’il n’hésite pas à démarcher à domicile. Le 15 octobre 1848 il ouvre, face à la gare, un atelier de réparations pour ses matériels. Il se transformera bientôt en un véritable atelier de production en série. Génial inventeur, Célestin Gérard est à l’origine de la première batteuse mobile de France. Mais surtout, il révolutionne l’utilisation de la force motrice en créant, en 1861, la première locomobile qui remplacera dorénavant le manège à chevaux. Grâce à ses inventions (25 brevets, plus de 300 médailles d’or et d’argent), Napoléon III en personne le fait Chevalier de la Légion d’honneur le 05 janvier 1868. Son petit atelier est devenu grand au fil des ans. De 1848 à 1879, ce sont 500 ouvriers qui ont produit plus de 2500 locomobiles et 3500 batteuses.
Sept hectares au service du « Vierzon »
Quand Gérard, diminué, revend ses ateliers en 1879, ce sont 7000 m² face à la gare qui constituent le patrimoine foncier initial de la Société Française de Matériel Agricole dirigée par Lucien Arbel. Très vite le succès rend les locaux étroits et il faut penser à s’agrandir. C’est d’abord le parc de Bel Air, dépendance de la manufacture de porcelaine voisine qui est racheté. Les nouveaux ateliers qui vont être montés sur un modèle Eiffel (poutrelles métalliques), porteront des noms évocateurs pour l’époque : atelier du Nouveau Tonkin, atelier du Canal… Au total ce sont sept hectares en forte dénivellation depuis la gare jusqu’au Canal de Berry qui seront dévolus à la gloire du « Vierzon ». La diversification est le mot d’ordre en ce début de XXème siècle. De nouveaux matériels émergent : bancs de scies, presses à paille, pompes à eau et surtout les tracteurs, à partir de 1934. Des tracteurs dont le bruit caractéristique des générations de 401, 551, 302 ou encore 201 résonne encore aux oreilles de ceux qui les ont utilisés… Vierzon c’est alors 70% de la production de machines agricoles françaises.
La crise
Les aléas économiques des années 1920 et 1930 ainsi que la deuxième guerre mondiale ouvrent une ère de crise au sein de l’entreprise. La concurrence des Mack-Cormick et autres Fergusson due au plan Marshall devient insupportable pour l’usine locale. Le dernier soubresaut de l’aventure s’achèvera aux Etats Unis avec le rachat de l’usine par le géant américain Case. C’est en 1958 que le géant des travaux publics rachète l’antique Société Française. Case élimine ainsi un concurrent et permet son implantation sur le sol européen. Continuant quelque temps la production de tracteurs agricoles, c’est très vite la catastrophe pour l’usine dont le dernier modèle sorti ne fonctionne pas. On est obligé de rappeler les cinq cents exemplaires déjà vendus. L’expérience a assez duré et l’administration américaine fait de Vierzon un simple site d’assemblage pour les backhoes américains. La séculaire tradition agricole est bel et bien finie à l’aube des années 1970. Les quelques 1000 ouvriers perpétueront encore une vingtaine d’années le souvenir d’une forte activité industrieuse sur ce site. Ils ne seront plus que 270 lorsque la direction annonce la cessation totale d’activité en 1995. Le mot fin est alors apposé sur plus de cent années de machinisme agricole à Vierzon…
L’archive du vendredi reviendra dans le détail sur différents points de l’histoire de cette usine emblématique de la ville…
On l'a longtemps cru bâti en 1458, selon l’historien local Toulgoët. Mais les archives municipales de l'époque ont disparu et il faut quelques fois compter sur le hasard pour reconstituer une histoire.
Récemment, l'achat d'un fonds d'archives de la seigneurie de Grossous (site de l’ancienne auberge de jeunesse) a permis de proposer une date antérieure pour sa construction.
Le premier texte de ce fonds date de 1399, soixante ans avant la date jusqu’ici admise, et relate une location par Perro Gallicher de « quatre écluses sur la rivière d'Yèvre, paroisse de Vierzon ». Ces quatre écluses jouxtent à l'Est la « domum dei » de la paroisse.
L’emplacement de cette « maison Dieu » nous est bien connu : en lieu et place de l’actuelle école Charot, et n’en a pas bougé jusqu’en 1868, date officielle de sa désaffection.
Cette institution charitable est née avec la christianisation de l’Europe aux VI et VIIe siècles, mais s’est surtout développée avec les croisades, fin XIIe siècle. De tels établissements ont vu le jour pour accompagner les pèlerins jusqu’en Terre Sainte. Les ordres hospitaliers se sont multipliés pour les administrer et ont rapporté ce modèle en Europe et en France.
Souvent, c’est la volonté d’un seigneur que de voir ouvrir une maison-dieu. Il s’agit de parquer « hors les murs de la ville » tous les indésirables : mendigots, pauvres, malades, enfants trouvés, pèlerins, nécessiteux de tous poils. La fonction soignante de l’hôpital n’arrivera qu’au XVIIe siècle.
La fondation de notre hôtel-dieu vierzonnais est tout de même brièvement relatée dans une archive fin XVIIe siècle (date exacte inconnue) : « l’hôtel-Dieu de la ville de Vierzon a été fondé par les habitants de ladite ville. Ce sont les maire et échevins qui en sont les administrateurs depuis son établissement. Les pauvres sont soignés par les dames hospitalières que les habitants furent chercher à Loches, après avoir obtenu la permission de messieurs les archevêques de Bourges et de Tours ». Mais ce qui semble vrai pour le XVIIe siècle ne l’était certainement pas à l’origine. Si l’on croit ces phrases, alors, le maire a toujours été administrateur de l’hôpital.
Mais cet écrit a été rédigé à une époque bien précise : l’apparition de la fonction de maire, 1692. Antérieurement, c’était le lieutenant de bailliage (tribunal royal) qui assumait la plus haute fonction municipale. Avec l’arrivée de ce nouvel acteur (voir archive du vendredi 6/11/2020 : François Rousseau de Belle Ile), les conflits sont incessants entre les deux personnages. L’administration de l’hôtel-dieu en fait partie.
Quoi qu’il en est, ce sont bien les sœurs hospitalières qui ont donné les soins aux malades et estropiés ; la gestion financière étant entre les mains des laïcs. L’hôtel-dieu a été doté de terres et de rentes pour permettre son bon fonctionnement. Toutes les archives en notre possession montrent que l’équilibre est précaire. Les dames hospitalières sont très souvent amenées à faire appel à la générosité des bourgeois de Vierzon.
Une quittance de 1551 montre l’étendue des possessions de l’hôpital : « la chapelle et jardin… chaussée des ponts ; une pièce de terre aux buttes (tunnel-château), une à la Chantelou, deux à Méry, le pré Michau, un pré en l’île de Berry (sablette sur l’Yèvre), un autre à Lury, des arpents de vigne au clos Chabot… ainsi que diverses rentes dont trois muids de blé seigle… de l’abbaye de Vierzon ». Précisons que ce sont là les biens propres à l’hôtel-dieu. Les sœurs hospitalières ont elles aussi leurs biens et rentes qui leur permettent de vivre et de soigner les malades. Il s’agit essentiellement d’un vaste terrain autour de l’hôpital, appelé enclos des religieuses et sur lequel l’administration communale pré-révolutionnaire tentera de faire main basse.
L’ensemble des biens doit servir « pour l’entretenment dusdit hospital pour la nourriture et allyments des pauvres qui surviennent chaque jour, lesquels faut nourrir, coucher, héberger, soient pauvres estrangers que de la ville et enfans trouvéz., lesquels pauvres et enfans sont en tel et si grand nombre, que le revenu d’icelui avecque autres charges et réparacions qu’il faut accomplir, de manière qu’il faut faire collecte et queste ès paroisse pour subvenir auxdites charges, à cause que le revenu et chouses dessus déclarés sont de peu de valeur, en sorte que ledit administrateur n’y peut satisfaire ».
L’administration de l’hôpital est une fonction tirée au sort parmi les bourgeois de Vierzon convoqués par les échevins à cette fin. La tâche doit être difficile si l’on en croit les défaillances multiples : Refus de la fonction, comptes non rendus…
Dans leur quotidien, les pauvres ont surtout à faire au « gardien de l’hôpital, varlet des pauvres ». En 1625 Gervais Rossignol est gagé à 16 sous par mois, deux boisseaux de seigle par semaine et deux sous par fosse creusée. Fonction non élective mais qui demande de l’autorité. A charge pour lui de fournir la paille et le pain aux pauvres. Son successeur, en 1633, en appellera aux échevins parce qu’il est fréquemment pris à partie parce que l’hospice ne comporte pas de lit, pas de couvertures, seule de la paille est étendue par terre.
Autre personnel, un vicaire de Notre Dame (rétribué à cet effet) est chargé d’apporter les sacrements au sein de l’institution. Enfin, apparu au XVIIIe siècle, l’hôpital s’adjoint les services d’un chirurgien. Ses gages sont de 100 livres par an en 1782. Mais ces cent livres représentent la moitié du budget total. La ville s’empresse donc d’accepter la proposition du philanthrope chirurgien Villantroys de visiter gratuitement les malades.
Au cours des siècles, l’hospice va évoluer, grâce aux diverses donations et rentes octroyées.
Dès le 15e siècle, les maladreries et les biens attachés de Chatres sur Cher, Nohant en Graçay et La Ferté Imbault sont accolées à l’hospice ; sans parler de la maladrerie de Saint Lazare de Vierzon (rue Charles Hurvoy). Vers 1600, veuve Marguerite Garnier lègue tous ses biens à l’hôpital. Il s’agit de deux maisons dans Vierzon et d’une somme de 100 livres. C’est également à cette époque que le moulin de l’Abajou devient propriété de l’hospice (pile sud de l’actuel pont Volaire). Il sera démoli pendant la Révolution, à la demande expresse des fermiers des grands moulins et de celui des moulins de l’abbaye. La municipalité va également octroyer des rentes complémentaires à son hôpital. Citons juste un exemple ; le droit de viande pendant carême. La viande vendue par les bouchers pendant la période de carême était toute entière vendue au profit des pauvres.
Lorsque la Révolution arrive, l’hôtel-dieu n’est plus que l’ombre de lui-même. Il n’y a plus que deux sœurs qui prodiguent des soins, puis une seule…
Un des derniers soubresauts de l’histoire hospitalière au faubourg des ponts sera l’épidémie de choléra de 1832. Un homme est alors maire de Vierzon Ville : François Beaucheton. Alors que le préfet lui fait remarquer que son hôpital n’est pas en mesure de faire face à l’épidémie et même qu’il menace ruine, Beaucheton répond que ce sont là des mensonges destinés à le mettre dans l’embarras…
Mais décidément, il devient urgent d’agir. Ce que ses successeurs feront… dans les années 1860…
La semaine dernière, L’archive du vendredi a conté les quelques cinq cents ans de la présence de l’hôtel-dieu sur la chaussée des ponts. Aujourd’hui elle vous propose de revenir sur l’histoire de notre hôpital tel qu’il se situe dans le quartier de Saint Martin.
Les années 1800 auront été pour le vieil hôtel-dieu le siècle d’une lente décrépitude. A tel point que le préfet s’alarme en 1832 que l’établissement n’est pas en mesure de faire face à l’épidémie de choléra qui fait rage à Vierzon. Le maire Beaucheton prend ombrage des remarques préfectorales et récuse ces « fausses affirmations ».
De ce fait, aucune réflexion municipale n’est menée quant aux réparations à faire au vieil hospice ou même son remplacement…
Mais les habitants de Vierzon Ville ne sont pas les seuls à bénéficier des soins des sœurs de la charité à l’hôtel-dieu. Les habitants de Vierzon Villages y ont également des droits. Pour essayer de faire changer d’avis Beaucheton, la municipalité de Villages est plus active dans la recherche de solutions. Paul Teurier maire de Vierzon Villages, manipulé par le maître de forge Aubertot, part à la recherche d’un terrain pour y bâtir un hospice moderne. Et justement des terrains libres, il y en a ! (ceux appartenant à Aubertot). Mais rien n’y fait, Beaucheton campe sur ses positions…
Entre-temps, un homme décède à Vierzon, sans descendance : Claude René Gourdon de Givry, chargé de la maîtrise des eaux et forêts. En mai 1831, à l’ouverture de son testament, la ville de Vierzon est faite légataire universel de ses biens, notamment une propriété qui porte le nom de Saint Martin, sur la route de Tours.
On l’aura compris : l’idée de transformer cette vaste propriété en lieu d’accueil d’un futur hôpital n’est donc pas encore dans l’esprit du maire ; dans un premier temps elle est louée à Hache et Pépin Le Halleur, patrons porcelainiers à Bel Air (face à la gare aujourd’hui).
L’idée d’ériger un hôpital sur la propriété de Saint Martin voit le jour en 1845, alors que le vieil hôtel-dieu menace ruine et qu’il prend l’eau de toutes parts. Mais il faudra attendre le municipat de Pierre Guenivet patron verrier de son état, pour que les choses se concrétisent. Les travaux ne commenceront qu’en 1868 pour s’achever deux ans plus tard.
C’est tout naturellement que les sœurs de la charité font elles aussi le déplacement de la chaussée des ponts jusqu’à Saint Martin. Originaires de Montoire sur le Loir, elles avaient été envoyées à l’hôtel-dieu de Vierzon en 1785, en remplacement des sœurs hospitalières d’origine. La Révolution leur avait fait quitter l’habit religieux, habit qu’elles retrouvaient lors du Concordat de 1801. Elles auront connu trois guerres, passé à soigner les blessés. Lorsque la rumeur les dit sur le départ en 1969, Léo Mérigot contacte l’archevêché pour les faire rester à l’hôpital. Malgré cela les rangs s’amenuisent et elles quitteront définitivement l’hôpital vierzonnais en 1882.
Mais entre-temps l’hôpital se modernise. On construit la salle de chirurgie en 1877. C’est alors un vaste établissement qui peut accueillir plus de 80 lits. En 1884, Toulgoët, historien écrit même : « On a construit dans de trop vastes proportions pour les ressources de la ville. Cet établissement qui contient quarante deux lits pourrait en contenir le double et n’est pas encore fini ».
De fait, des agrandissements auront encore lieu. Le premier en 1905. On rajoute une aile à l’hôpital. Et le maire Caron inaugure la nouvelle maternité en 1956, maternité devenue urgente car « les femmes prennent de plus en plus l’habitude d’accoucher à l’hôpital ».
Enfin le plateau technique actuel sort de terre dans les années 1975-76, après que la ville a fait ses « assises de la santé », sous l’impulsion du maire-adjoint Robert Leroux.
Les agrandissements au XIXe siècle se font grâce à la générosité de quelques vierzonnais. Citons Blanche Baron et Armand Brunet, que l’on honorera à titre posthume par l’attribution d’un nom de rue. L’agrandissement de 1905 est lié au legs Brunet qui souhait voir contruite une nouvelle salle, entièrement dédiée aux soins des vieillards.
L’hôpital connaîtra son courant anticlérical sous la 3ème République. 1883 : « Il ne sera plus dit de messes à l’hôpital. Tout attribut d’une religion quelconque devra disparaître de l’Etablissement. » En 1900 la motion suivante est votée : « Il est expressément interdit aux ministres des différents cultes, curés, pasteurs, rabbins, de pénétrer dans les salles, sans y avoir été appelés par les malades et sans être munis d’une autorisation délivrée par l’administrateur de service. » Par la même occasion, tous les crucifix disparaissent des chambres des malades…
Il reste à régler le problème de l’ancien hôtel-dieu.
La commission de l’hôpital va le vendre à la ville en 1872 pour la somme de 30 000 francs.
Le maire Hurvoy a le projet de le transformer en école professionnelle. Cela ne se fera pas. Il faut attendre quinze ans pour qu’une telle école ouvre, route de Paris. L’ancien bâtiment sera tout de même transformé en école, l’ « école des ponts. » Ce sera chose faite en 1875 après les importants travaux qui vont avoir lieu. C’est ainsi que les salles des malades deviennent salles de classe. Emile Charot, directeur de l’école lui donnera plus tard son nom, lui l’adjoint dévoué et fidèle d’Emile Péraudin…
Gros coup de communication pour la ville en ce début de mois de juillet… 1911.
Le 2 juillet 1911, débarquent à la gare messieurs Henri Brisson, président de la chambre des députés et Charles Couyba, ministre du commerce et de l'industrie, deux hôtes de marque pour la ville.
Les deux jours à venir vont drainer en ville une foule d'endimanchés qui vont assister à l'ensemble des festivités qui vont se dérouler aux quatre coins de la commune de Vierzon Ville.
Les Ecoles Nationales ont 25 ans
Hiver 1911. Au sein de l'Ecole Nationale Professionnelle, on se remémore que la première école nationale a ouvert ses portes aux élèves voilà 25 ans. Il s'agit de fêter dignement cet anniversaire. Et L'ENP de Vierzon sera l'Ecole qui organisera l'anniversaire au nom des quatre écoles professionnelles que sont Vierzon, Armantières, Nantes ou Voiron. La fête sera double, on en profitera pour mettre à l'honneur le millième membre de l'association des anciens élèves des écoles professionnelles.
Et pour Vierzon ce sera une date particulière. Le décret signant la création de l'école date de tout juste trente ans, le 9 juillet 1881.
Une délégation de l'Ecole part sonder le président de la chambre des députés qui accepte de venir à Vierzon à cette occasion. Rappelons que, ami personnel du maire Charles Hurvoy, il avait été un appui important pour que l'Ecole soit construite à Vierzon alors que Bourges était préférée à cause des établissements militaires.
L'Ecole fait une démarche auprès du maire Péraudin, autre ami de Brisson, et obtient une subvention de 6000 francs.
Pendant 7 jours, fin juin, la Dépêche du Berry va se faire l'écho des prochaines festivités, rappelant la genèse de l'Ecole, et distillant au compte-goutte le programme des deux jours.
Le programme
Le programme est grandiose. La société de pêche Le Barbillon propose un concours de pêche sur le canal où sont conviées pas moins de 160 autres sociétés. Toute la longueur du canal est ainsi occupée, de Villages à Forges.
De leur côté les sociétés de gymnastique La Vierzonnaise, l'Avant-Garde et les Energic's, associés pour l'occasion proposeront des démonstrations au cfamp de foire, accompagnés d'autres sociétés du Cher, comme Mehun , Bourges ou Saint Amand.
N'oublions pas la musique. Toutes les sociétés du Cher sont invitées. Toutes répondent présent. Au marché aux blés, place du Tunnel, place de la mairie, aux mails, les différentes sociétés se relaieront, sans oublier les musiques des pompiers et celle du polygone de Bourges. Et assureront les bals nocturnes sur ces mêmes places.
En ville, aura lieu le grand défilé, pêcheurs, gymnastes, pompiers, sociétés musicales qui parcourra le centre ville pavoisé pour rejoindre l'Ecole, lieu de la fête officielle, du banquet, et des nombreux discours qui seront reproduits in extenso dans la Dépêche du 4 juillet.
Fête de l'aviation
Et surtout, le clou du spectacle allait être la fête de l'aviation au Vieux Domaine. C''est la première fois que Vierzon allait recevoir ce type d'événement. Pour assurer un grand succès, toutes les entreprises de la ville vont fermer une heure plus tôt pour permettre aux ouvriers et employés d'aller sur place. Déjà la Dépêche distillait les infos : Ce sera grand ; ce sera du jamais vu ; les plus grands pilotes de l'air seront là...
Le 1er juillet, quand le journal publie le programme des fêtes de Vierzon, c'est un énorme monoplan qui remplit la page. Les as Level et Brindejonc sont annoncés. Level sur biplan Savary et Brindejonc, 18 ans, pilotant un monoplan Blériot. Les deux as devront se confronter dans une série d'épreuves. D'autres pilotes seront présents qui assureront explications et démonstrations sur plusieurs autres machines
Pendant ces deux jours les spectateurs sont autorisés à admirer les machines. Les plus téméraires auront droit à un baptême de l'air, ou plutôt « vol avec passager », comme on disait.
Et l'après-midi du 3 juillet a lieu le concours entre les deux as : concours de hauteur, concours de vitesse et concours d'atterrissage. A ce dernier concours, Brindejonc rate l'aire d'atterrissage et atterrit... dans le Cher. Plus de peur que de mal. L'homme et la machine sont indemnes.
La Dépêche du 4 juillet annonce plus de 10 000 visiteurs sur les deux jours d'exhibition aérienne. Tant et si bien que cela va donner l'idée au comité des fêtes de Vierzon de recommencer ce genre de spectacle. Il y en aura trois en tout. 1911, 1912 et 1913. Tous ont lieu au Vieux Domaine. Celui de 1913 sera le dernier. En effet, les aviateurs d'Avord avaient été sollicités. Un vieil avion biplan Voisin s'est écrasé en forêt de Vierzon après qu'une énorme explosion ait été entendue et que le pilote ut projeté à 350 mètres des restes de l'appareil « avec des blessures affreuses ». Le comité des fêtes ne renouvellera pas l'expérience pour 1914. De toute façon, les pilotes d'Avord se préparaient à une guerre...
La fée électricité
En 1911 la mairie n'a pas lésiné sur les décorations. Plusieurs arcs de triomphe ont été installés en ville, au sortir de la gare, rue de la République, place de la mairie, et avenue Henri Brisson aux abords de l'Ecole Nationale. Ils ont été agrémentés dizaines d'ampoules multicolores, éclairés dès le 1er juillet au soir. D'autres milliers d'ampoules électriques sont judicieusement placées sur les places et rues publiques où auront lieu les bals nocturnes. Le résultat donne un air de fête jusque là jamais égalé. Péraudin n'a pas regardé à la dépense pour promouvoir la fée électricité. Rappelons qu'alors, si les usines et administrations s'éclairaient électriquement, le plus grand nombre des particuliers s'éclairaient encore à la lampe à pétrole.
Les vierzonnais sont réveillés ce 2 juillet à 7 heures du matin par plusieurs salves d'artillerie tirées depuis le quai du bassin. A 10h00 les hôtes de marques arrivent à la gare. Un cortège se forme pour aller jusqu'à l'Ecole. Dans la salle des fêtes, des discours sont prononcés, on remet des prix aux meilleurs élèves et enfin on passe à table. Un banquet de quatre cents couvents, sonorisé par la lyre municipale et la musique des sapeurs pompiers de Vierzon. L'après midi est consacré à la visite des locaux et aux réalisations des élèves. Au passage on glisse dans l'oreille de Brisson que ce serait bien si l'école pouvait ouvrir une sections céramique malgré que Sèvres ne veut pas...En fin d'après-midi, c'est au tour de Péraudin de prendre la lumière. Il guide les officiels jusqu'au Bois d'Yèvre où vont être inaugurées les maisons HBM habitations à bon marché érigées par l'Abri Familial, ancêtre de France Loire.
Les officiels n'assisteront pas aux deux jours de festivités. Il repartiront le soir alors que la gare déverse toujours – selon la Dépêche – un flot incessant de curieux qui viennent participer aux festivités...
Dans son bilan du 4 juillet, le vocabulaire de la Dépêche est dithyrambique. Grandiose, exceptionnel, glorification, apothéose... sont là quelques uns des termes employés à de très nombreuses reprises au cours des deux pages souvenirs....
Images : Site internet BNF retronews - Archives municipales Vierzon
En ce matin du 4 juillet, Vierzon se réveille sonnée. Il y a encore une odeur de gaz lacrymo dans les rues lorsque les volets s'ouvrent.
Rapidement nombre de commerçants du centre ville, propriétaires ou gérants, vont devoir faire face aux vitrines éventrées. Et pour monter un dossier assurances, la première chose à faire est de porter plainte. Pendant que le commissaire rédige son rapport au préfet sur les événements de la nuit, c'est la cohue au dépôt de plaintes. Chacun son tour...
Mais Pulsar n'est pas officiellement terminé. Il restait cette dernière journée où Ray Charles devait se produire pour le concert de clôture.
Au milieu de la cohue, un homme fait attester de la présence de l'artiste à Vierzon. Il fait attester que l'impossibilité de se produire sur scène n'est pas de son fait mais de celui des organisateurs. Pour Ray Charles aussi, il faut un sésame pour que les assurances puissent régler son cachet...
Porter plainte... oui, mais contre qui ?
Certains voient que la Ravenelle n'est pas solvable. C'est contre la mairie que les dépôts de plainte vont avoir lieu. Mairie où le bureau du maire est assailli par une foule de mécontents. La mairie porte plainte contre la Ravenelle, la Ravenelle contre le détournement de fonds... C'est un imbroglio judiciaire qui commence en ce 4 juillet. Le dernier délibéré lié à Pulsar aura lieu en 1992. Il aura fallu douze ans et de volumineux dossiers pour éteindre l'incendie du 3 juillet 1980. Entre temps le bureau du maire avait changé de locataire.
La ville de Vierzon contre la Ravenelle
Au total, la mairie a fait une avance de plus de 1 million de francs à la Ravenelle, somme qu'elle sait ne jamais revoir. Elle se doit de porter plainte contre X pour protéger les intérêts de l'ensemble des vierzonnais.
La procédure va durer trois ans et aboutir à un non-lieu contre la Ravenelle (ordonnance du 17 octobre 1983). Il n'y avait de toutes façons pas d'autre solution : l'État avait demandé et obtenu la dissolution de l'association en juillet 1982.
En effet les livres de compte de la Ravenelle faisaient mention d'un déficit abyssal de plus de 1,6 million de francs. Un syndic est nommé et la procédure durera deux ans.
Mais il faudra encore deux ans pour que la Ravenelle sorte du tribunal. Le trésorier a en effet été poursuivi pour émission de deux chèques sans provision d'un montant total de 17 000 francs. Il sera condamné en 1984 à 1000 francs d'amende avec sursis, puis amnistié.
La ville contre le Trésorier payeur général
Après que les plus folles rumeurs aient été écrites dans la presse locale, après que chacun y ait apporté sa propre opinion, les services fiscaux se sont emparé de l'affaire. En substance il est reproché au maire d'avoir débloqué la somme de 620 000 francs (les deux dernières avances à la Ravenelle) sans prévenir personne et sans même en avoir le droit.
S'ensuit une correspondance glaciale entre les services municipaux et fiscaux. Cela se conclut par un épluchage en règle des comptes de la ville, tous services confondus. Il est même suggéré par les services de l'Etat que les sommes prêtés à la Ravenelle ont pu être détournés et atterrir dans d'autres poches. Ce qui était faux, bien sûr...
On en arrive au clash, le trésorier payeur général bloque tous les emprunts de la ville pour 1981. Pendant quelque temps la ville est en vraie situation de crise et ne peut plus honorer aucune dépense.
Mais une certaine élection présidentielle de mai 1981 va débloquer rapidement la situation... Affaire classée.
Les casseurs
Rumeur persistante en ville : Des hordes de casseurs auraient déferlé sur le centre ville pour le mettre à sac. On dit même que ce serait les organisateurs du Printemps de Bourges qui les auraient payé pour ça. Rumeur infondée. Du fait de casseurs, les dix interpellés par la police ont le même profil : des jeunes festivaliers chauds-bouillants qui ne peuvent pas voir leurs idoles favorites. Certains avouent avoir mis le feu au parquet place de la République. D'autres admettent avoir jeté « ce qui leur tombait sous la main » sur les forces de l'ordre. D'autres admettent leur participation « pour faire comme les autres ».
Déférés en comparution immédiate, les dix ont écopé de deux à dix mois de prison avec sursis. Six d'entre eux seront amnistiés par le nouveau pouvoir en mai 1981... Affaire classée
Les commerçants
Beaucoup de commerces ont vu leur vitrine cassée ; certains ont été pillés. Beaucoup avaient déposé plainte contre X mais, au vu de l'insolvabilité des dix interpellés comme de la Ravenelle, se sont retournés contre la mairie.
Dans les différentes audiences, les commerçants ont chargé la mairie comme co-organisatrice du festival. Ce n'était pas le cas. Les commerçants ont donc été déboutés de leur demande et n'avaient plus que leur assurance respective pour rembourser les dégâts.... Affaires classées...
L'intermédiaire de spectacles
La société Arlequin est donc le tourneur chargé de prendre les contacts avec les artistes. Mais pas que. Arlequin a aussi imposé la boîte du maintien de l'ordre. Elle a aussi fourni les chapiteaux pour les spectacles.
Or le 4 juillet, les chapiteaux sont en partis saccagés. Arlequin les rend dans cet état à son réel propriétaire, Monsieur Robba. Robba les avait loué à Arlequin qui les a sous-loués à la Ravenelle.
En octobre 1980, Arlequin assigne la ville pour les chapiteaux. Pourquoi ? Parce que la Ravenelle n'est pas solvable ? Non, mais parce qu'Arlequin n'est pas solvable. De fait, par contrat, Arlequin devait prendre une assurance pour les chapiteaux. Arlequin ne l'a pas fait. Arlequin s'est retourné contre la Ravenelle qui elle, avait pris une assurance. L'assurance de l'association n'a pas voulu payer. Donc Arlequin s'est retournée contre la ville. Mais Arlequin a été déboutée... Affaire classée.
La sécurité
La sécurité autour des spectacles était assurée par Securidog, siège social à Lyon. Les gros bras étaient dès le début considérés comme trop fébriles, par la Ravenelle, par le public, par la presse.
La boîte de sécu va envoyer trois factures à la Ravenelle dont une de 51 000 francs. La Ravenelle out, c'est à la mairie que cette dernière facture est présentée. Riposte de la ville : ce n'est pas avec nous que vous avez traité, c'est avec la Ravenelle. Sécuridog est déboutée en 1985.
Elle revient pourtant à la charge en 1992, avec « de nouveaux éléments ». En fait un employé affirme avoir traité verbalement avec la mairie. Témoignage insuffisant... Affaire classée.
1992 sera la queue de comète de Pulsar 80. Les « affaires » autour de Pulsar auront donc duré douze ans, concerné deux maires, à cheval sur trois mandats.
Il existe bien d'autres procédures liées à Pulsar... comme le parquet brûlé, la boîte de son et lumière, un festivalier blessé...
Une fois les affaires éteintes, la rumeur courait toujours qu'il existait un impôt « spécial Pulsar ». La aussi, chou blanc. Les sommes données au festival l'ont été en diminution d'autres projets municipaux...
Mais il existe des conséquences liées à pulsar. La première est l'installation d'une sous-préfecture à Vierzon, depuis 1985. Pulsar a montré le besoin de la proximité de l'Etat dans une grande ville comme Vierzon. Décision présidentielle suite à demande expresse du député de l'époque.
Autre conséquence pour la ville : la pérennisation de l'équipe du SMUR au sein de l'hôpital de Vierzon en 1984. L'essai pendant le festival avec une équipe détachée de Bourges avait montré toute sa nécessité...
On peut lire : Beurion et Leclerc, Il y a 20 ans la musique explosait à Vierzon Pulsar 80, CHPV, 2000
Images : Berry Républicain, Nouvelle République du Centre Ouest, Actuel, Best, L'escargot folk
Archives municipales Vierzon, Collections privées
« Pulsar 80, cet été la musique explose à Vierzon ». L'explosion a eu lieu. Pas forcément celle escomptée. Si aujourd'hui, plus de quarante ans après, on parle de Pulsar avec un brin de nostalgie mêlé de rumeurs tenaces, ce n'était pas le cas au lendemain du 3 juillet 1980, alors que les services municipaux se dépêchaient de nettoyer les stigmates d'une « nuit d'émeute » comme le titrait La Nouvelle République.
Pourtant le programme était alléchant ; tout aurait dû se dérouler à la perfection. Les organisateurs avaient tout prévu. Tout sauf le petit grain de sable qui grippe la machine et qui finit par la mettre en panne. Et ce petit grain de sable fut... un orage un soir d'été.
Organisation blindée et programme alléchant
La Ravenelle, c'est le nom de l'association organisatrice. Guère plus de 20 ans d'âge moyen. Depuis 1977 l'association organisait des festivals folks à Saint Georges sur la Prée qui attiraient entre 5 000 et 10 000 spectateurs selon les sources.
1979, la Ravenelle veut voir grand et proposer à Vierzon un festival multi-disciplines, du classique au rock,. Fort de leur expérience, la municipalité leur emboîte le pas et soutient le projet.
D'un point de vue logistique, la mairie va faire monter les chapiteaux et scènes, place de la République, au marché au blé, à Bellevue. Elle va préparer la signalétique et le barriérage, acheminer le courant électrique sur les différents lieu de programmation. Elle va encore prévoir de transformer ses stades en campings temporaires (Brouhot, Chaillot, La Bras, Canal) pour les festivaliers et les aménager avec l'eau courante pour des lavabos et des toilettes en nombres. Nombreuses sont les réunions techniques à avoir eu lieu au sein des services municipaux, à l'hiver et au printemps 1979-80.
Le maire demande qu'une équipe de secours d'urgence de Bourges (SMUR) reste à Vierzon le temps du festival. Il s'occupe également de l'augmentation nécessaire des effectifs de police et de gendarmerie. Le préfet fera alors appel à un renfort conséquent de CRS.
Et côté finances, la ville accorde une avance de 400 000 francs à la Ravenelle, remboursable à l'issue du festival. Quelques semaines plus tard, une deuxième avance du même montant sera octroyée à la Ravenelle.
C'est à peine suffisant pour signer les premiers contrats. La Ravenelle fait délibérément fuiter quelques noms pour faire monter la mayonnaise : Mama Béa, Jimmy Cliff, Bernard Lavilliers, Ray Charles. Ce sera grand, ce sera sur 8 jours, du 28 juin au 5 juillet.
100 000 personnes doivent passer par Vierzon, soit plus de 10 000 festivaliers par jour. Du jamais vu. Pulsar 80 dégoupille tous les à priori. Le jeune Printemps de Bourges n'a qu'à bien se tenir, Vierzon entre dans la danse.
Cela n'empêche pas les esprits chafouins. Le 28 juin la mairie doit se fendre d'un communiqué pour couper court aux rumeurs : « Les festivaliers seront le reflet de l'accueil que nous leur réserverons... »
Et la pluie s'en mêle...
En ce premier jour de festival, l'Orchestre de Mexico doit jouer sous le chapiteau de la place de la République. C'est sans compter sur ce petit grain de sable : la pluie. Tous les prétextes sont trouvés pour que l'orchestre ne joue pas : la scène n'a pas la longueur suffisante, le bruit de la pluie empêche de jouer normalement, les musiciens veulent prendre une douche et, ah oui, au fait, vous nous devez 62 000 francs. Bref l'orchestre se tire, et on apprendra plus tard que leur car faisait « Paris by night » à l'heure d'être sur la scène vierzonnaise.
Bon, il reste Angelo Branduardi pour faire décoller Pulsar. Mais l'orage redouble et le chanteur ne se produit pas non plus, malgré un cachet de 170 000 francs... Les spectateurs frustrés vont se rabattre au cinéma qui fait le plein avec un film de Mocky : « Piège à cons »...
« Né un soir d'orage ». C'est le gros titre de la presse ce 29 juin au matin.
La Ravenelle a la peur au ventre. Si la pluie continue, elle pense même à annuler purement et simplement le festival.
Mais Al Jarreau rapporte le soleil sur Vierzon et dans l'association. Le vrai démarrage du festival a lieu le ce 29 juin. Pourtant la Ravenelle n'est pas sereine : Billy Preston annule, John Lee Hooker également. De même que Trust qui sera remplacé par Higelin. Déjà il faut rembourser les billets...
Montage financier risqué
La Ravenelle, petite association locale, doit faire appel à un intermédiaire, un « tourneur », pour prendre les premiers engagements qui seront alors payés avec les avances octroyées par la ville.
La société choisie par l'association s'appelle Arlequin et appartient à Luc Gaurichon, qui impose également les deux boîtes, de sécurité (secury dog) et de son et lumière (light and sound).
La Ravenelle a accepté de prendre beaucoup de risque dans le montage financier du festival : Le principe est de payer les artistes du lendemain avec le montant des entrées de la veille.
La première journée est doublement catastrophique : Non seulement l'orchestre de Mexico et Branduardi ont touché leur cachet sans jouer, mais en plus il va falloir rembourser les spectateurs. Cela commence mal.
Les jours suivants ne sont guère mieux. Le maire « pour éviter le pire, une émeute de 6000 personnes », accepte de payer une nouvelle avance de 220 000 francs à la Ravenelle.
L'argent ne rentre toujours pas. La faute à qui ? Pourtant les concerts ont bien lieu, Mama Béa, Lavilliers, Valérie Lagrange...
Dans son livre blanc écrit au lendemain du festival, La Ravenelle est revenue sur certains points : Secury dog a embauché des Hell's Angels pour assurer la sécu. Ils font entrer leurs copains gratuitement aux concerts. Quand la Ravenelle compte 500 billets vendus, il y a 1000 personnes sous le chapiteau...
Quant à Sound and light, sonorisateurs anglais, Branduardi a témoigné de leur professionnalisme : « la couverture de scène des anglais n'était pas conforme »... Ils n'ont pas mis le matériel à l'abri de la pluie, c'est ce qui aurait fait reculer la chanteur par peur de l'électrocution.
Nuit d'émeute
Dès le troisième jour, en coulisse rien ne va plus. L'intermédiaire fait main basse sur la fin du festival et sur la billetterie. Ce sont entre 100 000 et 200 000 francs qui sont détournés, le trésorier, lui, est tabassé. Gaurichon aura ces mots : « Arrêtez de merder, le festival ne marche pas. Vous perdez de l'argent, on prend les choses en main ». La presse titre que les professionnels ont fait main basse sur Pulsar, Arlequin rimant avec requin.
Le flou règne sur le festival. Les festivaliers veulent comprendre : Pourquoi les annulations ? Pourquoi les artistes non payés ? Pourquoi les billets non remboursés ? La Ravenelle est en réunion avec la municipalité pour répondre à ces questions. Mais elle n'a plus la main.
En ce 3 juillet Les premières pierres volent. La camionnette de la billetterie est renversée. Higelin, qui vient d'arriver et qu'on a mis au courant du fiasco est prêt à jouer gratuitement pour apaiser les tensions. C'est sans compter sur les sonorisateurs anglais de sound and light qui remballent...
Le soir, les premières chaises sont brûlées place de la République, le parquet suit, la camionnette de la billetterie également.
La suite, il faut la chercher dans les rapports du commissariat de police. 2000 personnes autour du feu, il faut que la police protège les pompiers chargés d'éteindre l'incendie. Le grand chapiteau vient d'échapper au même sort mais est tout de même abîmé.
Les forces de police chargent à coup de gaz lacrymo. Les festivaliers s'éparpillent dans les rues annexes. Des vitrines tombent...
Higelin quant à lui entraînait quelques uns des festivaliers jusque dans un bar de Marcilly en Gault pour un concert improvisé.
Ce 4 juillet, le Berry Républicain titre sur « une folle nuit ». Les émeutes ont duré jusque 2h30 du matin. 10 jeunes ont été interpellés par la police et 3 policiers ont été blessés.
Au matin, lorsque les services municipaux nettoient les stigmates de cette folle nuit, les premières plaintes arrivent sur le bureau du commissaire. Pulsar entre dans sa deuxième phase, judiciaire, celle-ci...
Images : Archives municipales Vierzon
Les plus anciennes traces de notre passé médiéval sont en centre ville, dans le « vieux Vierzon » avec l'église Notre Dame d'un côté, et le beffroi de l'autre. Les parties les plus anciennes de l'église sont du 11e siècle, le beffroi date lui du 12e siècle.
Pourtant, de patrimoine religieux, il en existe une autre trace, qu'il faut chercher un peu plus loin, dans ce qui n'était pas la ville à l'époque. Patrimoine aujourd'hui privé, dissimulé derrière une haie, mais que de nombreuses générations de collégiens et lycéens ont dû découvrir en se demandant – ou pas – quel pouvait bien être ce bâtiment. En effet, il se situe rue Charles Hurvoy, juste en face de l'entrée principal du lycée. Aujourd'hui il ne reste plus qu'un seul bâtiment, la chapelle, d'un ensemble qui se trouvait être une maladrerie.
Au retour des Croisades, les seigneurs français n'ont pas rapporté que des trésors pris en Terre Sainte, ils ont également rapporté une cruelle maladie incurable, la lèpre.
Dans beaucoup de localités, le 12e siècle a ainsi vu s'ériger des maladreries ou léproseries, hors les murs des villes, très à l'écart des citadins et de la contagion.
Vierzon ne déroge pas à la règle qui voit se construire une maladrerie pour femmes quelque part au 12e siècle, loin du centre urbain, « sur le grand chemin de Paris » nous disent les archives. Ce grand chemin de Paris, en sortant de la rue Porte des bœufs, passe par les rues Perrin, Hurvoy, Fourrier et Flourens.
De son passé de maladrerie, il perdure aujourd'hui le nom de tout le quartier de la cité scolaire : « les Malvoisines ». Malvoisines, comme ces femmes qu'il faut éviter de côtoyer de trop près.
Quant à la rue Hurvoy, elle s'est pendant de nombreux siècles appelée la « rue Saint Lazare ». Et même « rue Saint Ladre » au 16e siècle.
Il existait une deuxième maladrerie à Vierzon, une maladrerie pour hommes. Malheureusement, de celle-là les archives n'en ont pas gardé souvenir. Il est fort probable qu'elle ait été située au Bois d'Yèvre, aujourd'hui Vieux Domaine, là encore à l'écart de la ville (il existe toujours une rue Saint Lazare au Vieux Domaine). Hommes et femmes non mélangés, la morale chrétienne restait sauve.
Des deux premiers siècles de son existence on ne sait rien du fonctionnement de la léproserie pour femmes. C'est autour de la fin du 14e siècle que l'on peut commencer à l'appréhender. La maladrerie est alors rattachée à l'Hôtel-Dieu qui vient d'être construit, lui aussi hors les murs de ville (aujourd'hui l'école Emile Charot). Elle possède ses propres revenus qui doivent permettre de s'occuper des « pauvres malades de la paroisse exclusivement ». Ces revenus sont sous forme d'une rente due par le seigneur de Vierzon mais également par l'exploitation de vignes et de bois qui entouraient Saint Lazare. Ces revenus sont très supérieurs à ce que coûte réellement le service des lépreux et feront l'objet de convoitise de la part des édiles municipaux, au 17e siècle.
Pour l'heure, la maladrerie de Saint Lazare regroupe trois bâtiments : une maison pour les lépreuses, une maison pour le soignant (cette dernière va être agrandie lorsque les sœurs hospitalières s'en occuperont), et bien sûr la chapelle qui, 800 ans plus tard, a conservé sa magnifique charpente sculptée. Aujourd'hui il ne reste plus que la chapelle mais les restes des anciennes maisons étaient encore visibles il y a une soixantaine d'années. Accolé à la chapelle il y avait le cimetière, sans cesse réutilisé. C'est ainsi que des travaux aujourd'hui pourraient faire émerger plusieurs strates de squelettes.
Au sortir de la Guerre de Cent Ans, Vierzon se dote d'un Collège. Nous sommes en 1460 et le premier « modérateur des escholes de Vierzon » est Jean Béguin, futur recteur de l'Université de Bourges. Le revenu initial du collège ne suffisant pas à son activité, les élus de la ville vont plaider auprès du conseil privé du roi, le droit de rattacher les revenus de la maladrerie à ceux du collège. Ce sera chose faite par arrêté le 26 mars 1663. Les élus vierzonnais viennent enfin d'obtenir le droit de gérer eux-mêmes les revenus de la maladrerie. Bientôt le collège ne sera plus seul bénéficiaire des revenus de Saint Lazare. Dès 1693, ce ne sont que 100 livres qui lui sont affectés alors que le revenu en rapporte près de 600.
Tout au long du 18e siècle, les réparations « urgentes » se multiplient alors que la lèpre disparaît.
A la Révolution Française le bâtiment est vide, aucun curé ne vient plus dire la messe. Dès lors, pour la commune, pourquoi conserver les bâtiments ?
Il sont rapidement vendus. Par contre, les bois autour sont précieusement conservés ; leur exploitation rapporte de l'argent au budget.
Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un nom, « Malvoisines », et une chapelle pour remémorer la fonction du lieu...
Images : Archives municipales, clichés F. Fontaine
Si l'on en croit le cartulaire des moines de l'abbaye saint Pierre de Vierzon, le terrain devenu basse-cour du château leur appartenait de tous temps (quartier tunnel-château aujourd'hui). Ce n'est que l'abbé Syon, abbé du début du 11e siècle qui l'aurait donné à un seigneur pour que ce dernier en fasse sa forteresse. Ceci permet en outre d'avoir une explication logique du toponyme de « Sion » pour la butte du même nom.
Mais du cartulaire de Vierzon, quelques chartes sont fausses... dont celle de cette donation de Syon.
En fait, quittant Saint-Georges-sur-la-Prée en 903 sous la pression des Normands, les moines s'enfuient dans un monastère qui leur appartient, sur les bords de l'Yèvre, « dans le château de Vierzon », donc sous la protection du seigneur local qui est lui-même vassal du Comte de Blois Chartres et Chambord.
Toujours prompts à voir leur prééminence affirmée, les moines de Saint Pierre en avaient oublié quelque peu l'épisode douloureux des invasions Normandes.
Le château de Vierzon en 903 est loin d'avoir l'aspect d'un château médiéval type. Il faut imaginer une tour en bois sur la butte de Sion, tour peut-être entourée d'une palissade. Mais rien n'est moins sûr, la « Pax Romana » ayant détruit toutes les murailles des villes. Ce seront les Capétiens puis le 12e siècle de Philippe Auguste qui remettront les murailles défensives à l'ordre du jour.
La « chronique de Vierzon », texte introuvable aujourd'hui mais que Toulgoët avait entre les mains en 1880, veut que Vierzon ait été incendiée en 1067. C'est dans le siècle qui suit qu'il faut imaginer la construction du château tel que les rares vestiges peuvent encore nous laisser supposer son apparence.
Ainsi est né le premier rempart vierzonnais aux 22 tours et portes. Ainsi est née la tour d'entrée du château, plus tard appelée tour du guet, beffroi, porte des bans ou bien même prison, selon les époques et son utilisation. Ainsi est née la tour dite de l'arsenal dont les créneaux sont du plus pure style 19e siècle, à la Viollet-le-Duc. Ainsi est né le château proprement dit dont la seule pièce d'origine restée intacte – la cave – peut encore nous laisser imaginer sa superficie. Ainsi sont nées la cour et la basse-cour du château.
Si l'on en croit Guillaume le Breton, chroniqueur de Philippe Auguste, dans « tout le pays de Berry que le soleil dore de ses rayons, on ne pouvait trouver un château plus magnifique ni entouré de terres plus fertiles. A droite s'étendent les plaines de la Sologne fécondes en grains, à gauche les replis du Cher qui coule doucement au milieu de prairies verdoyantes, sillonné de barques et abondant en poissons... ».
Il faut bien le reconnaître, il a dû y avoir un raté entre le 12e et le 19e siècle. Si l'on croit Félix Pyat, la Sologne est devenue insalubre, l'air y est un miasme, l'homme n'a d'humain que d'aspect et son esprit s'est arrêté avant la fin de son développement. Plutôt que d'envoyer les bagnards à Cayenne, Pyat proposait « des condamnations à la Sologne ». Là au moins les forçats auraient fait oeuvre utile à défricher et assainir les marécages boisés. Sologne n'était pas encore synonyme de bon vivre ou parties de chasse.
De la même manière, le « magnifique château » de Guillaume le Breton a perdu de sa superbe entre les 12e et 19e siècle.
D'abord en 1356. Le Prince Noir détruit le château de Vierzon et en tue tous les hommes (Froissard). Mais Vierzon la traître au roi de France sera punie par Charles VI : Interdiction lui est faite de reconstruire un quelconque système défensif. Le château ne sera jamais reconstruit, seule subsiste la cave, utile au gouverneur-représentant du roi pour y loger les vins du domaine et taxes en nature.
Cet épisode de la Guerre de Cent Ans sera funeste pour Vierzon. Il explique notamment le manque de vestiges médiévaux dans notre cité.
C'est ainsi que la basse-cour ne sera bientôt plus protégée, que les pierres des murailles serviront à construire des étages supplémentaires aux maisons existantes ou à en construire de nouvelles.
De bourgeois, le quartier « Château » va peu-à-peu se paupériser à partir du milieu du 18e siècle et la création des routes royales. Les artisans et commerçants préfèrent voir leurs échoppes se développer autour de ces voies nouvelles de communications que sont la rue Armand Brunet et la rue de la République, les grand et petit mails prenant du galon par la même occasion.
Le constat de Pyat est sévère. Il en est d'autant plus douloureux que son auteur est originaire de la ville, qu'il est né à quelques pas du quartier traité de cour des miracles.
Et ce n'est pas l'arrivée du chemin de fer en 1847 qui aura changé sa physionomie. Tout juste son nom. On est passé du quartier « château » au quartier « tunnel château ». Les terres extraites du tunnel vierzonnais ont vite recouvert une partie des vignes du Clos du Roy. Un beau parking y est tracé aujourd'hui : celui des acacias.
Un siècle plus tard les choses ne se sont pas arrangées.
Nous sommes dans les années 1950 et le projet, impulsé par la municipalité de Maurice Caron, est de détruire tout entier le quartier pour reconstruire du neuf. A voir certaines photos on se dit que Caron puis Mérigot n'avaient pas tort dans leur volonté de modernisation.
N'oublions pas que les années 1950 sont celles du mal logement. Rappelons nous « Hiver 54 », l'appel de l'abbé Pierre. Retentissement d'autant plus grand que Vierzon eut à subir les bombardements de juillet 1944. Au total plus de 25% des habitations de la ville auront été détruites par les bombes et, à l'aube de 1960, la municipalité Mérigot estime à 300 le nombre de familles vierzonnaises mal logées. Il existe encore des baraques « provisoires » sur la place du Tacot ou aux Forges. Sans oublier les taudis du centre ville.
Construire des HLM dans le quartier permet de faire coup double : détruire un îlot insalubre certes, mais aussi de construire un quartier à l'image de ce que voulaient les élus. C'est ainsi que les plans font apparaître, juste derrière le beffroi, un centre de congrès – musée, une maison des jeunes et enfin une bibliothèque.
Ces investissements culturels passeront rapidement au second plan tant la politique du logement est importante. Les financements qui arrivent au compte-goutte seront ainsi redéployés dans d'autres projets immobiliers : Colombier et Sellier.
En 1960, l'heure n'est pas encore à la protection du patrimoine. C'est là une idée qui viendra avec les années Giscard, amplifiée par la politique de Mitterrand. Pour l'heure, il s'agit de mettre à disposition des vierzonnais les commodités auxquelles ils aspirent : l'eau courante est au robinet, eau froide eau chaude ; pas besoin d'aller « au fond du jardin » pour trouver les lieux d'aisance. Quel confort pour nos contemporains à qui on a remis les premiers les clés de leur appartement, en 1964 !
La seule chose que l'on puisse regretter aujourd'hui est bien l'absence totale de fouilles archéologiques ante reconstruction. Quelques rares éléments éparses ont été retrouvés, mais l'absence de relevés et d'analyse scientifique hypothèquent pour longtemps notre histoire locale, surtout sur les siècles qui nous manquent, le temps des mérovingiens, le temps d'avant le cartulaire des moines...
On peut lire : Félix Pyat, le château de Vierzon, 1848
Images : Archives municipales Vierzon
À Vierzon, il est une tradition vieille (presque) comme le lycée Henri Brisson : les funérailles de Père Cent. Fin mars début avril, les élèves de dernière année fêtent leurs derniers cent jours au lycée, derniers cent jours avant de rentrer dans la vie active ; derniers cent jours avant de devenir des anciens, des « Vierz'arts ».
Le Père Cent a été copié sur la tradition militaire de la Quille et symbolise les cent jours restant avant la fin de quatre années d’études à l'École Nationale Professionnelle, créée en 1883.
Organisé clandestinement quelque part au sortir de 1918, les directeurs de l’époque ont réprimé ce joyeux chahut au nom de la sacro-sainte discipline. Selon la tradition orale, les premières promos se retrouvaient plus ou moins clandestinement en forêt pour y brûler un petit cercueil confectionné en cours d'année. Et cette même tradition orale parle d'aventures plus alcoolisées, au Chalet de la forêt ou dans quelques bars en ville. Il faudra attendre les années 1945 – 1946 pour que cette tradition soit officiellement autorisée, qu'elle prenne son rythme de croisière,0et devienne un éclat de rire sur la ville.
Organisé le week-end des Rameaux, tout commençait avec la préparation des locaux. Jean-Pierre Desbordes, ancien élève et président des Vierz’arts se souvient : « Il y avait vraiment beaucoup de monde qui venait à notre bal, les autres écoles étant invitées. C’est pourquoi nous sonorisions les salles de classe à côté de la salle des fêtes. Comme ça tout le monde pouvait profiter de la musique. Et quelle musique ! Des pointures se sont produites à l'ENP, Stéphane Grapelli, Claude Bolling... mais aussi l'orchestre de Claude Chevalier, par exemple. Cela permettait également aux élèves de souffler un peu entre deux danses. D’autant plus que les bars se trouvaient dans ces salles annexes, tous tenus par les professeurs qui empêchaient certains débordements et tenaient lieu de chaperons. » Et les salles n’y suffisaient pas. Des parquets étaient loués pour l’occasion, montés dans la cour d’honneur du lycée.
« Une semaine avant les festivités nous organisions une chapelle ardente au sein du lycée, dans une salle de classe. La porte était entourée d’un grand dais noir et les élèves de toutes les classes devaient veiller à tour de rôle le cercueil que nous avions confectionné, et rempli de pétards et souvenirs hétéroclites. »
Un faire-part de décès comme invitation
Il fallait annoncer la manifestation. Chaque promotion réalisait son faire-part. A l’intérieur, un trombinoscope de tous les élèves en partance du lycée. Sur celui de Jean-Pierre Desbordes, on peut lire que monsieur O. Piffe fabricant de fraiseuses, que Riri Ogras pharmacien non diplômé, et les élèves G. Hunebul et S. Pèrancore annoncent l’enterrement de Jean né AnkoreCent.
Les festivités commençaient par des sketchs que les potaches jouaient devant un public hilare. Des sketchs « faits maison » où l’on s’amusait à parodier les professeurs, leur façon de s’habiller, leur gestuelle et leurs tics de langage. Les intéressés n’ont jamais montré la moindre animosité envers les jeunes créateurs... Sauf en 1951, où le directeur, brocardé, a interdit ce type de manifestation pour les années suivantes.
Le clou du spectacle : le défilé en ville dont la légende veut qu’il ait été mis sur pied uniquement pour faire de la propagande pour le bal du soir. Tout le monde se prépare dans l’enceinte du lycée. Six élèves portent le cercueil, en grand costume, casquette à la main. Sur le cercueil, un drap blanc avec le veston et la casquette du défunt. Dans le cortège le curé d’un jour et les élèves portant les outils de leur spécialité. Les fondeurs défilaient avec leur bleu, les céramistes en blouse blanche, les modeleurs avec leur hélice sur l’épaule. La fin du défilé était dévolue aux costumes les plus loufoques possibles, des étudiants langés dans des poussettes, tétine à la bouche, par exemple.
Des bouchons jusqu’à Salbris
Tout ce cortège partait en ville via la rue de la République et le Mail pour remonter jusqu’au lycée. Et c’était là une course de lenteur : « Le record à battre était de deux heures pour faire le trajet du lycée à la place Foch ». Et le long du trajet une foule immense qui attendait les potaches pour tenter de faire rire les porteurs avec des grimaces. Mais leur fonction leur interdisait le moindre rictus. « J’ai vu des gens qui n’étant pas de Vierzon se sont signés au passage du cortège. On pouvait lire l’incompréhension sur leur visage à la vue des derniers costumés à défiler. »
Deux heures pour descendre, le plus lentement possible, au son de la Marche Funèbre de Chopin, jouée par les élèves musiciens. En ce temps où la déviation n’existait pas et où l’on ne parlait même pas encore d’autoroute, on imagine les bouchons qui se formaient de part et d’autre de Vierzon. « C’est simple, l’embouteillage commençait dès Salbris. Et c’était pour nous une source de fierté d’avoir à ce point désorganisé la circulation. En remontant, nous chantions notre chanson : la DKL comme « décaler » de Vierzon. Les premières paroles étaient les suivantes : Vierzon nous te quittons, sans regret sans amertume ». Quant au cercueil, il devenait feu de joie pendant le bal, à minuit pile, dans la cour d'honneur du lycée...
Plusieurs fois, la tradition du Père Cent a failli disparaître, plusieurs fois elle a ressuscité. Interdite en 1969 par la police pour cause de perturbation de la circulation automobile, la mise en place de la déviation a permis son retour des années plus tard. Le changement de lieu du bal (salle Sologne) ou encore la non participation de tous au défilé et l'abandon du costume de l'école ont fait que les anciens ne s'y retrouvaient plus et ne venaient plus.
Aujourd'hui accolée à Carnaval, espérons que la mayonnaise reprenne...
On peut lire : L' Ecole Nationale Professionnelle de Vierzon, Jean-Pierre Desbordes et Claude Richoux, La Bouinotte, 2011
Images : Archives municipales Vierzon
Lorsque l'affaire éclate, en 1730, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de seigneur de Vierzon ; la Guerre de Cent Ans avait balayé les derniers successeurs de Humbaud.
La seigneurie fut reprise par le roi de France en personne et distribuée (revendue...) à qui bon lui semble.
C'est ainsi que la terre de Vierzon (qui va jusque La Ferté-Imbault) passe entre les mains du duc Jean de Berry, ou encore entre celles de Louis de Laval. La baronnie de Vierzon entrera ensuite en apanage aux enfants puînés du roi. Le dernier d'entre eux étant le Comte d'Artois,, futur Charles X et bâtisseur du premier établissement industriel de Vierzon, en 1779.
Juste avant le Comte d'Artois, l'apanagiste du domaine vierzonnais en était Louise Elisabeth de Bourbon Condé. Fille de Mademoiselle, née en 1693, elle est la petite fille de Louis XIV.
Après son mariage en 1713, elle devient princesse de Conti et c'est sous cette titulature que les vierzonnais la connaîtront, et contre laquelle les moines devront plaider...
Franchise saint Pierre
Depuis l'origine, l'ensemble des vierzonnais se doivent de payer leurs impôts et taxes au seigneur de Vierzon (banalité, taille, cens, champart…)
Hervé 1er, de retour – vivant – de la croisade, offre des libéralités à de nombreuses institutions religieuses, dont l'abbaye saint Pierre de Vierzon.
En 1182, une charte signée de sa main offre aux moines les droits qu'il possède dans une partie de la ville. Cette portion de ville devient la « franchise saint Pierre » sur laquelle les moines jouissent des droits seigneuriaux comme le cens et les dîmes.
Cette charte est particulièrement intéressante puisqu'elle décrit Vierzon à la fin du XIIe siècle. Son texte, très résumé, est le suivant :
« la terre ou franchise de saint Pierre est circonscrite par quelques rues publiques et commence à une tour et un carrefour qui sépare la terre de saint Pierre de la rue des forges… jusqu'à une grosse pierre appelée gros caillou… De là elle va jusqu'à… la maison de la Monnaie, puis… jusqu'à l 'église Notre Dame… puis au bas de la motte de l'église jusqu'aux clôtures de la basse ville et sur le bord en face des moulins du monastère de l'Yèvre, puis [suit le cours de l'Yèvre] jusqu'au mur de ville et de là en remontant jusqu'au carrefour de la rue des forges. »
La charte est reproduite dans les registres du bailliage de Vierzon, l'original étant dans le fonds de l'abbaye des archives départementales. L'original date bien de 1182 mais il manque le protocole final (nom du signataire, des témoins, la date et surtout le sceau du seigneur et celui des moines).
Un long procès de 15 ans
En 1730, le procès qui s'ouvre au bailliage de Vierzon concerne les deux principaux propriétaires fonciers de la ville, deux seigneurs ayant les mêmes droits, un ecclésiastique et un noble. Il peut ainsi se résumer : la princesse essaye d'affaiblir le père abbé pour récupérer une partie des revenus et augmenter ainsi sa rente.
Cela passe par une contestation du périmètre de la franchise saint Pierre où s'appliquent les droits et la justice de l'abbé.
En 1729, Nicolas Gourdon, procureur de la princesse, fait établir en son nom un droit de festage sur une liste de maisons incluses dans la franchise des moines. Il accorde des dispenses de cet impôt à d'autres maisons du même périmètre.
Les moines, abbé en tête, prennent évidemment ombrage de la situation et vont plaider leur cause auprès de la princesse. Mais celle-ci est bien décidée à faire dresser un terrier du domaine royal qu'elle exploite, en y incluant une partie de la franchise des moines, notamment leur four et leur moulins banaux ainsi que la rivière d'Yèvre sur laquelle les moines avaient des droits.
Une commission devant le bailliage de Vierzon est alors mandée.
L'arpenteur Legendre dresse un plan selon les dires des deux parties (voir plan ci-dessous).
Les moines ont alors exhibé leur charte de 1182 mais sa véracité est contestée par les avocats de la princesse. L'argument est le suivant : Il ne peut s'agir que d'un faux puisqu'il en manque une partie : le protocole final (date, noms des témoins, signatures, sceaux).
De fait, cette partie a sans doute été abîmée et est effectivement manquante, ce qui désarçonne la plaidoirie des moines.
Il faut dire que l'avocat vierzonnais de la princesse n'est pas un inconnu. Il s'agit de Béchereau, avocat du roi, qui publie ses « mémoires sur Vierzon » en 1748, livre considéré comme le premier livre d'histoire sur Vierzon.
Les dix premières années du procès sont synonymes d'enquêtes, de contre enquêtes, de procédures et de recours variés qui allongent sa durée.
En 1742 une première transaction a lieu. Elle est au bénéfice de la princesse. Les moines doivent céder leur titre de possession sur la rivière d'Yèvre ainsi que leur droit de péage sur le pont d'Yèvre, selon la formule « condamnons les bénédictins à se défaire des rivières d'Yèvre et petit moulin au profit du roi ».
L'affaire n'en est pas restée là, les moines ont fait appel à la justice royale et la suite de la procédure se trouve aux archives nationales.
Malheureusement, la pièce maîtresse du procès y est manquante : le jugement final. En effet, ce procès n'est jamais allé jusqu'à son terme, les deux parties ont préféré transiger. La transaction se fait en présence des deux parties, le premier juillet 1745. Et il faut en rechercher le texte dans les archives de la maison de Conti.
Transaction négociée
« … entre très haute, très puissante et très excellente princesse Madame Louise Elisabeth de Bourbon, veuve de très haut, très puissant et très excellent prince monseigneur Louis Armand de Bourbon prince de Conti, demeurant à Paris en son hôtel, rue Saint Dominique, étant ce jour au château de Monseigneur le duc d'Orléans au château de Saint-Cloud d'une part, et Monsieur Jacques Nicolas Bernot de Charant, abbé commendataire de l'abbaye royale de Vierzon, chanoine de l'église de Bourges, y demeurant ordinairement, étant présentement à Paris logé à l'hôtel d'Auvergne quai des Augustins d'autre part : lesquels ont dit qu'il y a instance pendante et indécise depuis longtemps au bureau des finances de Berry, au sujet du droit de festage dû au roi en la ville et bailliage de Vierzon, et à Son Altesse Madame la princesse de Conti comme engagiste du domaine de Vierzon... »
La déclaration est très longue et se conclut par une volonté de transiger du fait que les droits réclamés par les deux parties « n'étaient pas assez considérables pour être mis en balance avec les frais d'opération qu'il conviendrait de faire pour éviter une plus ample contestation et terminer et assouplir ladite instance, ont transigé... »
De fait, la princesse et les moines trouvent un accord pour faire taire la querelle et éviter la poursuite d'un coûteux procès dont les frais sont plus élevés que les sommes en balance.
C'est là une vérité beaucoup plus grande pour les moines que pour la princesse qui a des moyens quasi illimités et qui pourrait poursuivre la procédure...
De là à dire que le père abbé Jacques de Charant a eu le bras tordu pour signer la transaction...
Elle se termine tout de même à l'avantage de la princesse. Pour arrêter la procédure, les moines devront s'acquitter d'une grosse somme d'argent en nature : « c'est asavoir au moyen de cent boisseaux de froment mesure de Vierzon, chacun pesant quinze livres »... payable chaque année par les moines à la Noël au château de Vierzon.
En échange de quoi le périmètre de la franchise saint Pierre n'est plus contesté par la princesse.
De cette transaction il résulte que la princesse a obtenu gain de cause, augmentant la rente vierzonnaise de ses possessions. Véritable femme d'affaire, c'est une fois devenue veuve de Conti qu'elle entreprend de reprendre tous les comptes du couple dont le mari ne s'occupait guère. C'est ainsi qu'elle lance ses avocats dans toutes ses possessions, multipliant les procès... qui aboutissent invariablement à une transaction à son avantage. Ainsi, toujours dans la baronnie de Vierzon elle va encore harceler le prieuré de Mennetou, lui aussi fondé par les seigneurs de Vierzon, et qui se voit contraint à son tour au même type de négociation pour échapper au procureur de la princesse...
Sources : Archives du Cher, H227
Images : Portrait de la princesse de Conti, par Gobert, BNF, Archives du Cher, Archives municipales Vierzon
29 décembre 1895. 33 premiers spectateurs assistent à la première projection mondiale d'images qui bougent. La sortie des ouvriers de l'usine Lumière et l'arroseur arrosé en seront deux films vedettes. Méliès achète aux frères Lumière un cinématographe, des kilomètres de pellicule et devient le premier auteur-scénariste-metteur en scène-gagman-inventeur d'effets spéciaux de l'histoire du cinéma.
Baraque foraine
L'engouement est rapide. Les saynètes comiques y sont pour beaucoup. Vierzon ne déroge pas. Le cinématographe est tombé sur la ville au tournant du XXe siècle. Sous la forme d'une baraque foraine installée sur le terrain vague de la Croix Blanche qui deviendra en 1905 place de la République (aujourd'hui square Péraudin).
Pathé et Gaumont sont des concurrents sérieux qui proposent chacun un nombre considérable de productions à l'année. Les cafés de la ville ont flairé le filon et seront les premiers à organiser des projections de façon pérenne. Les années 1910 ont alors vu la multiplication des séances de cinéma dans tous les quartiers de Vierzon. Dans une liste non exhaustive, on peut tout de même citer quelques lieux récurrents : le café Laroche à Vierzon Villages, Le Poisson frit rue Etienne Marcel, ou encore celui de la Noue en haut de l'avenue du 14 juillet.
Mais, de mémoire d'ancien vierzonnais, la salle emblématique de Vierzon fut celle des « Arts », à la Croix Blanche, tenue par les époux Toyot : Café, salle de concert, dancing et dorénavant séances de cinéma le dimanche après-midi. Les époux Toyot aménagent même une salle dédiée au cinéma à quelques dizaines de mètres des « Arts », rue Gourdon, dans un ancien hangar de l'usine Merlin (aujourd'hui parking en face le garage anciennement Renault). Ainsi naît le « Casino ». Nous sommes alors en 1909.
Le Carillon
Au 20 de la rue Gourdon, à deux pas du Casino, était un atelier de charronnage, appartenant aux frères Charles et Louis Lavezard. En 1926, il n'y a plus de débouchés pour les voitures à cheval. Les automobiles et camions sont les rois des routes.
Ils changent totalement de métier et décident d'ouvrir une salle de cinéma. Elle s'appellera le Carillon, avec une cloche comme enseigne. Il ne s'agissait pas de faire concurrence au Casino voisin, puisque leur décision a été prise alors que des bruits courraient que ce dernier allait fermer définitivement ses portes. Le Casino poursuivant, ce sont deux salles qui se sont côtoyées durant une trentaine d'années.
Un journaliste de l'époque écrivait en ces termes sur le nouveau cinéma ouvert le 30 octobre 1926 : « Bien installé avec ses boiseries de teinte claire, ses rampes d'ampoules électriques soulignant les grandes lignes du pourtour et du plafond, elle est la salle chic de Vierzon ».
Et qui de mieux qu'un ministre pour inaugurer cette salle ?
En fait, 1926 fut également l'année de l'électrification de la ligne de chemin de fer Paris – Vierzon.
Celle-ci fut inaugurée en grande pompe le 22 décembre 1926, à Vierzon, autour d'un banquet présidé par le ministre des Travaux publics André Tardieu, en compagnie d'un aréopage d'ingénieurs... et de tout le Gotha mondain, le maire Péraudin en tête. Et le banquet eut lieu au Carillon, transformé pour l'occasion en salle de restaurant (voir images ci-dessous).
Toujours dans le spectaculaire, le Carillon fidélisait ses spectateurs avec des événements d'ampleur. Le premier film projeté avait été un film muet de chez Pathé « Simone ». En avril 1927 c'est la Gaumont qui entre en scène. À l'occasion de la sortie du « Ben Hur » de Fred Niblo (qui durait la bagatelle de 3 heures), c'est le train routier de la Gaumont qui parade rue Gourdon offrant des objets publicitaires et des places gratuites au cinéma. Un journaliste relate même qu'un curé de campagne est venu « à bicyclette avec ses ouailles pour assister à une représentation qui montrait la vie édifiante des premiers chrétiens en butte aux persécutions païennes ».
Côté innovation technique, c'est également au Carillon que cela se passe. Il sera le premier cinéma équipé d'une double machinerie qui permettait ainsi d'éviter les arrêts en cours de film pour changer la bobine. Et il sera également le premier cinéma équipé parlant en 1931.
Changements de mains
Bientôt un troisième cinéma va ouvrir ses portes, derrière le garage Citroën de la rue de la République. Son propriétaire, Mangin, veut en faire le plus grand de Vierzon. Il portera le nom de Mac Nab et sera inauguré en juin 1940... par les troupes allemandes.
Mangin le cède à Lionel Bonnard en 1955, qui le revend à la ville en 1968. Les successeurs des frères Lavezard, deux dames, Guillaume et Lavezard, rachètent alors le fonds ciné du Mac Nab et s'occupent de la programmation de leur Carillon.
Ce dernier passe dans les mains de la famille Toyot en 1974. Les Toyot avaient fermé le Casino lorsqu'ils avaient créé le Miramar en 1951, futur France, avenue de la République. C'est ainsi que le Carillon changera de nom en 1976 pour prendre le nom de France 2.
Vingt ans et une crise du cinéma plus tard, le Carillon – France 2 ferme définitivement ses portes. Nous sommes en 1998. Il est sauvé de la démolition par un passionné qui le transforme en musée privé.
Aujourd'hui, quelques chanceux peuvent encore le visiter à l'occasion des journées du patrimoine, en septembre. Cela vaut le coup d'oeil, nous ne sommes pas loin de l'ambiance « Cinéma Paradiso »...
Après une journée de grève générale le 13 mai, les événements vont s’accélérer au niveau national et entraîner des répercussions à Vierzon.
Le 17 mai, le conflit étudiant se prolonge par un conflit ouvrier : Renault se met en grève, cette régie dont on dit que si elle tousse, c’est la France entière qui s'enrhume. Georges Pompidou, alors Premier Ministre, est obligé de lancer les négociations de Grenelle.
À Vierzon, les usines vont se mettre en grève les unes après les autres, entre le 18 et le 25 mai, non pas forcément pour approuver les revendications étudiantes mais bien pour manifester en faveur d’une hausse des salaires.
Le Berry Républicain devient ce jour-là le baromètre des usines en grève. La première à débrayer est Unelec (à 100%) le 18 mai. « Chez Nadella on a observé un mouvement d’une heure, la gare s’y prépare », annonce la presse.
La gare à la pointe de la contestation
Le lundi 20, le gros titre du BR est le suivant : « Occupée depuis samedi matin par les cheminots, la gare est devenue le bastion du mouvement social à Vierzon. A 8 heures du matin, les cheminots informaient Pierre Boué, chef de gare principal, qu’ils se mettaient en grève et qu’ils occupaient tous les locaux. » Plus aucun train ne sort de Vierzon. Le BR de signaler aussi qu’ « un drapeau rouge avec inscription révolution et liberté, flottait depuis samedi sur le clocheton du LTE. »
A noter que ce jour-là également Nançay est en grève : « Les personnels de l’observatoire de Meudon sont en grève. En conséquence, ils ont décidé de se réunir pour se consacrer à la remise en question des structures dans lesquelles ils vivent, et à travailler à leur remplacement. » En fin d’article : « Meeting du PC ce soir à l’auditorium. »
Cinq mille manifestants
21 mai : « Plus de cinq mille vierzonnais ont cessé le travail et occupé les usines. » S’ensuit la longue liste des grévistes. Les porcelainiers de la CNP ont fait savoir qu’ils rejoindront le mouvement un peu plus tard, tributaires qu’ils sont des fours qu’ils ne veulent pas saboter. Les municipaux se sont mis en grève, assurant un service minimum pour l’état civil. Seules les chambres froides de l’abattoir fonctionnent.
D’autres usines sont totalement fermées : Apia, Abex, Compagnie des compteurs, Unelec, Fulmen, Tréfilerie, Nadella, Paulstra, Tarc, Ruhlmann, Meubles Veillat, Case, Pierre Renaud, Biraghi-Entrepose. Les 22, 23 et 24 mai, la situation est quasi inchangée, des manifestations avec défilés ont lieu en ville.
Le 24, le BR note néanmoins que « le conseil municipal vote 100 000 francs pour les familles des travailleurs. » Le lendemain, samedi 25, un grand bal populaire et gratuit a lieu le soir sur la place de la Libération.
De plus, de nouveaux débrayages ont lieu : Pica, LBM, Ecimo, Robinetterie Bouttevin, Montjoie, Galopin, Nozal, dans les entreprises de confection. On note également « une heure de débrayage à l’hôpital. » L’article se conclut sur cette note : « 98% des vierzonnais sont en grève. »
La grève arrive à son maximum à Vierzon. Mardi 28 : « cinq mille personnes dans la rue, samedi. En signe de solidarité, les commerçants avaient baissé leur rideau. » Les porcelainiers ont ouvert des négociations avec la Chambre syndicale de la céramique présidée par Monsieur Taillemite. Les revendications portent sur un hausse des salaires de 2,30francs de l’heure.
Le 29 mai, la grève s’étend toujours, gagnant les ouvriers du bâtiment et même les artisans. C’est ce jour que le Général de Gaulle part à Baden-Baden, chercher le soutien de Massu. Revenu à Paris dès le lendemain, il lance son « je ne me retirerai pas », qui marque le début des contre-manifestations en sa faveur.
Inutile de dire qu’il n’y en aura pas à Vierzon. C’est également le 30 que le BR note que la commission paritaire de la porcelaine a échoué à Vierzon. Un petit article annonce déjà les futures reprises : « Parmi les grévistes vierzonnais, nombreux sont ceux qui en dehors des meetings et des piquets, se livrent aux travaux de jardinage. Aujourd’hui les jardins sont propres comme des sous neufs et les chômeurs ne savent plus que faire… Parmi les revendications, on va demander une ouverture anticipée de la pêche !, déclare un gréviste. »
Reprise dès le 04 juin
Le 04 juin sonne le début des reprises dans certains ateliers vierzonnais. Après s’être mises en grève les unes après les autres, les usines reprennent également à tour de rôle. Après les 5000 manifestants du 28 mai, ils ne sont plus que 2000 à manifester ce jour. Le 5 juin Dudéffant reprend, les PTT partiellement. Les cheminots poursuivent. Le 06, « la reprise s’accentue dans l’industrie privée, bien que de nombreuses usines soient toujours en grève. » Robinet reprend, suivie d’Apia, Veillat, Case, la Pointerie.
La SNCF a repris dans le chahut. Les cheminots sont furieux d’avoir fait dix-neuf jours de grève et de reprendre alors que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le 07, c’est au tour de Nadella, Fulmen, et Unelec de reprendre. Le 08 juin la céramique et deux usines de métallurgie restent seules en grève. Abex reprend le 10 ainsi que les céramistes. Le 12 juin les derniers enseignants et élèves ont repris le travail au LTE. Il faut dire que les examens approchent et que les étudiants ont toujours dit qu’ils ne souhaitaient pas boycotter les concours d’entrée dans les grandes écoles.
C’est comme cela donc que ce sont déroulés les événements à Vierzon. Au-delà de cette date du 12 juin, les pages locales du BR seront à nouveau consacrées à de l’actualité moins contestataire. Pour preuve, dès le 13 juin, la une de la page Vierzon est consacrée aux fêtes de Thénioux. Et cette année-là, la vedette en a été Claude François. Sa photo occupe toute la tête de page...
Source : Le Berry Républicain, avril, mai, juin 1968
Images : Archives municipales Vierzon
A l’heure où certains philosophes et hommes politiques conservateurs accusent une génération entière d’avoir spoliée la suivante, il est bon de revenir sur les événements qui ont marqué mai 1968 à Vierzon, ce joli mois de mai qui fleure bon le muguet et le pavé.
Les premières remises en cause du gouvernement De Gaulle apparaissent lors de son second septennat. C’en est fini du consensus lié à la Guerre d’Algérie. Dès l’élection de 1965, Mitterrand le met en ballottage, chose impensable quelques semaines auparavant. La crise la plus grave dont il aura à faire face sera celle de Mai 1968 qui débute au sein de l’Université. Depuis le baby-boom des années 1945, le nombre des étudiants ne cesse de croître dans des locaux de plus en plus exigus.
Les événements commencent le 03 mai. Un meeting des étudiants interdit à Nanterre se tient alors à la Sorbonne. La police intervient, ce qui pousse les syndicats étudiants (UNEF) et enseignants (SNESUP) à lancer un mot d’ordre de grève.
C’est dans le BR des mois de mai et juin 1968 que nous allons voir comment est perçue la crise dans la seconde ville du Cher.
Sous les pavés la plage
La une du BR couvre bien les manifestations mais aucune répercussion n’est à signaler à Vierzon. Le 07 mai il est fait état de barricades, de pavés arrachés, de voitures incendiées, premiers « débordements » des manifestations étudiantes à Paris. C’est l’engrenage, la Sorbonne est bouclée. Le 11, ce sont vingt mille manifestants qui défilent à Paris. « Les 19 ponts de la Seine sont bloqués par le service d’ordre », ajoute le journal.
Suite à la répression de cette manifestation, les différentes centrales syndicales mobilisent leurs adhérents pour une grève générale le 13 mai.
C’est ainsi que le événements apparaissent pour la première fois dans la page Vierzon, le lundi 13 mai au matin. « Pour suivre les manifestants un peu partout, les étudiants de Vierzon ont décidé de répondre au mot d’ordre de l’UNEF. » Ce ne seront pas les seuls à défiler. Samedi soir, un mot d’ordre CGT et CFDT a été lancé pour la grève générale du 13 mai. Le BR rajoute : « Hier dimanche, un meeting a eu lieu à la bourse du travail appelant toutes les entreprises et administrations à la grève générale, pour la liberté et la démocratie, contre la répression. Une grande manifestation est prévue ce matin place de la Résistance, à 10 heures, après que le défilé partant du lycée Henri Brisson soit arrivé sur place. »
Le BR revient sur cette journée dans son édition du 15 : « Un long cortège d’étudiants et d’ouvriers a manifesté lundi dans le cadre de la journée de grève générale. Cette foule (NDLR 2000 selon le BR) est descendue jusqu’à l’auditorium au son de « Peyrefitte démission » ou encore « amnistie » pour écouter des orateurs qui ne sont autres que les représentants locaux des syndicats assistés des élus locaux messieurs Mérigot, Micouraud, Luberne, Patron et Rimbault. Les syndicats ont signé une résolution tendant à dénoncer « les brutalités inouïes dont ont été victimes les étudiants et enseignants. »
Des grèves bien suivies
A Vierzon, les grèves ont été bien suivies. Au lycée, seuls les internes ont été pris en charge. Aux PTT, on ne signalait pas grande perturbation, la distribution du courrier étant normalement assurée. Au téléphone toutes les communications ont été assurées. A la SNCF la grève perturba considérablement le trafic. Sur les quais comme dans le dépôt l’activité fut très réduite tout au long de la journée. A EDF, participation très importante « mais les services de sécurité furent assurés » peut-on lire dans le BR.
Et le journal ajoutait : « Toutefois, les coupures eurent lieu tout au long de la journée ce qui entraîna la fermeture de la quasi totalité de nos usines en ce lundi. Ce premier jour de la semaine est en principe réservé à la lessive par les maîtresses de maison mais les machines à laver restèrent muettes. Au cours de l’après-midi la lumière fut rendue. »
Les ouvriers ont donc repris le travail le 14 mai. Les concernant le BR notait : « Le beau temps aidant, les ouvriers en grève (volontaire ou forcée) se rendirent dans leur jardin voulant profiter aussi pleinement que possible de cette belle journée. » Les étudiants, eux, ne sont pas retournés en cours le lendemain. L’association du supérieur technique de Vierzon poursuit ses manifestations et sa grève devient, de ce jour, illimitée...
Source : Berry Républicain, avril, mai, juin 1968
Depuis une loi de 1954, une Journée de la Déportation est instaurée en France, le dernier dimanche d'avril. Elle permet de commémorer la mémoire des victimes déportées dans les camps de concentration nazis. Et cette date de fin avril correspond à la libération de ces camps par les troupes soviétiques et américaines.
Aujourd'hui les déportés ne sont plus présents pour témoigner. Témoigner pour eux mais aussi pour ceux qui ne sont pas revenus. Seules les familles peuvent encore tenter de raconter...
Au nombre des personnes non rentrées figure madame Marie Juliette Mersey, disparue – officiellement du moins – le 21 octobre 1943 à Ravensbruck, arrêtée pour avoir favoriser les passages sur la Ligne de Démarcation.
Les informations sur son parcours sont minces. Seul existe un court article paru dans la presse en 1948, intitulé « Mademoiselle Mersey, infirmière au grand cœur ». C'était là un point de départ pour reconstituer ses principales activités de Passeur.
Marie Juliette Mersey est née en 1885 à Vierzon Villages et débute sa carrière au bureau de bienfaisance de Vierzon avant d'intégrer le comité municipal d'hygiène qui en dépend, créé par le maire Péraudin. Durant la Première Guerre Mondiale, elle devient bénévole à l'hôpital de Vierzon. Les trois hôpitaux temporaires, l'hôpital municipal et le centre de tri en gare de Vierzon étaient en effet demandeurs de main-d’œuvre et beaucoup de dames de Vierzon se sont retrouvées infirmières de fait, apprenant le métier au jour le jour. C'était le cas de Marie Juliette Mersey qui avait eu un embryon de formation médicale au comité d'hygiène.
Lorsque la Deuxième Guerre a débuté, elle a repris son activité d'infirmière. Les pilonnages de la Luftwaffe allemande des 15 et 17 juin, furent meurtriers en ville. Les derniers combats pour la défense de Vierzon les 18 et 19, également. Marie Juliette Mersey, avec l'ambulance municipale, allait alors dans les rues relever les corps pour les entreposer à la morgue.
Sitôt la Ligne de Démarcation mise en place, fin juin 1940, elle entreprit d'organiser les passages clandestins. Le quartier de Bourgneuf, en zone libre, ouvrit un centre pour les réfugiés, salle Collier. Il lui permettait d'avoir une bonne raison d'effectuer de nombreux aller-retours quotidiens en zone libre, allant soigner les malades de passage. Déjà elle cachait une activité annexe : le passage de prisonniers français évadés.
Sur cette activité clandestine, elle n'a jamais parlé à qui que ce soit. La filière qu'elle a eue l'idée de créer est connue grâce aux personnes qui y ont participé : le notaire Garapin, le verrier Thouvenin, mais aussi et surtout les docteurs Szumlanski, Mérigot, et Cliquet. Ce dernier faisait partie du réseau belge des passeurs « Pat'O Leary », réseau qui utilisait – entre autres – les stratagèmes de Madame Mersey.
Son principal stratagème est lié à sa fonction d'infirmière. Elle utilisait l'ambulance municipale pour évacuer des faux blessés convalescents en zone libre. Elle les badigeonnait de mercurochrome, de bandages et pansements divers avant de les allonger sur la civière de l'ambulance et de passer la ligne ainsi. Elle allait jusqu'à sermonner les douaniers allemands s'ils prenaient un peu trop de temps à vouloir inspecter le blessé ou regarder de trop près les vrais-faux ausweis. L'article de journal raconte qu'une fois elle était assise sur un coffret de 76 vraies-fausses cartes d'identité lorsque les douaniers ont eu l'idée de fouiller l'ambulance. Elle n'a pas bougé d'un poil, gardant tout son sang froid.
Une autre tactique était le transport de malades soi-disant contagieux. Les Allemands ayant peur de la contagion, le passage de la Ligne était en général plus vite expédié.
Les blessés et malades recouvraient rapidement la santé après le passage clandestin. En effet, elle habitait en zone libre, en bas de l'avenue du 14 juillet. Elle permettait aux clandestins de prendre du repos, un repas, de se laver et se changer avant de reprendre la route pour le Sud.
Ce stratagème de l'ambulance n'était pas le seul utilisé par « l'infirmière au grand cœur ». La famille avait été mise à contribution. Le Père Mersey habitait en zone occupée et avait pour habitude recevoir ses petits enfants pendant les vacances. Le petit-fils, aujourd'hui âgé, se remémore aujourd'hui la scène suivante.
Mais il faut d'abord savoir que la frontière zone libre / zone occupée était matérialisée par des barricades en bois. Si les échanges verbaux, entre les familles séparées par exemple, étaient tolérés des Allemands, le franchissement était strictement interdit.
Le frère et la sœur sont en vacances chez les grands-parents Mersey, rue du cavalier. Un jour ils sont envoyés chez la cousine, avenue du 14 juillet. La cousine les emmène le long des barricades. Ils ont la surprise de voir arriver leur grand-père accompagné de deux enfants, fille et garçon, de l'autre côté de la barricade. La conversation s'engage. D'un seul coup les deux enfants sont violemment poussés par la cousine sous la barricade pendant que le grand-père faisait de même de l'autre côté.
Le petit-fils se demande toujours aujourd'hui qui pouvaient être ces deux enfants qui étaient du même âge que lui et sa sœur. Il imagine des enfants de « personnalités » ou encore juifs...
Marie Juliette, Claire dans la Résistance, exercera son activité de Passeur durant tout le temps de l'existence de Ligne de Démarcation, jusqu'au 31 mars 1943. À cette date, la gestapo arrête un Anglais avec un papier plié dans sa poche. Sur le papier, le nom et l'adresse de Marie Juliette. La gestapo vient l'arrêter chez elle avenue du 14 juillet.
Elle est rapidement transférée à la prison de Fresnes, puis déportée en Allemagne. Elle est officiellement décédée à Ravensbruck le 21 octobre 1943, à l'âge de 58 ans.
Les dernières nouvelles reçues par sa famille sont un mot qu'elle a pu faire passer à son frère alors qu'elle était à Fresnes. Il était écrit : « Ne vous en faites pas pour moi. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop d'ennuis à mon sujet. Je m'en excuse ».
Images : Le Berry Républicain - Archives municipales Vierzon
Dans l'arrondissement de Gien, sur le bord de la Loire, il existe un petit prieuré dédié à Saint Gondon (Gondulfus). Cet établissement sera l'objet d'une querelle, au 11e siècle, entre deux abbayes : Saint Pierre de Vierzon et Saint Florent près Saumur.
Le petit prieuré des bords de Loire a été érigé dès le VIe siècle autour du tombeau de Gondon, évêque lombard qui avait fui les persécutions de la secte des ariens. Ayant rapidement adopté la règle de Colomban puis de Benoît, le prieuré fut officiellement donné aux moines de Saint Florent du Montglonne près Saumur. Nous sommes en 866 et cette donation est faite par le roi Charles le Chauve, petit fils de Charlemagne. Les moines de Saumur doivent pouvoir s'y installer et y transporter les reliques de Saint Florent après que leur abbaye du Montglonne ait été détruite par les Normands.
Il est bon de rappeler que la même mésaventure est arrivée aux moines de Vierzon. Quelques 20 ans auparavant, en 843, ce même roi de la Francia Occidentalis fondait une abbaye bénédictine à Dèvres (Saint Georges sur la Prée). Cette dernière s'était alors transportée en 903 à Vierzon, les moines ayant fui devant les Normands.
Comment ce monastère est-il tombé entre les mains des moines de Vierzon ? C'est une charte du cartulaire de Vierzon qui va nous renseigner sur l'évolution de la propriété de Saint Gondon durant le siècle précédent.
On y apprend que Louis, fils de Charles III le Simple est moine de Saint Gondon. À son accession au trône de France sous le nom de Louis IV d'Outre-mer en 946, il donne l'abbaye à Geoffroy, vicomte de Bourges. La suite, c'est la charte qui nous le raconte :
« Geoffroy dit Papabos aïeul de notre père Geoffroy, avait reçu en alleu cette abbaye de son seigneur Louis Roi de France. Il la laissa en mourant à son fils Geoffroy dit Bosberas, lequel à son tour la transmit à son fils Geoffroy le Noble, d'où par héritage elle échut à mon père Geoffroy le Méshin, puis à moi (Etienne vicomte de Bourges) ».
Cette charte date de 1082. Outre l'origine de propriété, elle mentionne la donation du prieuré de Saint Gondon aux moines de Saint Pierre de Vierzon par Etienne vicomte de Bourges.
Cela fait donc un siècle que les moines de Saint Florent près Saumur n'ont plus la jouissance des biens de leur prieuré de Saint Gondon qui est tombée entre les mains de la vicomté de Bourges.
En 1082, le cartulaire de Vierzon mentionne un autre puissant du royaume, qui témoigne et confirme la donation à Vierzon. C'est Gilon de Sully, gendre de Etienne. Ce personnage est d'autant plus important qu'il aura un rôle déterminant pour la suite des événements.
La charte suivante du cartulaire de Vierzon (non datée mais certainement de 1088 ou 1089), est la confirmation de la donation par l'héritier de Etienne, Eudes Arpin, vicomte de Bourges. Humbaud abbé de Vierzon se voit confirmé dans cette possession, à charge pour lui d'inclure Arpin dans les prières qu'il doit déjà faire pour le repos de l'âme de son oncle Étienne.
Mais la suite de l'histoire est à rechercher non plus dans le cartulaire de Vierzon mais dans celui de Saint Florent près Saumur. Le moine Louis devenant roi de France en 946 avait-il le droit de donner le prieuré au vicomte de Bourges ?
Huit chartes du « Livre Noir » de Saumur, datées de 946 à 1082 mentionnent des tentatives pour les moines de Saumur de se voir reconnus les vrais propriétaires de Saint Gondon.
Bien qu'ayant exhibé leur acte fondateur signé Charles le Chauve fondant le prieuré pour les moines de Saumur, le pape tergiverse, tant il est vrai qu'il n'est pas facile d'aller contre la volonté royale.
La donne change en 1082. Il n'est plus question de plaider contre la volonté de Louis IV roi de France mais de plaider contre une autre abbaye. Saint Florent de Saumur va alors aller en justice contre Saint Pierre de Vierzon.
Et l'archevêque de Bourges en sera l'arbitre.
Trois chartes de Saumur montrent l'accord passé entre ceux de Saumur et ceux de Vierzon. L'accord sera également transcrit dans le cartulaire de Vierzon, dans sa charte numéro 65.
Saumur abandonne totalement ses prétentions sur Saint Gondon, reconnaissant que les moines de Vierzon ont beaucoup investi pour remettre le prieuré en état. Néanmoins, les moines de Vierzon devront acquitter à perpétuité une rente de 2 onces d'or « bon et légitime » à ceux de Saumur tous les 6 mai, fête de saint Florent, « en reconnaissance de leurs anciens droits ».
Il est précisé que si les moines de Vierzon « manquent à cette convention et s'ils négligent d'en remplir les conditions, alors les moines de Saint Florent rentreront dans leurs droits et récupéreront ledit monastère avec ce qui en dépend, tandis que les moines de Vierzon n'auront plus rien à y prétendre. »
Cet accord fut ratifié trois fois en janvier 1095 : une fois devant l'archevêque de Bourges, une fois devant le chapitre de Saint Pierre de Vierzon et une dernière fois devant le chapitre de Saint Florent de Saumur.
Pourtant les choses n'en sont pas restées là. Mais le cartulaire de Vierzon ne mentionne aucune suite. Il faut la chercher à Saumur.
Dès la première année les moines de Vierzon n'ont pas donné leur 2 onces d'or (50 grammes environ) à ceux de Saumur. Les chartes de Saumur montrent une tentative de médiation, donnant un délai de paiement à Vierzon pour rassembler cet or.
La médiation échoue, Vierzon refuse (ne peut pas?) payer.
Les moines de Saumur font alors appel à Gilon de Sully pour récupérer Saint Gondon. Rappelons que Gilon est le gendre d'Etienne de Bourges, témoin de la donation de 1082.
Gilon de Sully est un personnage important de par la situation géographique de sa seigneurie qui englobe Saint Gondon.
Après avoir assisté à la donation de son beau père aux moines de Vierzon, Sully devient le principal acteur de la restitution à Saumur.
Dans les chartes qui narrent cette restitution, il n'est plus question du vicomte de Bourges, comme si Eudes Arpin avait disparu. Nous ne saurons donc jamais quelle fut sa position vis à vis des moines de Vierzon, ses protégés.
De fait, Vierzon ne paye pas à Saumur ses deux onces d'or. Saumur prend à témoin Gilon de Sully qui prend fait et cause pour Saumur et atteste de la rupture de contrat entre les deux abbayes. Mieux, c'est Gilon de Sully qui restitue Saint Gondon à Saumur dès juillet 1095. Et il promet qu'il intercédera auprès de l'archevêque de Bourges en leur faveur.
On apprendra tout de même que Sully a obtenu de Saumur la modique somme de mille sous en or (4,5kg), en échange de la restitution de Saint Gondon.
Gilon a tenu parole et a plaidé leur cause auprès de l'archevêque de Bourges.
Après une dernière tentative de se voir confirmer la possession de Saint Gondon en 1099 devant la juridiction archiépiscopale de Bourges, Herbert, abbé de Vierzon, doit contresigner la charte de Saumur, acceptant la restitution à Saumur...
Images : Bibliothèque Nationale : Mns lat 9865.
Une transcription latine existe : Guy Devailly, Le cartulaire de Vierzon, Paris, 1963
La traduction en français reste à faire.
Une rue à Vierzon porte son nom depuis 1892.
Mais au fil des ans les mémoires s'estompent, les vierzonnais ont oublié qui était ce personnage – Armand Brunet – qui a donné son nom à la rue vierzonnaise où il demeurait.
Sur certaines cartes postales anciennes des années 1900 il existe deux maisons accolées dans cette rue appelées « les maisons Brunet », résidence de la famille du même nom depuis la Révolution Française. Mais l'une d'elle a été détruite en 1905 et la maison subsistant a toujours coutume d'être appelée – à tort – « la maison de Jeanne d'Arc ».
Si Jeanne est plausiblement passée par Vierzon en 1429, une erreur de localisation a fait de cette maison celle où elle aurait passé la nuit.
Il est plus vraisemblable que Jeanne d'Arc se soit arrêtée à l'auberge de « la Madeleine », deux maisons plus loin, intramuros, sur la route de Bourges.
La principale maison Brunet encore visible aujourd'hui porte le vrai nom de « maison des vicaires ». Et c'est sous ce nom qu'elle apparaît sur un plan du XVIIe siècle.
Les vicaires qui desservent les différentes chapelles de l'église Notre Dame sont, dans les faits, inféodés aux moines bénédictins de Saint Pierre dont l'abbaye est toute proche (hôtel de ville). À ce titre les moines les logent dans une maison leur appartenant, moyennant un loyer pris sur les revenus des vicairies.
La Révolution Française a autorisé le changement de main de toutes les propriétés de l'abbaye lors de la vente des biens du clergé comme Biens Nationaux, entre 1791-1793.
C'est alors que rentre en piste les ancêtres d'Armand Brunet, par ailleurs connus à Vierzon : les Gourdon, dont un membre de la famille a lui aussi donné son nom à une rue. Bourgeois, commerçants ayant acquis la noblesse de robe, ils ont donné de nombreux officiers à la ville, dont la maîtrise des eaux et forêts.
René Gourdon de Sigougnol, premier acquéreur de la maison, est mort peu de temps après, laissant la succession à ses trois enfants, dont sa fille mariée à un Grillon d'Anvault.
La maison sera dorénavant appelée Grillon d'Anvault jusqu'en 1870 où une nouvelle branche s'y installera : les Brunet d'Anvaut.
L'aîné, Armand Brunet – notre Armand Brunet – rachète à ses frères et sœur leur part sur la maison et en devient l'unique propriétaire. Très conservateur, soucieux de maintenir les lieux à l'identique des décennies précédentes, il ne pourra tout de même pas aller contre la dispersion du mobilier, « chacun voulant sa part ».
Du mobilier fastueux des Grillon d'Anvault, il ne restait plus grand chose en 1870. Armand Brunet parle même d'un « mobilier vieux et presque inserviable ». Quant à la maison dont on sait qu'elle avait « été remise en état en 1805 », Brunet la décrit en ces termes : « la décrépitude du bâtiment devient plus sensible. C'est maintenant un vénérable souvenir ».
Armand a reçu une stricte éducation religieuse chez les Jésuites. Son testament soulignera sa religiosité. Puis en grandissant il devient magistrat, gravissant tous les échelons, avocat, etc... avant de finir sa carrière dans la peu d'un conseiller de la Cour de Bourges.
Par contre il ne fallait pas lui parler finances. La tradition familiale montre un homme qui ne tenait jamais ses comptes, qui oubliait même les placements, souvent aléatoires, qu'il avait pu faire ; ses héritiers retrouveront même un gestionnaire de biens dont Brunet avait oublié jusqu'à l'existence.
Lorsque Armand meurt en 1892, il fait une donation à l'abbé Bedu, curé de Notre Dame, pour qu'il restaure la chapelle Sainte Perpétue. En souvenir de cette donation, Bedu fait graver les armoiries
des Brunet sur une colonne de la chapelle, à un tout petit détail près...
Armand brunet s'était fait faire des armoiries spécifiques, confirmées par d'Hozier ; il s'agissait d'une tête de Maure pour rappeler ce nom de Brunet.
Mais nous sommes en 1892, en plein colonialisme chrétien. Et pour Bedu il est impensable de mettre la tête d'un Noir, d'un sauvage, sur une colonne. Ni une ni deux, il a blanchi la tête pour la rendre plus présentable en cette période...
Mais Brunet lègue la quasi totalité de sa fortune à l'hôpital et c'est ce don qui va déclencher la dénomination d'une « rue Armand Brunet », ex rue Saint Pierre.
En effet il donne une importante somme d'argent afin que l'hôpital érige un nouveau bâtiment qui sera chargé de soigner les vieillards. Il donne également une rente afin d'entretenir douze lits. Au dessus de cette nouvelle salle, il y avait le souvenir de la donation dans un cartouche : « fondation de monsieur Armand Brunet, en souvenir des familles Gourdon, Grillon d'Anvault, Brunet ».
Mais son éducation religieuse ressort. L'hôpital devra créer un oratoire pour les religieuses chargées des soins aux malades. Elles devront dire une messe annuelle « récitée à haute voix » par les religieuses. Et si une jour l'hôpital venait à être laïcisé, le legs n'aurait plus cours et la rente reviendrait aux héritiers Brunet.
Quant à Armand lui-même, sa dernière volonté fut de léguer son corps à la médecine « pour telles expériences que bon lui semblera ». A charge ensuite pour sa famille de larguer le corps en pleine mer. Cette dernière partie des volontés du défunt ne fut pas exécutée...
Images : Archives municipales Vierzon
Décidément, le tribunal de bailliage est une source inépuisable pour connaître le quotidien de nos ancêtres vierzonnais sous l'Ancien Régime, du 16e siècle à la Révolution.
Retour aujourd'hui sur une histoire de gros sous, un héritage entre le bourgeois Nicolas Agard, sa fille et son gendre honni.
Avant ce mois de juillet 1607, nous ne savons pas où habitait la famille de Nicolas Agard. Mais nous savons par les archives que cette famille a donné bon nombres d’officiers municipaux aux 15e et 16e siècles, des grènetiers à sel, des échevins, même des baillis. Grâce à son frère Clément « bourgeois en cette ville », nous savons que les Agard sont venus se retirer dans le lieu qui leur appartient, le « lieu des Roziers », en juillet 1607.
Clément donne les raisons de ce déménagement au bailli. Il explique que Nicolas et sa famille étaient sur leur terre (il n’est pas précisé où) mais qu’ils sont venus aux Roziers « à cause de la contagion qui estoit lors en cette ville (une épidémie de peste noire a lieu à Vierzon en 1607) ».
Nicolas, certainement déjà atteint, va trouver son frère « et lui met entre ses mains un parchemin clos, scellé du sceau dudit Agard, le priant le conserver jusqu’à son décès si Dieu faisait son commandement de lui, lui disant que c’était son testament et ordonnance de dernière volonté lequel il aurait écrit et signé de sa main et voulait qu’il fût exécuté de point en point selon sa forme et teneur. »
Mort de contagion
Nous sommes le 28 juillet et Nicolas Agard est mort hier « en cette ville de la dite maladie contagieuse. » Clément a mis le testament entre les mains du bailli, chargé de l’ouvrir et de s’assurer que le parchemin n’a pas été descellé : « le parchemin scellé en la même forme et au même état qui lui a été mis entre les mains par le défunt, jurant et affirmant qu’il n’a été ouvert ni vu par aucune personne que ce soit. Nous a requis ouverture être présentement faite pour en être judiciairement fait lecture et être enregistré au registre de notre greffe pour y avoir recours et servir à qui il appartiendra. »
Le bailli décachette donc le parchemin et en fait lecture devant Etienne Rousseau, Pierre Agard et Jacques Simon, héritiers présumés. Aucun n’a fait de commentaire à la lecture sauf Etienne Rousseau qui a protesté, a dit « que le testament est nul et veut le faire déclarer nul en temps et lieu. »
Pourquoi cette colère ? Suivons la teneur des dernières volontés du défunt.
« J’entends que Nicolas Agard mon fils ait la moitié de la métairie des oliviers comme elle m’est advenue et partage avec mes enfants les meubles qui sont dedans. Je veux pour récompenser Pierre Agard Catherine Agard et Nicolas Agard qu’ils prennent tous trois la somme de 1500 livres. Idem veux et entends que ma servante Nicolle aye une maison qui est au dedans de la montagne du cloux du roy sa vie durant et que on lui paye ses services honnestement ».
« le testament est nul ! »
L’affaire se corse lorsque Nicolas Agard écrit sur le procureur du roi (officier de bailliage), son gendre. Il commence par sa servante, voulant « que personne n’aille point la tourmenter d’autant que le procureur du roi la menace de la ruine. »
De poursuivre par ses dernières volontés concernant sa fille Marie Agard et le procureur du roi : « que le procureur du roi, mari de ma fille Marie Agard prenne aucune chose ».
On l’aura compris, son gendre n’est autre qu’Etienne Rousseau, le procureur du roi en poste au bailliage de Vierzon depuis 1598 et qui le restera jusqu’en 1616, date présumée de sa mort.
Mais pourquoi Nicolas Agard a-t-il une dent contre son gendre ? Il s’en explique dans les lignes qui suivent. « D’autant que lui et ma fille Marie m’ont fait des menaces de me ruiner même que le procureur m’a dit des injures au mitan des barres de cette ville (?) et a voulu vendre mes enfants. » S’ensuit une longue litanie sur les actions de son gendre. Il décrit également qu’il a déjà plaidé contre lui mais qu’entre gens de justice ils se sont entendus. Il poursuit : « tous les commis de justice étant pareils, il vaut mieux noyer ses filles que de les donner à de tels gens. » On voit tout le mal que pense Nicolas de son gendre et regrette de lui avoir donné la main de sa fille.
Par contre il ne se fait pas d’illusion sur ses volontés et prévoie déjà que le testament sera attaqué : « Si la dite Marie Agard et son mari veulent plaider, je veux qu’ils n’ayent que sa légitime portion de ce qui leur appartient de droit et leur défend de mettre la main sur mes papiers d’autant qu’il est à redouter, attendu que les quittances sont dedans mes coffres. »
Le testament se termine sur une légitimation de sa position : « Je veux que on croit que ce que je dis est vérité. Il faut reconnaître les bons et les mauvais. J’ai gouverné ma vie avec honneur et ce serait injuste de donner aux mauvais comme aux bons et vous assure de la justice que ce que je donne à mes enfants est pour les bons et agréables services qu’ils m’ont faits et est ceci mes dernières volontés. »
Image : Archives municipales Vierzon
La maison des Roziers jouxtait le côté extérieur du mur de la ville, sur la route de Bourges, juste à la sortie de la porte de la Rivière ; aujourd'hui rue Armand Brunet.
Sur la carte postale ci-dessous, elle se situe à l'extrémité droite, après la maison où se trouve la tour.
On a pris l'habitude de dire que la ville de Vierzon est aussi étendue que Paris intramuros. De périf Est à périf Ouest, il faut 10 kilomètres pour traverser la capitale ; autant pour traverser Vierzon, du Coq gaulois au Village Aubry.
Dans une ville aussi étendue, les distances deviennent problématiques entre les sites de production et les lieux de l'habitat ouvrier.
Dans notre ville, les transports en commun voient le jour au tournant du 20e siècle avec le « Tacot », ce petit chemin de fer départemental d'abord destiné au transport de marchandises vers les cantons qui ne possédaient pas de gare du Paris-Orléans.
La Compagnie des tramways de l'Indre gérait depuis 1903 la ligne Vierzon – Vatan – Issoudun. Le bureau terminus était face à la gare, entre l'hôtel de Bordeaux et le hall de la Société Française.
Dans les années 1910, l'automobile s'installe en France, deuxième pays producteur. De nouveaux véhicules voient également le jour : le camion et le car, boostés par la Première Guerre Mondiale, dont les demandes vers ce type de véhicules vont croissant. C'est même la multiplication des camions et des cars sur les routes de l'entre-deux guerres qui sonnera la glas du tacot.
En attendant, à Vierzon, tous les moyens sont bons pour raccourcir les distances, grâce au vélo, tout d'abord. Mais c'est un moyen de locomotion encore onéreux au sortir de 1918. Toutes les familles ne peuvent pas se le permettre.
Quant au tacot, il relie les quartiers de Bourgneuf à la gare par la rue des ponts et la rue de la République. Mais les autres quartiers (communes) ne sont pas desservis, notamment les Forges.
Il existera bien un deuxième tronçon de Vierzon Villages (place du tacot) à Neuilly-en-Sancerre par les Forges mais la ligne arrivera tardivement (1923) et le tracé ne sera même pas totalement achevé dans les campagnes.
C'est la municipalité de Maurice Nivet à Vierzon Forges qui va être à l'origine de la première ligne d'autobus public. Il s'agit de relier la gare à Vierzon Forges, 8 fois par jour. Le service est concédé à Vallin, garagiste à Vierzon Vierzon Ville (concessionnaire Citroën), à partir du 15 juin 1926.
Les arrêts sont alors : les Bourbiers, Village Aubry, en face de chez Moreau (?), les grands moulins, le petit Paris, la gare. Pour la totalité du trajet, comptez 20 minutes et 1,25franc, soit 25 centimes d'un arrêt à l'autre.
C'est tout de suite le succès mais il y a un hic. Vallin ne possédant pas d'autobus, il en a acheté un. Il coûte cher en prix de revient et la municipalité pense à acheter son propre autobus. Des subventions sont recherchées auprès de la municipalité de Vierzon Ville mais aussi des industriels qui pourraient mettre la main au porte-monnaie.
En 1928, Maurice Nivet a pris des renseignements auprès de la commune de Colombelle, dans le Calvados. Cette dernière exploite le service d' »autobus en régis municipale et en est fort satisfaite. C'est dans cette direction que souhaite se diriger la commune de Vierzon Forges. Le maire signale également que, vu le succès du service, il ne faut absolument pas qu'il soit interrompu. Cela implique qu'il faut qu'il y ait un autobus de secours dans le garage municipal.
Dans sa séance d'octobre 1928, le conseil municipal acte la création de la régie municipale de l'autobus et son budget. Le conseil acte également l'achat d'un autobus neuf. Enfin il sera demandé combien Vallin consentirait à revendre son autobus à la ville, autobus qui servirait d'autobus de secours.
C'est ainsi qu'en mars 1929 la municipalité de Vierzon Forges se voit propriétaire de deux autobus : le vieux Latil de Vallin mais aussi un Saurer tout neuf qui assurera le service.
Jusqu'à la réunification de 1937, le service en restera là. Il n'y aura jamais qu'une seule ligne, les Forges – la gare.
Lorsque Georges Rousseau est élu maire du Grand Vierzon, des discussions ont eu lieu au sein du conseil pour élargir le réseau. Un deuxième autobus – d'occasion – avait même été acheté. Mais la guerre a enterré ce projet comme tant d'autres.
L'élargissement du réseau se fera en 1947, sous le municipal Maurice Caron. Une deuxième ligne est créée, Bourgneuf – Saint Martin. Et quatre cars assurent le service quotidien.
Après 1959, le service de car évoluera en fonction de l'avancée des travaux dans les quartiers nouvellement urbanisés (Colombier, Sellier, Clos du Roy, Chaillot...)
Le service actuel avec ses trois lignes est arrivé après mai 1968, remanié en 1979.
Ligne 1 (noire) : ZI les Forges – Giraudière
Ligne 2 (verte) : Chaillot – Sellier – Rond Point Coop
Ligne 3 (rouge) : Les Bruyères – Rond Point Coop
Ligne 4 (bleue) : Croix moreau – Bois d'Yèvre – Forges ZI (par intermittence)
En 1984 et pour se mettre en conformité avec la loi, le service doit être concédé. Des entreprises sont contactées. C'est la CGE Automobiles qui est choisie.
Et dorénavant le réseau s'appellera TUV, Transports Urbains Vierzonnais.
Puis Bus Vallée...
Enfin le VIB'...
Images : Archives municipales Vierzon
Depuis les Guerres Puniques, 166 av JC, Carthage est soumise à l’autorité romaine et devient une province de l’Empire, la province d’Afrique.
L’Empire Romain est caractérisé par une religion officiellement panthéiste. La religion du Christ se développe depuis la Palestine jusqu’en Afrique par l’Egypte, et jusqu’en Europe par la Grèce.
Il faut attendre 313 et l’empereur Constantin pour que la religion chrétienne soit autorisée.
Aux premier et deuxième siècles, les premiers chrétiens sont des chrétiens qui se terrent, pratiquant leur religion dans les caves des centres urbains. Au nom du Dieu unique ils ne reconnaissent pas la personnalité divine de l’Empereur. Les premiers chrétiens sont donc persécutés pour ne pas reconnaître la personnalité divine de l’Empereur, véritable dieu sur terre, accusés de vouloir déstabiliser l’Etat.
Carthage
A Carthage, une communauté chrétienne survit tant bien que mal. Cette province d’Afrique et sa capitale sont entrées dans le giron romain après les Guerres Puniques (166 av JC).Des autels sont érigés chez des particuliers. Ils déménagent sans cesse dans un macabre jeu du chat et de la souris.
Dans ce contexte, Perpétue est une jeune fille d’une famille de la noblesse locale. Convertie au christianisme par son confesseur Satur, elle entraîne également sa servante : Félicitée.
En 203, les chrétiens sont martyrisés dans le cirque de Carthage. Le père de Perpétue, ayant des fonctions administratives importantes ne fera rien pour sauver sa fille.
Perpétue, Félicitée, Satur, ainsi que d’autres chrétiens sont tués par le piétinement d’une vache sauvage, achevés par le glaive romain.
Reliques
Les premiers martyres chrétiens sont l’objet d’un culte. Ils montrent au restant des fidèles « le bon chemin vers le royaume de Dieu ».
Lorsque la religion d’Etat devient le christianisme, les successeurs de Saint Pierre s’installent au côté de l’Empereur, à Rome. Les papes y installent leur gouvernement. Pour perpétuer le souvenir des martyres des premiers chrétiens, les papes organisent leur canonisation et font rapatrier les reliques jusqu’à Rome.
Dans les provinces puis dans les royaumes dits barbares, la diffusion du christianisme va se faire par un courant monastique important. Là où des moines s’installent, un groupe de fidèles suit et une première communauté se crée qui grossit et essaime...
Les moines de Vierzon
A Vierzon, la christianisation a eu lieu quelque part au 7e siècle, véritable siècle de la christianisation du Berry. Selon la tradition, un premier lieu de culte chrétien a été érigé sur la butte de Sion, à l’emplacement d’un ancien lieu de culte païen.
C’est au tout début du 10e siècle que des moines bénédictins vont s’installer à Vierzon dans la durée. Ils n’arrivent pas seuls.
Lorsque Charles le Chauve avait fondé une abbaye en 843, l’archevêque de Bourges Raoul de Turenne leur avait donné des reliques de Optat et Perpétue.
Depuis ce jour, Perpétue est devenue la patronne de la communauté urbaine de Vierzon ; au fil des siècles, on lui attribue quelques « miracles ».
Dévotion
Perpétue fait alors l’objet d’une vraie dévotion.
Le reliquaire de Perpétue est conservé au sein de l’église Saint Pierre des moines de Vierzon. On le sort tous les sept mars dans une grande procession à travers toute la ville, y compris dans ses lieux les plus reculés comme Dournon. On la fait également traverser les ponts sur l’Yèvre et le Cher pour qu’elle protège des crues. Les moines y assistent, le seigneur castral également, suivis de toute la population, en cortège.
En temps que protectrice, on lui fait confiance pour atténuer les maux de la ville qui sont de quatre espèces : les épidémies, les crues, les incendies, les passages des troupes amies ou ennemies.
La Révolution Française
Les derniers moines quittent leur abbaye au printemps 1790. On transporte alors le reliquaire dans l’église Notre Dame
1792 : Par peur de l’expansion des idées révolutionnaires dans toute l’Europe, les monarchies voisines font la guerre à la France. Le pays inaugure alors la conscription. Mais il faut des armes. Les cloches des églises Notre Dames et Saint Pierre seront fondues en canons à la fonderie de La Charité.
Il faut également de l’argent pour faire la guerre. Les effets d’or et d’argent des églises seront réquisitionnés. Le curé Vaillant appellera les vierzonnais à le soutenir pour empêcher que le trésor de reliquaire ne soit rapatrié à Orléans. Des émeutes suivent, la troupe intervient et reste à Vierzon pendant un mois pour maintenir l’ordre ; mais Vaillant a gagné, après avoir un temps caché le reliquaire de Perpétue, il a de nouveau réintégré l’église Notre Dame où il se trouve toujours aujourd’hui...
De la rue Victor Hugo, il n'existe aucune image spécifique. Elle fut purement et simplement oubliée de tous les photographes et éditeurs de cartes postales du début du 20e siècle. Tous juste aperçoit-on son débouché sur la rue de la République, à quelques encablures de la Croix Blanche, lieu de fondation d'un monastère qui a donné son premier nom à la rue. Peut-être était-ce dû à la mauvaise réputation du quartier, considéré, au 19e siècle, comme mal famé.
1620 : en grande pompe l’archevêque de Bourges vient consacrer l’église saint Claude que les moines capucins viennent d’ériger dans leur nouveau monastère. En effet ils se sont installés à Vierzon en 1612, accueillis par une population vierzonnaise qui leur offre les terrains de leur couvent. C’est à la Croix Blanche (actuel square Emile Péraudin), et le seul chemin d’accès est la route de Romorantin qui passe devant.
L’enclos des Capucins est alors un vaste rectangle qui va de la route de Romorantin jusqu’à un bras de la rivière d’Yèvre, près du moulin de Grossous. L’actuel triangle que forme le square Péraudin correspond en fait au cimetière des moines et a longtemps porté le nom de « Clos Labbé » puis place des Capucins avant de s’appeler place de la République (1905), et enfin square Emile Péraudin.
Le chemin de Romorantin
Àl’époque, la rue Victor Hugo ne porte pas encore ce nom. C’est le chemin de Romorantin. Partant de la porte du Dégout (bas de la rue maréchal Joffre), c’est le seul qui permet de traverser la cité médiévale de Vierzon d’Est en Ouest, par la poterne (chemin des vignes) et la grande rue (rue Maréchal Joffre). Le trajet naturel n’est pas encore celui que nous connaissons par la rue Armand Brunet et avenue de la République. C’est ainsi que le chemin portera le nom de chemin puis rue des Capucins, faisant référence à l’établissement rencontré à la Croix Blanche (du nom d'une croix blanche matérialisant l'entrée du monastère).
L’expansion du 18e siècle
Le 18e siècle est, pour Vierzon, celui de l’expansion démographique. C’est aussi celui de l’amélioration des voies de communication à travers le royaume. Vierzon en profite et la cité va dès lors endosser son rôle de carrefour routier. En 1741 le roi classe sous le nom de route royale numéro 20 la route qui va de Paris à Toulouse. Dans la foulée, c’est la route de Nevers à Tours qui est classée sous le numéro 76. Dorénavant la route de Romorantin et Tours passera par les rues Saint Pierre (Armand Brunet) et Neuve (avenue de la République). On élargit la rue Neuve qui est la première rue extra urbaine de Vierzon, la première où des maisons se construisent à l’extérieur des anciens remparts. Le nom de « neuve » n'est pas un hasard. Il s'agit de la « rue Neuve des Capucins », autrement dit la nouvelle rue qui permet d'accéder à leur couvent. Le couvent disparaîtra, pas l'adjectif de neuve.
Le roi fait paver ces voies « dont la largeur sera portée à dix mètres ». Les autres rues ne font en effet que sept mètres de large, disposition confirmée par décret impérial de 1809.
Bidonville au 19e siècle
On construit haut de gamme dans la rue Neuve. Ce n’est pas le cas dans la rue des Capucins qui connaît une construction de masse. On construit à tout va de part et d’autre de la rue, sans respect des règles architecturales, un empilement plus ou moins solide de cubes hétéroclites. Les logements sont souvent insalubres et s’écroulent régulièrement (archives municipales).
En cette fin de 18e le quartier prend l’aspect d’un bidonville que les élus tentent de résorber à grands coups d’arrêtés municipaux pour en réglementer les matériaux de construction. Il faut attendre la fin du 19e et les travaux sur l’actuelle rue Gourdon (1866) pour que la rue Victor Hugo connaisse également d’importants travaux de mise au norme des alignements.
Quant au nom même d’Hugo, les archives municipales n’ont pas conservé sa date de baptême (Hugo est mort en 1885). Tout au plus peut-on dire que la Révolution ayant débaptisé les noms à consonance religieuse, le chemin a pour un temps porté le nom de Bourchevreau.
Brèves de trottoirs
Pavage
Le pavage de la rue remonte à un arrêté municipal de 1866. Il fut terminé en 1875. La loi obligeait les riverains à paver leur propre bout de trottoir devant chez eux. Inutile de dire que certains y ont mis de la mauvaise volonté. Les archives municipales comptent de nombreuses sommations, y compris dans les années 1870-1880.
Drôle de naissance
C’est dans cette rue qu’est né un certain Bernard Giraud, plus connu sous le nom de Patrick Raynal, dit Berlodiot. C’est un humoriste bien connu dans la région, dont le texte célèbre, le cornemuseux d’marmignol, est dans toutes les mémoires (et sur internet).
Coupe-gorge
Il existait dans la rue Victor Hugo l’entrée arrière d’une maison close dont la façade principale donnait rue de la République, à l’emplacement de l’actuelle Société Générale. Il y avait là une cour avec un bâtiment au fond. La sortie discrète avait lieu rue Victor Hugo. Les plus anciens de la rue se souviennent encore des galopades des clients qui s’échappaient par l’arrière alors que la police investissait la devanture. Cela a fait partie de la mauvaise réputation de ce coupe-gorge que fut un temps la rue Victor Hugo.
Images : Archives municipales Vierzon.
Le vendredi 4 mars 1977, il y a tout juste 45 ans, les autorités locales inauguraient la nouvelle bibliothèque de Vierzon. Le maire Léo Mérigot saluait alors la réalisation depuis « si longtemps espérée » d'un équipement « enfin digne de notre ville ».
Tout le monde connaît l'humanisme de Léo Mérigot et son amour des livres. Les témoignages sont nombreux des personnes qui ont pu, passant par son domicile de la rue de l'Étape, admirer la bibliothèque dans laquelle il aimait s'enfermer après sa journée à l'hôpital. Passionné d'histoire, de sciences, il affiche un faible pour la littérature du 16e siècle, pour Rabelais en particulier, mais aussi pour les antiques. Libre penseur comme son père (instituteur), il s'intéresse également à l'ésotérisme, entretient des relations avec des groupes d'intellectuels au gré de ses voyages. Il est également un parfait connaisseur de l'astrologie et un des meilleurs analystes de Nostradamus.
Création 1905
La bibliothèque de Vierzon date en fait de la municipalité d'Émile Péraudin, maire de Vierzon Ville de 1900 à 1925. Il fonde la première bibliothèque en 1905 dans les locaux de la mairie.
La ville alors était en pleine expansion économique et les jeunes ouvriers vierzonnais trouvaient facilement du travail dans les usines locales. L'idée de Péraudin consistait en la formation des futurs ouvriers et contremaîtres. Ils devaient être suffisamment armés et formés pour entrer dans n'importe quelle usine locale. Péraudin fait alors appel à des personnalités locales pour constituer un fonds digne de ce nom. Perrin, directeur de l'École Nationale Professionnelle Henri Brisson lui établit des listes d'ouvrages dont l'acquisition serait judicieuse.
Dans cette optique également, Marc Larchevêque est consulté. Il est patron d'une usine de porcelaines et lieutenant, chef de la compagnie des sapeurs pompiers de Vierzon Ville. Larchevêque établit des listes thématiques d'ouvrages qu'il va acquérir sur ses propres deniers pour la bibliothèque : métallurgie, porcelaine, arts du feu, mécanique, dessin industriel... sans oublier la couture, l'économie domestique et les bonnes manières...
Péraudin laisse la gestion du fonds à sa femme et à son gendre, Edmond Laurençon. Ce dernier passionné d'histoire locale, écrira un court ouvrage en 1913 : « Histoire de Vierzon depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours ».
Fermeture de 1939 à 1947
La bibliothèque a la bougeotte. Lors du dernier mandat de Péraudin, le travail de bibliothécaire devient une activité annexe des employés du service état-civil qui gèrent également les prêts de livres. Les achats ne suivent plus, le nombre d'inscrits chute pour atteindre 32 en 1937.
La fusion des Quatre Vierzon en 1937 fut un nouveau coup dur pour la bibliothèque. Le rapatriement dans la mairie de Vierzon Ville des services de autres mairies de Villages, Bourgneuf et Forges a entraîné d'importants travaux de restructuration. Les livres furent alors entassés dans le grenier de l'hôtel de ville... pour être redescendus quelque temps plus tard.
Pas pour longtemps malheureusement. Le service de la bibliothèque a été suspendu à cause de la guerre. Il a fallu libérer des locaux pour l'Occupant. La bibliothèque a donc été mise en caisses et transportée en deux lieux différents en ville : la plus grande partie dans un local prêté par la Société Française, quelques caisses entreposées dans un garage municipal du Tunnel-Château.
Mais entre-temps les Allemands s'étaient servi. Ils avaient réquisitionné des ouvrages en français – beaucoup d'ouvrages scientifiques – pour le « soldatenheim », foyer du soldat, dans l'hôtel de la Rotonde.
À la Libération, le passionné de livres qu'était Léo Mérigot ne pouvait pas ne pas s'occuper de faire rapatrier les livre dispersés. Les caisses entreposées à la Société Française et celles du garage municipal ont réintégré la mairie. Il a fallu également récupérer le fonds restant de la Rotonde. La surprise fut qu'il y avait également des livres de langue allemande que l'Occupant n'avait pas emportés. Ils furent mis à disposition de Monsieur Weiss, professeur d'allemand à l'ENP., pour ses élèves. Il en reste quelques uns au fond des étagères du lycée...
Mais Mérigot n'a pas le temps de trouver un nouveau local pour la bibliothèque. C'est le municipal Caron qui va s'occuper de placer la bibliothèque municipale au premier étage de la mairie, en face de la salle des mariages. À sa réouverture en 1947 tout est à refaire. Il ne reste que 3700 ouvrages dignes de ce nom. Beaucoup ont disparu, d'autres sont obsolètes du fait de leur ancienneté.
Un effort est entrepris pour combler les dix ans de fermeture et, surtout, la bibliothèque sera dorénavant un service à part entière, complété par un règlement intérieur et des statuts votés en conseil municipal. Surtout il connaît un personnel dédié, Monsieur Lapha, qui occupe le premier poste de bibliothécaire à plein temps.
De 1959 à 1977, la longue attente
En 1959, la municipalité Mérigot hérite d'une bibliothèque qui dépasse les 1000 inscrits et les 7000 livres.
La priorité allait au logement social. Le projet engagé par Caron de détruire et reconstruire le quartier insalubre du Tunnel-Château sera achevé au début des années 1960. À quartier neuf, nouveaux équipements : la municipalité lance deux projets majeurs, un musée et une bibliothèque qui doivent voir le jour dans le quartier.
En attendant leur réalisation, Mérigot dresse le portrait robot de la future bibliothèque. « Elle doit être conçue comme un instrument de progrès idéologique et une arme de propagande » Pour ce faire, outre « les saines lectures distractives, il faut y trouver, dans les diverses disciplines, les traités suffisamment complets pour fournir toute documentation courante, sans oublier toute la littérature socialiste et marxiste... » Autres temps, autres mœurs...
Mais la bibliothèque ne vient pas. Les subventions sont inexistantes. Le ministère des affaires culturelles est pourtant créé en 1959 avec André Malraux à sa tête. Mais la composante bibliothèque n'existe même pas au sein du ministère.
La donne change dans les années 1960. Un réseau des bibliothèques s'est créé qui se dote d'une charte commune.
À Vierzon, alors que les premiers appartements du Tunnel-Château sont livrés, la municipalité entame une nouvelle réflexion : il existe toujours en ville un problème lié à la fusion des Quatre Vierzon, celui d'un centre ville mal défini. Le comblement du canal de Berry doit apporter une solution par l'implantation d'une cité administrative sur les terres nouvellement conquises sur l'eau. Le canal comblé en 1968, de nouvelles infrastructures doivent s'y développer, dont la bibliothèque qui change de lieu d'implantation. Les Vierzonnais seront attirés dans ce nouveau centre par les administrations qui s'y trouvent, puis, dans un deuxième temps par l'apport d'un commerce phare type grande surface dans le projet urbanistique du Forum République.
Après le central téléphonique en 1970, après le centre des impôts en 1975 et avant la poste et l'EDF, les travaux de la bibliothèque arrivent enfin, dus à l'architecte Serge Lana. Ils dureront trois ans.
Léo Mérigot pose la première pierre en mai 1974. Roger Faletto, maire adjoint à la culture est à ses côtés.
Un bibliothécaire est engagé, Dominique Mérigot. C'est lui qui proposera le nom de Paul Éluard comme dédicataire du bâtiment. La bibliothèque municipale est inaugurée le vendredi 4 mars 1977 en présence de l'écrivain Tahar Ben Jelloun et du poète Jean Marcenac, ami de Paul Éluard.
45 ans plus tard la bibliothèque fait sa mue. De nouveaux supports sont apparus, disponibles au prêt, cd, dvd, livres-audios, et aujourd'hui jeux vidéos et jeux de société. Il aura fallu deux ans de travaux pour pousser les murs d'un nouvel écrin qui accueille près de 90 000 documents, tous supports confondus.
Inauguration médiathèque : ce vendredi 4 mars 2022, 17h30
Semaine festive à la médiathèque : du 5 au 12 mars 2022
La médiathèque est ouverte à compter du samedi 5 mars 2022, du mardi au samedi.
Images : Archives municipales Vierzon
Difficile, dans les archives, de retrouver l'origine de la propriété de Fay (Fez dans son orthographe d'origine). Sur cette terre, le cartulaire de Vierzon (chartes de l'abbaye) ne donne aucun renseignement.
Cela semble logique, la terre de Fay, ne dépend pas de l'abbaye Saint Pierre, mais bien de la grosse tour de Vierzon, celle des seigneurs castraux.
À l'origine la propriété était plus vaste qu'aujourd'hui, englobant une grande partie occidentale de Vierzon, de la route de Tours à la route de Paris ; du Coq gaulois, à Bois Marteau en passant par la Bercetterie, Charnay et le Verdin.
Dans ces « Mémoires sur Vierzon » (1748), Béchereau avocat du roi, ne donne que deux renseignements sur la propriété. On y apprend que la source de Fay soulage le « feu sauvage » (herpès) et que l'argile qu'en en tire est utile aux faïenciers. Ses successeurs, de Toulgoët à de Kersers n'en diront pas d'avantage par manque cruel de textes.
Les de Francières
Les archives notariales donnent la propriété « du fief et hostel de Fez » à une certaine dame Margaron qui la vend au chantre de Mehun sur Yèvre en 1380.
On la retrouve entre les mains de la famille Pathofleau après 1448. C'est alors par le mariage des filles que la propriété se transmet de générations en générations.
La famille de Francières possède la seigneurie de Fay depuis au moins 1748. Ils ne sont pas des inconnus en ville. Ils apparaissent comme gouverneur de Vierzon, représentants du roi en 1500. Le plus connu des de Francières fut Robert qui prit part aux guerres de religion, dans le camp de la Ligue. Issus d'une famille de riches marchands, les de Francières possédaient également un des plus beaux hôtels particuliers du Vieux Vierzon, dans l'actuelle rue de l'étape, une sorte de palais d'hiver.
De Mac Nab à Célestin Gérard
Par un nouveau mariage, la propriété de Fay avec son étang passe dans les mains de la famille Mac Nab, en 1810. Les Mac Nab sont d'origine écossaise et l'aïeul qui fonde la branche française est un soldat (mercenaire) garde du corps du roi Louis XV.
Édouard Mac Nab sera conseiller général, deux ans maire de Vierzon Villages pendant la Seconde République, de 1850 à 1852.
Avant cela, Édouard a vu sa propriété amputée d'une grande partie sur le sud-Est. Il subit les expropriations liées à l'arrivée du chemin de fer, les lignes Orléans – Vierzon, Vierzon – Tours, et enfin la gare de triage.
Son fils – qui donnera son nom au théâtre vierzonnais – est le chansonnier Maurice Mac Nab qui fera les beaux jours du cabaret parisien « le chat noir » dans es années 1880. Il y créera « le grand métinge du métropolitain », chanson écrite pour les grévistes de la Société Française, en 1886.
Enfin, dans les années 1870, les Mac Nab vendent la propriété à Célestin Gérard, précurseur justement de la Société Française. Il avait fondé les ateliers de construction de machines agricoles face à la gare en 1848, revendus à Arbel en 1877 pour devenir la SFV...
Le château de Fay est très laid
Maurice Mac-Nab n'est pas le seul à aimer les rimes. Un jeune vierzonnais s'y essaye également, Salvinien, qui brocarde la château familial des Mac-Nab :
« Le château de Fay se dresse près d’une forêt épaisse où le gibier se presse, fait la nique au châtelain. Mais dès que l’on s’en approche, le regard, déçu, s’accroche à plus d’un détail qui cloche, autour du château de Fay, plus beau de loin que de près.
Le long mur qui s’écroule, vide hélas ! de toute foule, un petit jardin déroule son dessin sans mouvement ; dans les sentiers, l’herbe pousse comme sur les toits la mousse, une Solognote rousse en est le seul ornement, car ne sachant plus qu’y faire, le malin propriétaire a fui la saison dernière son pauvre château de Fay, plus beau de loin que de près.
Au milieu d’une clairière veuve même de bruyère, s’ouvrent maintes fondrières qu’il faut traverser ; d’abord on se trouve alors en vue d’une superbe avenue depuis si longtemps venue que plus d’un arbre en est mort ; tout au bout, un conifère un peu chauve et solitaire mort à ce château de Fay, plus beau loin que de près.
Or, inconséquence extrême, si ce châtelain que j’aime m’offrait le château lui-même que je vous peins au pastel, sans doute banale et sotte, je prendrais la Sologne avec le pin qui sanglote et les trous et le castel, dussé-je, pour le prix de vente, lui chanter sans variante merci au château de Fay plus beau de loin que de près. »
Cette farce a reçu une réponse de la part de la châtelaine, qui n’est autre que la mère de Maurice Mac Nab, Béatrix :
« Je ne fus jamais bien austère, vous le savez mon jeune ami, votre muse parfois légère ne me cause donc seul souci et sans rancune je veux rire de la très plaisante satire où vous chapez mon pauvre Fay, plus beau de loin que de près.
Quoique votre verve critique ait un peu chargé le tableau, je reconnais pour véridique certains traits de votre pinceau. Pourtant, admirez ma faiblesse, naïvement je me confesse d’aimer ce vieux château de Fay qui n’est beau ni de loin ni de près. »
Images : Archives municipales Vierzon
À circonstances exceptionnelles, destin exceptionnel. Destin tragique que celui de Raymond Toupet. La seconde guerre mondiale l'a conduit au sacrifice, fusillé dans sa barque le 6 février 1942, à l'âge de 40 ans, il y a tout juste 80 ans.
C'est l'histoire d'un passeur, comme Vierzon et sa région en ont connu beaucoup, à partir de juillet 1940. Certains sont restés anonymes. Certains ont été interpellés, condamnés, incarcérées et libérés. Les récidivistes auront été sévèrement châtiés, envoyés en déportation. Beaucoup y sont morts. D'autres seront fusillés sur place, comme Raymond Toupet.
Il est né en 1902 et exerçait la profession d'ouvrier ajusteur lorsque la guerre a été déclarée. La convention d'armistice instaurait une Ligne de Démarcation sur le Cher, qui fut mise en place dans les premiers jours de juillet 1940.
Habitant Thénioux, il voit se monter la guérite de la « Zoll » non loin de chez lui. Grâce à une bonne connaissance des lieux et de la rivière du Cher, c'est tout naturellement, avec son frère Marcellin qu'il organise les passages des premiers clandestins vers la zone libre. Au début ce sont essentiellement des éfugiés ou des soldats prisonniers évadés que les frères prennent en charge dans la barque de Raymond.
Les Allemands l'arrêtent une première fois en 1941, condamné à 8 jours de prison au Bordiot. Une fois libéré, il reprend de plus belle son activité, faisant passer de nombreux clandestins, aviateurs, condamnés recherchés par les autorités allemandes ou françaises...
La filière des frères Toupet est connue jusque dans les stalags allemands. Les candidats au passage en Angleterre via l'Espagne avaient également ce même renseignement.
Parallèlement, les candidats au passage renseignaient Raymond des nombreuses activités des troupes d'occupation en zone nord, renseignements que Raymond collectait et transmettait au deuxième bureau de l'armée d'armistice, à Châteauroux, dont beaucoup d'officiers travaillaient en fait pour Londres.
Repéré au bord du Cher à Thénioux, Raymond est pris pur cible par les Allemands le 6 juin 1941. Les deux frères s'enfuient en zone libre. Recherchés par les autorités, ils sont convoqués au tribunal de la Feldgendamerie le 1er juillet 1941 (voir image jointe). Le 3 ils sont condamnés à mort par contumace.
Raymond poursuit tout de même son activité de passeur. Il s'installe en zone libre, à Vierzon Bourgneuf. Des rabatteurs des environs lui envoient des candidats au passage. Il les passe la nuit, dans sa barque, entre Abricot et Genette. Et le 27 novembre 1941 il essuie un nouveau tir de douanier. Il est blessé à la jambe et sera soigné à Châteauroux.
Alors que Marcellin est mis en résidence surveillée à Lignières par la police de Vichy, Raymond Toupet poursuit seul son activité de passeur. Son dernier passage a lieu le 6 février 1942.
À cette époque de l'année où le Cher est en crue, cinq clandestins ont pris pied à bord de la barque lorsqu'elle est prise pour cible. Raymond s'écroule pendant que les clandestins se mettent à plat ventre. Un d'eux se sauvera en passant par dessus bord. Il sera récupéré par les Allemands le lendemain ; il s'était accroché aux branches d'un arbre au milieu du Cher.
Le lendemain également, on retrouve la barque où gît le corps de Raymond à la Loeuf sur la rive sud ; les clandestins ont disparu.
Ses obsèques seront célébrées à Bourgneuf le 10 février en présence des officiers de l'armée d'armistice de Châteauroux.
En 1945, un procès va avoir lieu au tribunal de Bourges, dans le cadre des procès de l'épuration. En effet, les langues se sont déliées et on accuse A..., un des rabatteurs de la filière Toupet de l'avoir dénoncé. Ces archives judiciaires ont été récemment déclassifiées et sont donc consultables par tous.
À la lecture des différents actes, on en apprend également beaucoup sur l'organisation des passages. En février 1942, Raymond Toupet travaillait avec deux personnes : A... et B... . A... est le rabatteur de Raymond, celui qui prend les contacts avec les clandestins et qui les dirige vers la barque de Raymond. B... quant à lui est le financier. Les passages n'étaient pas toujours gratuits. Les sommes demandées aux clandestins pouvaient aller de 100 francs à 1000 francs (salaire moyen d'un petit employé de mairie en 1940 = 1000F/mois).
En effet, Toupet fournissait si besoin est, des faux papiers, des vêtements, de la nourriture pour quelques jours. Et pour les plus modestes qui ne pouvaient pas payer, il lui arrivait de fournir un pécule...
Que s'est-il passé le 6 février 1942 ?
Selon le procès, les faits se sont déroulés ainsi : A... et B... avaient donné rendez-vous à la nuit tombante à un clandestin dans le café du tacot (avenue Jean Jaurès). Alors qu'ils étaient à consommer, la Gestapo a encerclé le café. Les deux portes, avant et arrière sont surveillées. Alors que la Gestapo, envahit le café par la porte principale, A... s'enfuit par la porte arrière et n'est pas inquiété par les Allemands. B... et le clandestin sont arrêtés et dirigés vers le 12 boulevard de la Liberté... Au même moment, les douaniers étaient au moulin de l'Abricot et tiraient sur Toupet. Tous les témoins qui étaient présents dans le café, déclarent que A... a sans douté dénoncé la filière. Que pas un Allemand n'a essayé de l'intercepter à la sortie du café et qu'ils n'ont pas sorti leur arme de leur étui. D'autres sont plus affirmatifs : entre rabatteurs on savait que A... n'était pas fiable.
Le procès a duré peu de temps. A... n'était pas que rabatteur, il était également passeur. Il a fourni des témoignages de personnes qui ont confirmé que leur passage s'était très bien passé et qui le remerciaient.
Au vu de ces témoignages, au vu du manque de preuve, A... a été acquitté des faits reprochés.
Il ne restait plus alors que l'intime conviction des protagonistes...
Images :Archives municipales Vierzon Archives départementales du Cher
Dans une chronique précédente (voir l'archive du vendredi 6 novembre 2020 sur Facebook), nous avons déjà évoqué la personnalité du premier maire de Vierzon, François Rouseau de Belle Île, et sa confrontation avec le lieutenant général du bailliage de l'époque.
Cet épisode-ci participe à la querelle que les deux hommes se sont livré durant des années...
Nous sommes le 20 avril 1695. François Rousseau, maire perpétuel omnipotent en place depuis deux ans, procède à l’arrestation d’un quidam qui lui semble louche. La description de ce cas nous est parvenue, une fois encore, grâce aux registres du tribunal de bailliage de Vierzon conservés aux archives départementales du Cher.
François Rousseau explique les circonstances de cette arrestation : « Nous promenant près le puy Saint Jean de Vierzon, avons rencontré un homme vêtu d’un habit d’ermite auquel avons demandé qui il était, où il allait, d’où il venait. Il nous a répondu qu’il était de Tulle et frère chapeau des Récollets. A quoi nous lui avons demandé s’il avait obédience ou passeport. Lequel nous a répondu n’avoir ni l’un ni l’autre, ce qui nous a donné lieu de lui dire qu’il y avait quelque mystère caché sous son habit et qu’apparemment n’était point frère chapeau des récollets mais quelque travesti ou espion. Aussi avant que de le laisser aller plus avant, nous étions obligés pour l’intérêt du roi et le devoir de notre charge de nous instruire du motif de son voyage.
Vêtu de séculier
Le sommant de nous le dire, il nous a dit que les pères du couvent où il demeurait près de Tulle ayant été chassés de leur couvent, l’aurait chargé, ayant des connaissances à Paris, d’aller solliciter leur rétablissement. Partis à deux, son compagnon l’aurait quitté à Aubusson.
Comme cette réponse n’était pas sincère par les différents interrogatoires que nous lui avons faits et au contraire il s’était coupé en plusieurs fois, tantôt nous disant qu’il avait quitté son couvent pour mécontentement, tantôt pour aller se faire frère de la charité à Paris.
Nous avons jugé nécessaire de prendre des connaissances plus particulières de sa personne et à cet effet nous l’avons fait entrer chez Huguenin, demeurant près le puy Saint Jean. Là nous lui avons ordonné de se défaire de sa robe d’ermite. Nous l’avons trouvé vêtu d’un juste au corps et vêtu de séculier portant chapeau lequel nous a davantage confirmé que cet homme était suspect.
Nous lui avons ordonné d’exhiber tout ce qu’il avait dans les poches : quelques livres de dévotion, un chapelet et une bourse contenant deux louis d’or. Attendu que nous n’avons pu tirer de lui aucun éclaircissement de son pays, de sa profession et du sujet de son voyage ; ses variations et le double habit dont il est vêtu donne sujet de questionnement. Nous l’avons, pour l’intérêt de l’Etat, fait conduire dans une tour de cette ville servant de prison pour demain le faire conduire sous bonne garde à Monsieur l’Intendant. »
Le travesti enlevé
Oui mais voilà, c’était sans compter sur le lieutenant du bailliage, véritable concurrent aigri du maire François Rousseau.
Au courant de l’arrestation de ce personnage ambiguë, le lieutenant général du bailliage entre en scène.
Et Rousseau de poursuivre : « Et ledit jour 21 avril 1695 par devant nous juge est comparu le sieur Huguenin chargé de fournir audit travesti le pain des prisonniers lequel nous a dit que lui portant ledit pain et étant sur le dessus de la porte des ponts qui conduit à la tour, seraient montés noble Adrian de Lanjon, lieutenant général, Gabriel Thomas, procureur du roi et Martin Richer greffier, et Mathurin Guérinet huissier lesquels lui auraient dit de lui présenter ledit travesti. A quoi il leur aurait dit que le maire l’avait fait prisonnier comme suspecté d’être quelque espion. Il ne pouvait donc pas le leur présenter sans auparavant nous demander avis. Sur quoi le sieur Lanjon se serait jeté sur lui et lui aurait tiré des mains la clé de la porte de la tour et ensuite aurait été à ladite tour, l’aurait ouverte et enlevé le travesti. Huguenin nous requérant pour sa décharge lui donner acte dudit enlèvement pour servir à valoir ce que doit. »
Qu’a donc fait le lieutenant général du travesti ? Voulait-il l’interroger lui-même ? Ou l’emmener lui-même à Bourges auprès de l’Intendant pour se faire bien voir dans ce conflit qui oppose les deux hommes de pouvoir à Vierzon ? Toutes les hypothèses sont plausibles. Cela ne lui a pourtant pas coûté sa place. Adrian de Lanjon, lieutenant général à Vierzon depuis 1650, a conservé sa place jusqu’en 1702, remplacé par René Rossignol.
On comprend mieux qu’il ait été blessé qu’un freluquet en culottes courtes piétine ses plates-bandes en 1693. Cela faisait quarante-trois ans qu’il régnait en maître à Vierzon...
Et pourtant, avec le changement de personnel judiciaire, les querelles se poursuivront entre bailli et maire. Bientôt ce sera au tour de François Rousseau d'être accusé d'avoir chanté trop fort... Affaire à suivre, donc...
1961 : Un flot de petits vierzonnais, filles et garçons, découvrent pour la première fois les joies des sports d'hiver. La joyeuse ribambelle débaroule en désordre sur les pentes de Saint Léger les Mélèzes. Les combis ont aujourd'hui remplacé les bons vieux anoraks-cagoules mais les cris résonnent de même au pied des tire-fesses.
Programme électoral 1959
Lors de la campagne électorale pour les municipales de 1959, la liste du Parti Communiste menée par Léo Mérigot présentait son programme en trois points, trois points qui seront l'épine dorsale des mandats qui suivront.
Le premier axe était le logement social. En 1959, Vierzon comporte encore beaucoup de mal logés dont certains le sont depuis 1944 et le bombardement du 1er juillet.
Le deuxième axe est celui des personnes âgées, les « Anciens », comme aimait à les appeler le 1er adjoint Fernand Micouraud. Le « colis des vieux » date de cette époque ; la construction de la maison de retraite Ambroise Croizat également...
Quant au troisième axe, ce sera celui des jeunes. Créations de nouveaux groupes scolaires, de nouveaux terrains de sport, sans oublier la crèche, sortie de terre en 1973 sur le jeune quartier du Clos du Roy.
Sports d'hiver
La jeunesse de Vierzon pourra également profiter des joies de la poudreuse lors de classes de neige organisées pour les écoliers. Chaque année en janvier les élèves de CM1 pourront apprendre le chasse neige sur les pentes des Alpes.
1961, Une... Première : quelques dizaines d'écoliers découvrent le ski à Sappey en Chartreuse, près de Grenoble. Les enfants en reviennent enchantés ; la municipalité également. Elle a gagné son pari de devenir la première commune du département à organiser ces classes de neige.
Vierzon connaissait les colonies de vacances aux Trois Brioux depuis les années 1930, dorénavant l'hiver n'est plus un obstacle « au grand air ».
La politique tarifaire permet à de nombreux jeunes de tous milieux de partir. Dès 1961 l'hôtel de Sappey se révèle trop petit. Il faut penser plus grand. C'est la commune de Pont du Fossé qui est choisie, proche de Gap. Elle a l'avantage de posséder deux vastes hôtels dont les seuls noms vont évoquer bien des souvenirs aux quadras et quinquas vierzonnais, voire aux jeunes retraités : l'hôtel « DRAC ET MONTAGNE » et le chalet « LES DIAMANTS ».
Le Brudou
Vierzon recherche dès 1964 son propre terrain où installer cette colonie d'hiver. Le terrain acheté les travaux peuvent commencer et « LE BRUDOU » peut sortir de terre et devenir opérationnel en 1969. Là encore ce nom de BRUDOU résonne à nos oreilles comme notre madeleine de Proust. Certes il y avait classe en demi-journée. Mais y aller en pantoufles, c'est quand-même quelque chose !
Aujourd'hui le brudou est toujours debout, même s'il n'appartient plus à la ville de Vierzon. Un temps propriété des PEP, il est devenu centre de colonie de vacances, été-hiver, géré par un privé.
Qu'à cela ne tienne, les nouvelles générations de vierzonnais qui ont eu ou qui auront la chance de partir à Pont du Fossé reviendront bourrés des mêmes souvenirs que leurs aînés des décennies passées.
Pont-du-fossé, février 1979
Classe de CM1, école du Bourgneuf.
Quelques jours avant « le grand départ », réunion des parents à l'école. Vérification du trousseau type ; rappel de la nécessité de coudre nos noms sur nos vêtements ; dernières consignes données aux parents. Et enfin c'est le grand jour, le grand soir plutôt.
Ramassage des élèves partant de l'école par car scolaire et faisant le tour des différents quartiers.
Arrivée à la gare. Montée dans le train affrété tout spécialement.
Voyage de nuit. Vous êtes sensé dormir pour arriver frais et dispos (dormir???)...
Descente du train, arrivée au Brudou et prise de contact avec les locaux dont l'immense cheminée centrale). Choix de la chambre. Essayage des chaussures et des skis.
Classe le matin, ski l'après-midi. Et entre les deux, la cantine et ses tables de 6 en formica.
Séance d'écriture aux parents et familles (ici tout va bien). Et le passage obligé au magasin de souvenirs (potier) pour dépenser l'argent de poche et offrir un beau souvenir aux parents (moi ce sera un pot à crayons).
Hop, en piste. Apprentissage du tire-fesses, du chasse-neige et du virage, à gauche ou à droite. Et la photo officielle qui rendra fier les parents.
Une journée spéciale en petit groupe pour le ski de fond. Et une autre à la patinoire de Gap. Sans oublier les séances de luge sur sur des sacs plastique.
La cabane dans le parc du Brudou, avec les copains. Et le dimanche soir, séance de cinéma pour toutes les classes rassemblées dans le hall. De même que la chasse au trésor.
Et puis, au bout de 21 jours qui peuvent paraître trois semaines, le passage devant un jury. Un par un pour la première étoile.
Enfin le retour à Vierzon. Retrouvailles sur le quai de la gare, récupération de la valise et retour à la maison.
Et c'est là seulement que les choses sérieuses commencent : « Alors, raconte !... »
Février 1979, hier…
Images : Archives municipales Vierzon
Au sortir de la seconde guerre mondiale, une dizaine de navires cargots et paquebots vont être construits par la compagnie des Chargeurs réunis afin de combler les pertes dues aux U-boats allemands. Un d'entre eux prendra le nom de « VIERZON », et ce n'est pas sans rapport avec notre ville.
Ce navire est intimement lié aux hauts fourneaux de Vierzon et à leur dernier maître de forge : Louis Armand Béhic.
Les forges de Vierzon, créées en 1779, ne sont pas restées longtemps entre les mains du Comte d’Artois. La « qualité exceptionnelle des fers de Vierzon » fait de l’usine une des dix plus importantes de France sous la Révolution et l’Empire. On a souvent écrit qu’elle fabriquait des fusils pour les révolutionnaires. C’est inexact. Elle se contentait de fabriquer les lingots de fer ou autre acier pour que d’autres établissements comme Bourges puissent fabriquer les fusils.
Lorsque Armand Béhic arrive sur la scène locale, Vierzon a 70 ans d’histoire métallurgique derrière elle.
Comme son nom le laisse supposer, Béhic est un vrai breton, parisien d’adoption, né en 1809 dans une famille de la haute bourgeoisie. Il poursuit des études de droit avant d’entamer des études financières. À tout juste vingt ans il entre au ministère des finances et s’engage dans l’aventure saharienne de la colonisation algérienne. Il est adjoint au Trésorier payeur général. Rentré en France il grimpe rapidement les échelons pour devenir inspecteur général des finances à 33 ans. La même année il devient Directeur du contrôle de la comptabilité du Ministère de la Marine et des Colonies avant de devenir le secrétaire général de ce même ministère. Sa vocation maritime est alors amorcée ; on suivra son importance au fil des ans.
Parallèlement, il tente une carrière politique aux législatives de 1846, se présentant dans le Nord, candidat de l’ordre moral orléaniste. Mais cette carrière est bouleversée par 1848. Et on assiste à un chassé-croisé : Pyat monte à Paris pendant que Béhic arrive à Vierzon, maître des forges. Comment a-t-il connu l’établissement vierzonnais ? C’est une question toujours actuellement sans réponse.
L’entreprise appartenait alors à un conglomérat hétéroclite avec Grenouillet à sa tête. En 1848, il sortait plus de 6 millions de kilos de fer et fonte pour un prix estimé de plus de 2,5 millions de francs par an. Lors de l’exposition universelle de 1854, on apprend que la forge vierzonnaise « sans cesse modernisée », exporte ses fers vers deux types d’industries : le rail et la mer. Vierzon fabrique « des rails mais aussi des fontes, câbles et aciers de premier choix pour la marine ». Le catalogue ne dit pas si l’impulsion maritime a été donnée par Béhic, mais, en tant que maître de forge, il se devait de trouver de nouveaux débouchés pour son usine.
Pourtant, Béhic, dont on ne sait s’il est directeur ou co-propriétaire, n'est resté que trois ans à Vierzon, de 1848 à 1850.
Une fois Béhic parti, il n'y aura plus de maître de forge à Vierzon. Des décisions prises de loin seront appliquées sur place par de simples administrateurs...
Il co-fonde alors avec Besson la Compagnie Maritime des Messageries Impériales, véritable pendant maritime aux Messageries terrestres de Casimir Lecomte, et dont le siège est à Marseille. La démission de Besson sept ans plus tard (1859), le fait seul maître à bord. Pour transporter les marchandises, il faut des bateaux. Il fait construire à La Seyne des immenses chantiers navals. Les navires sortis des chantiers seront les fleurons de la marine française. Les dragueuses du canal de Suez seront issues de ces mêmes chantiers...
Parallèlement, Napoléon III, impressionné par cette réussite le nomme ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, poste qu’il occupera à plein temps jusqu’en 1867.
De retour à Marseille, il reprend alors la tête des messageries maritimes qu’il ne devra plus quitter jusqu’à son décès en 1891. À la tête de la compagnie – sa compagnie – il en organise le règlement interne, codifiant le moindre geste des équipages. Chacun se voit remettre un manuel à respecter à la lettre. Ce souci du détail va jusqu’à réglementer la circonférence des boutons d’uniformes. Aujourd’hui encore, un uniforme béhic est la veste courte des officiers de marine.
Il fondera plusieurs lignes : l’Atlantique du Sud depuis Bordeaux en 1860, l’Indochine en 1862, la Réunion en 1864, l’Australie en 1880.
Patron social, il organise dans les chantiers navals les magasins subventionnés, les écoles et les cours du soir, les caisses de secours mutuels et les pécules en cas d’accidents du travail.
Le Armand Béhic, transpacifique des French Lines, fut construit en hommage dès 1892, mis en service en 1894. Affecté à l’Australie puis à l’Extrême Orient, il sera désarmé puis vendu en 1924. Il possédait le même blindage des paquebots de la classe du Titanic…
Quant au « VIERZON » il est conçu en 1946. Depuis la mort de Béhic, des actionnaires nouveaux sont arrivés, des lignes ont été vendues, la compagnie a plusieurs fois changé de patron.
Pour rendre hommage aux patrons qui se sont succédés, les dix navires ont tous reçu comme nom celui d'une ville qui avait de l'importance à leurs yeux.
Et pour rendre hommage à Béhic, c'est VIERZON qui fut choisi...
On peut lire : Jean MARIE, Le souvenir d’Armand Béhic, Paris, 1942
Images : BNF Gallica
Ici commence l'enquête. Qu'est ce donc que cet éguilan que l'on donne aux enfants ? Dans les musées des arts populaires et folkloriques ? Rien. Aux archives du Cher ? Rien non plus... Il faut faire appel aux plus fins limiers, passionnés d'histoire du Berry, voire de berrychonneries, voire de vieils parlures d'autrefois, voire de tout cela à la fois.
En attendant, c'est un poète et académicien... breton, (eh oui) qui va nous en apprendre un peu plus sur notre tradition. Découvrons un extrait de « Fêtes et coutumes populaires » de Charles Le Goffic en 1911 :
La spécialité culinaire est donc bien spécifique pour Vierzon. Reste à en connaître les détails.
Enfin, quelques jours plus tard, la Dépêche se fait à nouveau l'écho de la tradition. L'article du 31 décembre a fait réagir un vieux boulanger retraité qui a pris la plume pour expliquer ce qui se faisait « de son temps », c'est-à-dire au siècle précédent. Il explique qu'il s'en vendait « plus de 2000 douzaines » rien que le jour de l'an. Quant à sa forme, notre anonyme vieux boulanger a une explication bien à lui, explication que l'on se transmettait de bouche à oreille de pâtissier depuis des générations.
Aujourd'hui la tradition est morte. Quand était-elle apparu ? Notre vieil historien Béchereau, en 1750 n'en a pas parlé. Peut-être que l'aiguilan n'existait pas encore. Ou plutôt qu'il n'a pas estimé nécessaire d'en parler. Aujourd'hui cela fait une centaine d'années que la tradition est morte. Peut-être une boulanger s'en emparera pour faire revivre notre « lichounerie » purement vierzonnaise...